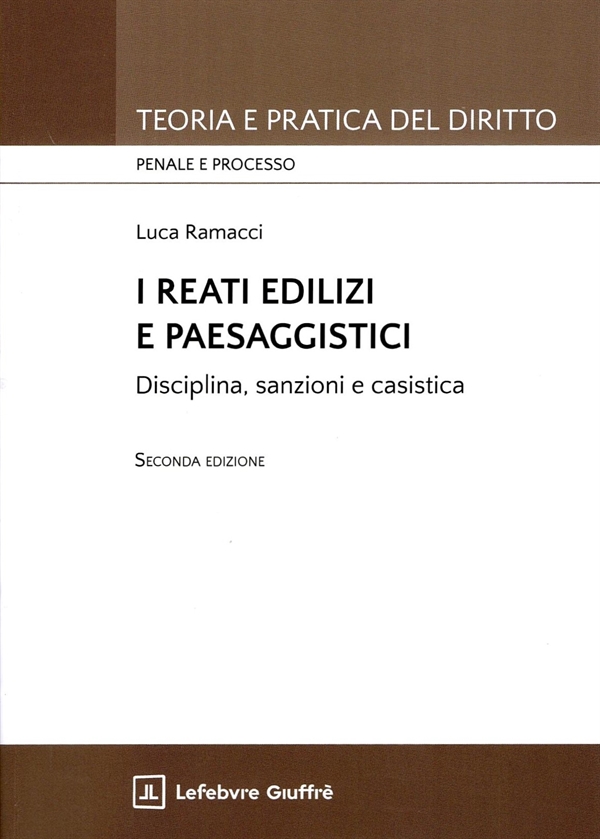Causa Öneryıldız c. Turquie (Ricorso n.48939/99)
Rifiuti. Responsabilità per esplosione deposito rifiuti (IN LINGUA FRANCESE)
a cura di Antonella MASCIA
Invoquant les articles 2, 8, 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, les requérants soutenaient que les autorités nationales étaient responsables de la mort de leurs proches ainsi que de la destruction de leurs biens du fait de l’explosion de gaz de méthane survenue le 28 avril 1993 dans le dépôt d’ordures municipal d’Ümraniye (Istanbul). Ils dénonçaient en outre l’incompatibilité de la procédure administrative menée en l’espèce avec les exigences d’équité et de célérité voulues par l’article 6 § 1 de la Convention.
La sentenza integrale:AFFAIRE
ÖNERYILDIZ c. TURQUIE
(Requête no
48939/99)
ARRÊT
STRASBOURG
30 novembre 2004
En l’affaire Öneryıldız c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
MM.
L. Wildhaber,
président,
C.L. Rozakis,
J.-P. Costa,
G. Ress,
Sir
Nicolas Bratza,
Mme
E. Palm,
MM. L.
Loucaides,
R. Türmen,
Mme
F. Tulkens,
M.
K. Jungwiert,
Mmes
M. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve,
MM. A.B.
Baka,
M. Ugrekhelidze,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky,
Mme
A. Mularoni,
juges,
et de M. P.J. Mahoney,
greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 7 mai 2003, 16 juin et 15 septembre 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 48939/99) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Ahmet Nuri Çınar et M. Maşallah Öneryıldız, ont saisi la Cour le 18 janvier 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Invoquant les articles 2, 8, 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, les requérants soutenaient que les autorités nationales étaient responsables de la mort de leurs proches ainsi que de la destruction de leurs biens du fait de l’explosion de gaz de méthane survenue le 28 avril 1993 dans le dépôt d’ordures municipal d’Ümraniye (Istanbul). Ils dénonçaient en outre l’incompatibilité de la procédure administrative menée en l’espèce avec les exigences d’équité et de célérité voulues par l’article 6 § 1 de la Convention.
3. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, une chambre composée de Mme E. Palm, présidente, Mme W. Thomassen, M. Gaukur Jörundsson, M. R. Türmen, M. C. Bîrsan, M. J. Casadevall, M. R. Maruste, juges, et de M. M. O’Boyle, greffier de section, a décidé le 22 mai 2001 de disjoindre les causes de M. Çınar et de M. Öneryıldız et a déclaré la requête recevable dans le chef de ce dernier (« le requérant »), agissant tant en son propre nom qu’au nom de ses trois fils survivants, alors mineurs, Hüsamettin, Aydın et Halef Öneryıldız, ainsi qu’au nom de son épouse, Gülnaz Öneryıldız, de sa concubine, Sıdıka Zorlu, et de ses enfants, Selahattin, İdris, Mesut, Fatma, Zeynep, Remziye et Abdülkerim Öneryıldız.
4. Le 18 juin 2002, après avoir tenu une audience, la chambre a rendu son arrêt, dans lequel elle concluait, par cinq voix contre deux, qu’il y avait eu violation de l’article 2 de la Convention, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention, et, par quatre voix contre trois, qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole no 1. A l’arrêt se trouvait joint l’exposé des opinions en partie dissidentes des juges Casadevall, Türmen et Maruste.
5. Le 12 septembre 2002, le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a demandé, en vertu de l’article 43 de la Convention et de l’article 73 du règlement, le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
Le 6 novembre 2002, un collège de la Grande Chambre a décidé d’accueillir cette demande.
6. La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement.
7. Devant la Grande Chambre, le requérant, représenté par Me E. Deniz, avocate au barreau d’Istanbul, et le Gouvernement, représenté par sa coagente, Mme D. Akçay, ont déposé des mémoires respectivement le 7 et le 10 mars 2003. Par la suite, les parties ont adressé au greffe des observations complémentaires et des documents à l’appui de leurs arguments.
8. Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 7 mai 2003 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
– pour le Gouvernement
Mme
D.
Akçay,
coagente,
M.
Y. Belet,
conseiller,
Mmes
G. Acar,
V. Sİrmen,
J. Kalay,
conseillères ;
– pour le requérant
Me
E. Denİz,
conseil,
M.
Ş. Özdemİr,
conseiller.
La Cour a entendu en leurs déclarations Me Deniz puis Mme Akçay.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Le requérant est né en 1955 et réside actuellement dans la sous-préfecture de Şirvan (département de Siirt), sa région natale. A l’époque des faits, il habitait, avec douze proches, dans le quartier de taudis (gecekondu mahallesi) de Kazım Karabekir à Ümraniye, un district d’Istanbul, où il s’était installé après avoir démissionné de son poste de garde de village dans le Sud-Est de la Turquie.
A. Le site de stockage de déchets ménagers d’Ümraniye et le quartier du requérant
10. Une décharge d’ordures ménagères se trouvait en fonction depuis le début des années 70 à Hekimbaşı, zone abritant également des taudis et contiguë au quartier de Kazım Karabekir. Le 22 janvier 1960, l’usage du site en question, qui appartenait à l’administration des forêts, donc au Trésor public, avait été attribué à la mairie métropolitaine d’Istanbul (« la mairie métropolitaine ») pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans. Situé sur une côte surplombant une vallée, le site s’étendait sur une surface d’environ 35 hectares et, depuis 1972, il servait de décharge commune aux districts de Beykoz, d’Üsküdar, de Kadıköy et d’Ümraniye, sous l’autorité et la responsabilité de la mairie métropolitaine et, en dernier ressort, des autorités ministérielles.
A l’époque où la décharge commença à être utilisée, cette région était inhabitée et l’agglomération la plus proche se trouvait à environ 3,5 km. Cependant, au fur et à mesure des années, des habitations de fortune furent construites, sans autorisation, sur la zone entourant le dépôt d’ordures, pour finalement donner naissance au bidonville d’Ümraniye.
D’après un plan officiel des quartiers, entre autres de Hekimbaşı et de Kazım Karabekir, dessiné par la direction des affaires techniques de la mairie d’Ümraniye, la maison de M. Öneryıldız était bâtie au coin de la rue Dereboyu et de la rue Gerze. Cette partie de l’agglomération était attenante au site de la décharge municipale et, depuis 1978, elle relevait d’un maire de quartier, lequel dépendait de la sous-préfecture.
A l’heure actuelle, la décharge d’Ümraniye n’existe plus. La mairie locale l’a fait couvrir de terre et y a placé des conduits d’aération. Par ailleurs, des plans d’occupation des sols concernant les quartiers de Hekimbaşı et de Kazım Karabekir sont en train d’être élaborés. De son côté, la mairie métropolitaine a procédé à un boisement de terrain sur une grande partie de l’ancien site de la décharge et y a fait construire des terrains de sport.
B. Les initiatives de la mairie d’Ümraniye
1. En 1989
11. A la suite des élections municipales du 26 mars 1989, la mairie d’Ümraniye tenta de procéder à une modification du plan d’aménagement urbain à l’échelle de 1/1000e. Cependant, les autorités décisionnelles refusèrent d’approuver ce plan, car il couvrait un territoire allant jusqu’à proximité de la décharge municipale.
A partir du 4 décembre de la même année, la mairie d’Ümraniye entama des travaux consistant à déverser des amas de terre et de débris sur les terrains entourant les taudis d’Ümraniye, afin de réaménager le site de la décharge.
Cependant, le 15 décembre 1989, M.C. et A.C., deux habitants du quartier d’Hekimbaşı, introduisirent devant la 4e chambre du tribunal d’instance d’Üsküdar une action pétitoire contre la mairie. Se plaignant des dégâts causés sur leurs plantations, ils sollicitèrent l’arrêt des travaux. A l’appui de leur demande, ils produisirent des documents, dont il ressortait que M.C. et A.C. étaient assujettis à la taxe d’habitation et à la taxe foncière depuis 1977, sous le numéro d’imposition 168900. En 1983, ils avaient été invités par l’administration à remplir un formulaire type, prévu pour la déclaration des bâtiments illégaux, afin que leurs habitations et leurs terrains soient régularisés (paragraphe 54 ci-dessous). A la suite de leur demande, le 21 août 1989, la direction générale des eaux et des canalisations de la mairie métropolitaine avait ordonné la pose d’un compteur d’eau dans leurs habitations. Par ailleurs, des copies de factures d’électricité démontrent que M.C. et A.C. effectuaient régulièrement, en leur qualité d’abonnés, des paiements selon leur consommation, laquelle était déterminée au moyen d’un compteur installé à cet effet.
12. Devant le tribunal d’instance, la mairie défenderesse axa sa défense sur le fait que les terres revendiquées par M.C. et A.C. étaient sises sur le territoire de la déchetterie, qu’y habiter était contraire aux règles sanitaires et que leur demande de régularisation ne leur accordait aucun droit.
Par un jugement rendu le 2 mai 1991, sous le numéro de dossier 1989/1088, le tribunal d’instance donna gain de cause à M.C. et A.C., reconnaissant qu’il y avait eu ingérence dans l’exercice de leurs droits sur les biens litigieux.
Cependant, par un arrêt du 2 mars 1992, la Cour de cassation infirma ce jugement. Le 22 octobre 1992, le tribunal d’instance se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation et débouta les intéressés.
2. En 1991
13. Le 9 avril 1991, la mairie d’Ümraniye demanda à la 3e chambre du tribunal d’instance d’Üsküdar une expertise concernant la conformité de la décharge à la réglementation en la matière, notamment au règlement du 14 mars 1991 sur le contrôle des déchets solides. La mairie sollicita également l’évaluation du préjudice qui lui avait été causé, afin d’appuyer l’action en dommages-intérêts qu’elle s’apprêtait à introduire contre la mairie métropolitaine et contre les mairies des trois districts utilisant la décharge.
La demande d’expertise fut enregistrée sous le numéro de dossier 1991/76 et, le 24 avril 1991, un comité d’experts fut constitué à cette fin ; il comprenait un professeur de génie de l’environnement, un agent du cadastre et un médecin légiste.
D’après le rapport d’expertise, établi le 7 mai 1991, le dépôt en question n’était pas conforme aux exigences techniques prévues notamment aux articles 24 à 27, 30 et 38 du règlement du 14 mars 1991 et, de ce fait, présentait un certain nombre de dangers susceptibles d’entraîner un très grand risque pour la santé des habitants de la vallée, notamment pour ceux des quartiers de taudis : aucun mur ou grillage de clôture ne séparait la décharge des habitations qui s’élevaient à cinquante mètres de la montagne d’ordures, le dépôt n’était pas équipé de systèmes de ramassage, de compostage, de recyclage ni de combustion, et aucune installation de drainage ou de purification des eaux de drainage n’y avait été prévue. Les experts en conclurent que la décharge d’Ümraniye « exposait tant les humains que les animaux et l’environnement à toutes sortes de dangers ». A ce sujet, le rapport, attirant d’abord l’attention sur le fait qu’une vingtaine de maladies contagieuses risquaient de se propager, soulignait ce qui suit :
« (...) Dans n’importe quelle déchetterie, il se forme, entre autres, des gaz de méthane, de dioxyde de carbone et d’hydrogène sulfuré. Ces substances doivent être, sous contrôle, réunies puis (...) brûlées. Or le dépôt en question ne dispose pas d’un tel système. Lorsqu’il est mélangé avec l’air dans une certaine proportion, le méthane peut s’avérer explosible. Il n’existe, dans cette installation, aucune mesure pour prévenir l’explosion du méthane issu de la décomposition [des déchets]. Que Dieu nous en garde, le dommage pourrait être très important en raison des habitations voisines. (...) »
Le 27 mai 1991, ce rapport fut porté à la connaissance des quatre mairies mises en cause et, le 7 juin 1991, du préfet afin qu’il en fasse part au ministère de la Santé ainsi que du Conseil de l’environnement auprès du premier ministre (« le Conseil de l’environnement »).
14. Les mairies de Kadıköy et d’Üsküdar ainsi que la mairie métropolitaine demandèrent l’annulation du rapport d’expertise respectivement les 3, 5 et 9 juin 1991. Dans leurs mémoires introductifs d’instance, les avocats des mairies se bornèrent à alléguer que ce rapport, commandé et établi à leur insu, contrevenait au code de procédure civile. Les trois avocats se réservèrent le droit d’étayer leurs objections ultérieurement par des mémoires complémentaires, une fois qu’ils auraient obtenu de leurs autorités tous les informations et documents nécessaires.
Or, aucune des parties n’ayant déposé un tel mémoire complémentaire, la procédure engagée n’aboutit point.
15. Cependant, le Conseil de l’environnement, avisé du même rapport le 18 juin 1991, enjoignit, par la recommandation no 09513, à la préfecture d’Istanbul ainsi qu’à la mairie métropolitaine et à la mairie d’Ümraniye de remédier aux problèmes signalés en l’espèce :
« (...) Dans le rapport préparé par le comité d’experts, il est indiqué que le site de stockage de déchets en question contrevient à la loi sur l’environnement ainsi qu’au règlement sur le contrôle des déchets solides et que, par conséquent, il menace la santé des hommes et des animaux. Il s’impose de prendre, sur le site de la décharge, les mesures prévues aux articles 24, 25, 26, 27, 30 et 38 du règlement sur le contrôle des déchets solides (...) Je demande donc que les mesures nécessaires soient prises (...) et que notre Conseil soit informé de l’issue. »
16. Le 27 août 1992, devant la 1re chambre du tribunal d’instance d’Üsküdar, Şinasi Öktem, maire d’Ümraniye, demanda la mise en œuvre de mesures provisoires visant à empêcher l’utilisation de la déchetterie par la mairie métropolitaine et par les mairies des districts voisins. Il réclama notamment l’interruption des dépôts d’ordures, la fermeture de la décharge ainsi que la réparation des dommages subis par sa municipalité.
Le 3 novembre 1992, le représentant de la mairie d’Istanbul contesta cette demande. Soulignant les efforts de la mairie métropolitaine pour entretenir les routes menant à la décharge et lutter contre la propagation des maladies, les chiens errants et le dégagement d’odeurs, le représentant fit notamment valoir qu’un projet de réaménagement du site de la décharge était en phase d’adjudication. Quant à la demande de fermeture provisoire de la décharge, le représentant prétendit que la mairie d’Ümraniye agissait de mauvaise foi, dès lors que depuis sa création en 1987, elle-même n’avait rien fait pour l’assainissement du site.
En fait, la mairie métropolitaine avait bien procédé à un appel d’offres pour l’aménagement de nouveaux sites conformes aux normes modernes. Les premiers travaux d’études furent adjugés à la société américaine CVH2M Hill International Ltd et, le 21 décembre 1992 et le 17 février 1993 respectivement, des emplacements furent désignés sur les rives européenne et anatolienne d’Istanbul. Ce projet devait s’achever au cours de l’année 1993.
17. Alors que cette procédure était encore pendante, la mairie d’Ümraniye informa le maire d’Istanbul qu’à partir du 15 mai 1993 aucun dépôt de déchets ne serait plus autorisé.
C. L’accident
18. Le 28 avril 1993, vers 11 heures, une explosion de méthane eut lieu sur le site. A la suite d’un glissement de terrain provoqué par la pression, les immondices détachées de la montagne d’ordures ensevelirent une dizaine de taudis situés en aval, dont celui du requérant. Trente-neuf personnes périrent dans cet accident.
D. Les procédures engagées en l’espèce
1. L’initiative du ministère de l’Intérieur
19. Immédiatement après l’accident, deux membres de la police municipale tentèrent de constater les faits. Après avoir entendu les victimes, dont le requérant, qui leur expliquèrent avoir érigé leur maison en 1988, ils rapportèrent que treize baraques avaient été détruites.
Le même jour, les membres d’une cellule de crise constituée par la préfecture d’Istanbul se rendirent également sur les lieux et relevèrent que le glissement de terrain avait bien été causé par l’explosion de gaz de méthane.
20. Le lendemain, 29 avril 1993, le ministère de l’Intérieur (« le ministère ») ordonna que les circonstances dans lesquelles cette catastrophe avait eu lieu soient examinées par le conseil d’inspection administrative (« le conseil d’inspection ») afin de déterminer s’il y avait lieu de poursuivre les deux maires, MM. Sözen et Öktem.
2. L’enquête pénale
21. Alors que cette procédure administrative suivait son cours, le 30 avril 1993, le procureur de la République d’Üsküdar (« le procureur ») se rendit sur les lieux de l’accident, accompagné d’un comité d’experts composé de trois professeurs en génie civil de trois universités différentes. Au vu de ses observations préliminaires, il chargea le comité de déterminer la part de responsabilité des autorités publiques et celle des victimes dans la survenance de l’accident.
22. Le 6 mai 1993, le requérant déposa une plainte au commissariat local. Il déclara : « Si ce sont les autorités qui, par négligence, ont causé l’ensevelissement de ma maison ainsi que la mort de mes compagnes et enfants, je porte plainte contre la ou les autorité(s) impliquée(s). » La plainte du requérant fut versée au dossier d’instruction no 1993/6102, déjà ouvert d’office par le procureur.
23. Le 14 mai 1993, le procureur entendit plusieurs témoins et victimes de l’accident litigieux. Le 18 mai 1993, le comité d’experts rendit le rapport qu’avait commandé le procureur. Dans son rapport, le comité constata d’emblée qu’il n’y avait pas de plan d’urbanisation à l’échelle de 1/5000e concernant la région, que le plan d’aménagement urbain à l’échelle de 1/1000e n’avait pas été approuvé et que la plupart des habitations ensevelies se trouvaient même en dehors de ce dernier plan, à l’extrémité du site de la décharge. Les experts confirmèrent que le glissement du terrain, qui déjà n’était pas stable, pouvait s’expliquer tant par la pression croissante du gaz à l’intérieur du dépôt que par l’explosion de celui-ci. Rappelant les obligations et devoirs que la réglementation en la matière faisait aux autorités publiques, les experts conclurent que, concernant la survenance de l’accident, la faute devait être répartie à raison de :
« – 2/8 à la charge de la mairie d’Istanbul, qui n’a pas agi en temps utile pour prévenir les problèmes techniques qui existaient déjà à l’installation du dépôt en 1970, et qui n’ont cessé de s’aggraver depuis lors, ni indiqué aux mairies concernées un autre site de stockage de déchets, comme la loi no 3030 l’obligeait à le faire ;
– 2/8 à la charge de la mairie d’Ümraniye, pour avoir mis en œuvre un plan d’occupation des sols en omettant de prévoir, en violation du règlement no 20814, une zone tampon large de 1 000 m et devant demeurer inhabitée, et pour avoir attiré dans sa région les habitations de fortune et ne s’être pas employée à empêcher de telles constructions, en dépit du rapport d’expertise du 7 mai 1991 ;
– 2/8 à la charge des habitants du bidonville, pour avoir mis en danger les membres de leurs familles en s’installant à proximité d’une montagne d’ordures ;
– 1/8 à la charge du ministère de l’Environnement, pour avoir omis d’assurer un suivi effectif de l’application conforme au règlement no 20814 sur le contrôle des déchets solides ;
– 1/8
à la charge du gouvernement,
pour avoir favorisé ce type
d’agglomérations, en amnistiant à
plusieurs
reprises les constructions illégales et en octroyant des
titres de propriété à
leurs occupants. »
24. Le 21 mai 1993, le procureur rendit son ordonnance. Il déclina sa compétence ratione personae concernant les autorités administratives dont les responsabilités avaient été établies, à savoir la mairie métropolitaine, la mairie d’Ümraniye, le ministère de l’Environnement et les dirigeants des gouvernements ayant exercé pendant la période 1974-1993. Ainsi, le procureur renvoya l’affaire au préfet d’Istanbul, considérant que celle-ci relevait de la loi sur les poursuites contre les fonctionnaires, dont l’application appartenait au comité administratif départemental de la préfecture d’Istanbul (« le comité administratif »). Cela étant, le procureur précisa dans son ordonnance que, s’agissant des autorités mises en cause, les dispositions à appliquer étaient celles des articles 230 et 455 § 2 du code pénal, qui réprimaient respectivement la négligence dans l’exercice des fonctions publiques et l’homicide par négligence.
Dans la mesure où l’affaire portait sur la responsabilité éventuelle des habitants du bidonville, dont le requérant, lesquels avaient la qualité tant de victimes que d’accusés au regard de l’article 455 § 2 du code pénal, le procureur émit l’avis qu’il était impossible, en l’état du dossier, de disjoindre leurs causes, eu égard aux articles 10 et 15 de la loi susmentionnée.
Le 27 mai 1993, date de clôture de l’enquête préliminaire du conseil d’inspection, le dossier du parquet fut transmis au ministère.
3. L’issue de l’enquête administrative contre les autorités mises en cause
25. Le 27 mai 1993, à la lumière des conclusions de sa propre enquête, le conseil d’inspection demanda au ministère l’autorisation d’ouvrir une instruction pénale contre les deux maires incriminés.
26. Le lendemain de cette demande la mairie d’Ümraniye fit à la presse la communication suivante :
« L’unique déchetterie du côté anatolien se trouvait au milieu de notre district d’Ümraniye, telle une horreur silencieuse. Elle a rompu son silence et provoqué la mort. Nous le savions et nous nous y attendions. En tant que municipalité, nous avions, depuis quatre ans, forcé toutes les portes pour faire déplacer cette déchetterie. La mairie métropolitaine d’Istanbul s’est montrée indifférente. Elle a laissé tomber les travaux d’assainissement (...) après avoir posé deux pelles de béton à l’inauguration. Les ministères et le gouvernement étaient au courant des faits, mais ils n’y ont pas prêté beaucoup d’attention. Nous avions soumis la question aux juges et ils nous avaient donné raison, mais le mécanisme judiciaire n’a pu être mis en action. (...) A l’heure actuelle nous sommes face à nos responsabilités et nous rendrons tous des comptes aux habitants d’Ümraniye (...) »
27. L’autorisation sollicitée par le conseil d’inspection fut accordée le 17 juin 1993 et, par conséquent, un inspecteur en chef auprès du ministère (« l’inspecteur en chef ») fut chargé de l’affaire.
Compte tenu du dossier de l’enquête constitué en l’espèce, l’inspecteur en chef recueillit les dépositions de MM. Sözen et Öktem. Ce dernier déclara, entre autres, qu’en décembre 1989 sa municipalité avait bien entamé des travaux d’assainissement du territoire du bidonville d’Hekimbaşı et que, cependant, ceux-ci avaient été interrompus à la demande de deux habitants de ce quartier (paragraphe 11 ci-dessus).
28. L’inspecteur en chef finalisa son rapport le 9 juillet 1993. Celui-ci entérinait les conclusions de toutes les expertises effectuées jusqu’alors et tenait compte de l’ensemble des éléments réunis par le procureur. Il mentionnait également deux autres avis scientifiques, adressés à la préfecture d’Istanbul en mai 1993, l’un par le ministère de l’Environnement et l’autre par un professeur de génie civil de l’université de Boğaziçi. Ces deux avis confirmaient que le glissement de terrain mortel avait été causé par l’explosion de méthane. Le rapport indiquait en outre que, le 4 mai 1993, le conseil d’inspection avait invité la mairie métropolitaine à lui faire part des mesures effectivement prises à la lumière du rapport d’expertise du 7 mai 1991 et reproduisait la réponse de M. Sözen :
« Notre mairie métropolitaine a, d’une part, pris les mesures nécessaires afin d’assurer que les anciens sites puissent être utilisés de la façon la moins préjudiciable possible jusqu’à fin 1993 et, d’autre part, elle a achevé tous les préparatifs en vue de construire l’une des installations les plus grandes et les plus modernes (...) jamais réalisées dans notre pays. Une autre entreprise consiste à réaliser un site provisoire de stockage de déchets répondant aux conditions requises. Parallèlement à cela, des travaux continuent quant à la réhabilitation des anciens sites [en fin de vie]. En bref, ces trois dernières années, notre mairie s’est très sérieusement penchée sur le problème des déchets (...) [et], actuellement, les travaux continuent (...) »
29. L’inspecteur en chef conclut finalement que la mort de vingt-six personnes et les blessures causées à onze autres (chiffres disponibles à l’époque des faits), survenues le 28 avril 1993, étaient dues à l’inaction des deux maires dans l’exercice de leurs fonctions, et que ceux-ci devaient répondre de leur négligence au regard de l’article 230 du code pénal. Car en dépit notamment du rapport d’expertise et de la recommandation du Conseil de l’environnement, ils avaient, en toute connaissance de cause, méconnu leurs devoirs respectifs : M. Öktem, parce qu’il avait manqué à son obligation de procéder, en vertu du pouvoir que lui conférait l’article 18 de la loi no 775, à la destruction des baraques non autorisées situées aux abords de la décharge, et M. Sözen, parce qu’il avait refusé d’obtempérer à la recommandation susmentionnée, omis de réhabiliter le dépôt d’ordures ou d’ordonner sa fermeture, et n’avait respecté aucune des dispositions de l’article 10 de la loi no 3030, lesquelles exigeaient qu’il procédât à la destruction des taudis en question, le cas échéant par ses propres moyens. Toutefois, dans ses observations, l’inspecteur en chef ne se pencha point sur la question de l’applicabilité, en l’occurrence, de l’article 455 § 2 du code pénal.
4. L’attribution d’un logement social au requérant
30. Dans l’intervalle, la direction de l’habitat et des constructions de fortune invita le requérant à se présenter, l’informant que, par un arrêté (no 1739) du 25 mai 1993, la mairie métropolitaine lui avait attribué un appartement dans le complexe de logements sociaux de Çobançeşme (Eyüp, Alibeyköy). Le 18 juin 1993, le requérant prit possession, contre signature, de l’appartement no 7, au bâtiment C-1 dudit complexe. Cette opération fut régularisée par un arrêté (no 3927) du 17 septembre 1993 de la mairie métropolitaine. Le 13 novembre 1993, le requérant signa une déclaration notariée, tenant lieu de contrat, stipulant que le logement en question lui avait été « vendu » contre la somme de 125 millions de livres turques (TRL), dont un quart était à verser au comptant et le reliquat par des mensualités de 732 844 TRL chacune.
Selon toute vraisemblance, la somme à payer au comptant fut versée à la préfecture d’Istanbul, qui la transmit à la mairie métropolitaine. Le requérant s’acquitta de la première mensualité le 9 novembre 1993 et continua ainsi jusqu’en janvier 1996. Entre-temps, avant le 23 février 1995, il loua son appartement à un certain H.Ö. moyennant des loyers mensuels de 2 millions de TRL. A partir de janvier 1996, l’administration dut, semble-t-il, avoir recours à la procédure d’exécution forcée pour recouvrer le restant des mensualités.
Le 24 mars 1998, le requérant, qui n’avait alors plus de dette envers la mairie métropolitaine, fit à un certain E.B. une promesse de vente notariée concernant son logement en contrepartie de 20 000 marks allemands payés au comptant.
5. L’action publique contre les autorités mises en cause
31. Par une ordonnance du 15 juillet 1993, le comité administratif, sur la base du rapport de l’inspecteur en chef, décida à la majorité de traduire MM. Sözen et Öktem en justice pour infraction à l’article 230 du code pénal.
Ces derniers firent appel de cette décision devant le Conseil d’Etat, qui les débouta de leur demande le 18 janvier 1995. Par conséquent, le dossier de l’affaire fut retourné au procureur qui, le 30 mars 1995, renvoya les deux maires devant la 5e chambre du tribunal correctionnel d’Istanbul.
32. Les débats s’ouvrirent devant la chambre le 29 mai 1995. A l’audience, M. Sözen affirma notamment que personne ne pouvait s’attendre à ce qu’il s’acquitte de devoirs qui ne lui incombaient pas, ni le tenir pour seul responsable d’une situation qui perdurait depuis 1970 ; au demeurant, il allégua que l’on ne devrait pas non plus le blâmer de ne pas avoir réhabilité la décharge d’Ümraniye, dès lors qu’aucun des 2 000 sites en Turquie ne l’avait été ; à ce sujet, faisant valoir un certain nombre de mesures qui avaient néanmoins été prises par la mairie métropolitaine, il soutint qu’un réaménagement définitif de la décharge n’aurait pas pu être réalisé tant que des ordures continuaient à être déposées. Enfin, il déclara : « les éléments constitutifs du délit de négligence dans l’exercice des fonctions ne sont pas réunis, parce que je n’ai pas agi avec l’intention de me montrer négligent [sic] et que l’on ne saurait établir un lien de causalité » entre l’incident et une quelconque négligence de sa part.
Quant à M. Öktem, il soutint que les baraquements ensevelis dataient d’avant son élection, le 26 mars 1989, et qu’il n’avait, après cette date, jamais toléré le développement des quartiers de taudis. Accusant la mairie métropolitaine et la préfecture d’Istanbul d’indifférence face aux problèmes, M. Öktem allégua qu’en réalité la prévention des constructions illégales relevait de la responsabilité des agents forestiers et qu’en tout état de cause sa municipalité manquait d’effectifs pour procéder à la destruction de tels baraquements.
33. Par un jugement du 4 avril 1996, la chambre déclara les deux maires coupables des faits qui leur étaient reprochés, estimant que les moyens de défense qu’ils avaient présentés s’avéraient sans fondement.
Pour parvenir à cette conclusion, les juges du fond se fondèrent notamment sur les preuves qui avaient déjà été recueillies au cours des investigations pénales menées sans relâche du 29 avril 1993 au 9 juillet 1993 (paragraphes 19 et 28 ci-dessus). D’ailleurs, il ressort du jugement rendu le 30 novembre 1995 que, pour déterminer la part de responsabilité de chacune des autorités mises en cause, les juges entérinèrent sans hésiter les conclusions du rapport d’expertise établi à la demande du procureur sur cette question précise, rapport qui était disponible depuis le 18 mai 1993 (paragraphe 23 ci-dessus).
Par ailleurs, les juges relevèrent ce qui suit :
« (...) bien qu’informés du rapport [d’expertise], les deux prévenus n’ont pris aucune mesure préventive effective. A l’image d’une personne tirant sur une foule, qui devrait savoir qu’il y aura des morts et qui, par conséquent, ne saurait prétendre avoir agi sans intention de tuer, les prévenus ne peuvent pas non plus alléguer en l’espèce qu’ils n’avaient pas l’intention de négliger leurs fonctions. On ne saurait pour autant leur imputer toute la faute. (...) Ils se sont montrés négligents tout comme d’autres. En l’espèce, la faute principale consiste à construire des habitations de fortune en aval d’un dépôt d’ordures situé sur une côte, et c’est aux habitants de ces taudis qu’il faut l’imputer. Ces derniers auraient dû prendre en considération le risque que la montagne d’ordures s’effondre un jour sur leur tête et qu’ils en subissent un préjudice. Ils n’auraient pas dû construire des baraques à cinquante mètres du dépôt. Ils ont payé leur légèreté de leur vie (...) »
34. La chambre condamna MM. Sözen et Öktem à la peine d’emprisonnement minimum prévue à l’article 230 du code pénal, à savoir trois mois, ainsi qu’à des amendes de 160 000 TRL. Puis, en application de l’article 4 § 1 de la loi no 647, elle commua les peines d’emprisonnement en des peines d’amendes ; les sanctions finalement prononcées consistaient à payer 610 000 TRL. Convaincue que les prévenus se garderaient de récidiver, la chambre décida également de surseoir à l’exécution de ces peines, conformément à l’article 6 de ladite loi.
35. Les deux maires se pourvurent en cassation. Ils reprochèrent notamment aux juges du fond de s’être livrés à une appréciation des faits allant au-delà de celle qu’appelait l’article 230 du code pénal, comme s’il s’agissait d’un cas d’homicide involontaire au sens de l’article 455 dudit code.
Par un arrêt du 10 novembre 1997, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.
36. Le requérant n’a, selon toute vraisemblance, jamais été informé du déroulement de cette procédure et n’a jamais été entendu par aucun des organes administratifs d’enquête ou par les instances répressives ; aucune décision judiciaire ne semble par ailleurs lui avoir été notifiée.
6. L’action administrative du requérant
37. Le 3 septembre 1993, le requérant saisit les mairies d’Ümraniye et d’Istanbul ainsi que les ministères de l’Intérieur et de l’Environnement, et demanda réparation de son préjudice tant matériel que moral. La somme réclamée par le requérant se ventilait ainsi : 150 millions de TRL à titre de dommages-intérêts du fait de la perte de l’habitation et des biens ménagers ; 2 550 000 000, 10 millions, 15 millions et 20 millions de TRL en réparation de la perte du soutien économique subie par lui-même et ses trois fils survivants, Hüsamettin, Aydın et Halef ; 900 millions de TRL pour lui-même et 300 millions de TRL pour chacun de ses trois fils au titre du préjudice moral du fait de la mort de leurs proches.
38. Par des lettres des 16 septembre et 2 novembre 1993, le maire d’Ümraniye et le ministre de l’Environnement rejetèrent les demandes du requérant. Les autres administrations ne répondirent pas.
39. Le requérant introduisit alors en son propre nom et au nom de ses trois enfants survivants une action en dommages-intérêts devant le tribunal administratif d’Istanbul (« le tribunal ») contre les quatre autorités. Dénonçant leurs négligences à l’origine de la mort de ses proches et de la destruction de sa maison ainsi que de ses biens ménagers, il réclama derechef les sommes susmentionnées.
Le 4 janvier 1994, le requérant fut admis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
40. Le tribunal rendit son jugement le 30 novembre 1995. Se fondant sur le rapport d’expertise du 18 mai 1993 (paragraphe 23 ci-dessus), il constata l’existence d’un lien de causalité direct entre l’accident du 28 avril 1993 et les négligences concourantes des quatre administrations incriminées. En conséquence, il condamna ces dernières à verser au requérant et à ses enfants 100 millions de TRL au titre du préjudice moral et 10 millions de TRL pour dommage matériel (ces sommes équivalaient, à l’époque, à environ 2 077 et 208 euros respectivement).
Ce dernier montant, jugé en équité, était limité à la destruction des biens ménagers, exception faite des appareils électroménagers que le requérant n’était pas censé posséder. A ce sujet, le tribunal semble s’en être tenu à l’argument des administrations, selon lequel « il n’y avait ni eau ni électricité dans ces habitations ». Le tribunal rejeta en outre la demande pour le surplus : d’après lui, l’intéressé ne pouvait arguer d’une privation de soutien économique parce qu’il avait une part de responsabilité dans le dommage engendré et parce que les victimes étaient des enfants en bas âge ou des femmes au foyer n’exerçant aucun emploi rémunéré susceptible de contribuer à la subsistance de la famille. De l’avis du tribunal, le requérant était aussi malvenu de réclamer réparation du fait de la destruction de son taudis, étant donné qu’à la suite de l’accident il s’était vu allouer un logement social et que, même si la mairie d’Ümraniye n’avait pas jusqu’alors exercé son pouvoir de détruire cette baraque, rien n’aurait pu l’empêcher de le faire à n’importe quel moment.
Le tribunal décida enfin de ne pas appliquer d’intérêts moratoires sur l’indemnité accordée pour préjudice moral.
41. Les parties contestèrent ce jugement devant le Conseil d’Etat, qui les débouta par un arrêt du 21 avril 1998.
Le recours en rectification d’arrêt exercé par la mairie métropolitaine n’ayant pas abouti non plus, l’arrêt devint définitif et fut notifié au requérant le 10 août 1998.
42. Les indemnités en question demeurent impayées à ce jour.
7. L’issue des poursuites pénales contre les habitants du bidonville
43. Le 22 décembre 2000 entra en vigueur la loi no 4616, qui prévoyait le sursis à l’exécution des mesures judiciaires pendantes concernant certaines infractions commises avant le 23 avril 1999.
Le 22 avril 2003, le ministère de la Justice informa le parquet d’Istanbul qu’il avait été impossible de clore l’enquête pénale en cours contre les habitants du bidonville, que la seule décision les concernant s’avérait être l’ordonnance d’incompétence rendue le 21 mai 1993 et que l’infraction reprochée en l’espèce serait prescrite le 28 avril 2003.
Partant, le 24 avril 2003, le parquet d’Istanbul décida de surseoir à l’ouverture d’une action pénale contre les intéressés, dont le requérant, et quatre jours plus tard l’action pénale fut prescrite dans leur chef.
II. LE
DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le droit pénal turc
44. Les dispositions pertinentes du code pénal se lisent ainsi :
Article 230 §§ 1 et 3
« Tout agent de l’Etat qui, dans l’exercice de ses fonctions publiques, (...) fait preuve de négligence et de retard ou qui, sans raison valable, refuse d’obtempérer aux ordres légitimes (...) de ses supérieurs est passible d’une peine d’emprisonnement allant de trois mois à un an ainsi que d’une amende allant de 6 000 à 30 000 livres turques.
(...)
Dans tous les (...) cas, si des tiers ont subi un quelconque préjudice du fait de la négligence ou du retard du fonctionnaire mis en cause, celui-ci sera également tenu de le réparer. »
Article 455 §§ 1 et 2
« Quiconque, par imprudence, négligence ou inexpérience dans sa profession ou son art, ou par inobservation des lois, ordres ou prescriptions, cause la mort d’autrui est passible d’une peine d’emprisonnement allant de deux à cinq ans ainsi que d’une amende allant de 20 000 à 150 000 livres turques.
Si l’acte a causé la mort de plusieurs personnes ou a été à l’origine de la mort d’une personne et des blessures d’une ou plusieurs autres (...), l’auteur sera condamné à une peine d’emprisonnement allant de quatre à dix ans ainsi qu’à une lourde amende de 60 000 livres turques minimum. »
Article 29 § 8
« Le juge a toute latitude pour fixer la peine principale, dont le quantum peut varier entre un minimum et un maximum, en tenant compte d’éléments tels que les circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, le moyen utilisé pour la commettre, l’importance et la gravité de l’infraction, le moment et le lieu où elle a été commise, les diverses particularités de l’acte, la gravité du préjudice causé et du risque [entraîné], le degré de l’intention [criminelle] (...), les raisons et desseins ayant conduit à l’infraction, le but, les antécédents, le statut personnel et social de son auteur ainsi que son comportement à la suite de l’acte [commis]. Même dans le cas où la peine infligée correspond au quantum minimum, les motifs de ce choix sont obligatoirement mentionnés dans le jugement. »
Article 59
« Si le tribunal considère qu’il y a, en dehors des excuses atténuantes, des circonstances atténuantes militant pour une réduction de la peine [infligée] à l’auteur, la peine capitale sera commuée en réclusion à perpétuité et la réclusion à perpétuité en une peine d’emprisonnement de trente ans.
Les autres peines seront réduites d’un sixième au maximum. »
45. Les articles 4 § 1 et 6 § 1 de la loi no 647 sur l’exécution des peines se lisent ainsi :
Article 4 § 1
« Hormis la réclusion criminelle, le tribunal peut, eu égard à la personnalité et à la situation de l’inculpé ainsi qu’aux circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, commuer les peines privatives de liberté de courte durée :
1) en une amende lourde (...) à raison d’un montant allant de 5 000 à 10 000 livres turques par jour ;
(...) »
Article 6 § 1
« Quiconque n’ayant jamais été condamné (...) à une peine autre qu’une amende se voit infliger (...) une amende (...) et/ou une peine d’emprisonnement d’un an [maximum] peut bénéficier d’un sursis à l’exécution de cette peine, si le tribunal est convaincu que [l’auteur], compte tenu de [sa] tendance à transgresser la loi, se gardera de récidiver si on lui accorde un tel sursis (...) »
46. Aux
termes du code de procédure pénale (CPP), un
procureur de la République qui –
de quelque manière que ce soit – est
avisé d’une situation permettant de
soupçonner qu’une infraction a
été commise est tenu d’instruire les
faits afin
de décider s’il y a lieu ou non
d’engager des poursuites (article 153 CPP).
Cependant, si l’auteur présumé
d’une infraction est un agent de la fonction
publique et si l’acte a été commis dans
le cadre de ses fonctions, l’instruction
de l’affaire dépend de la loi de 1914 sur les
poursuites contre les
fonctionnaires, laquelle limite la compétence ratione
personae du ministère public quant à
cette phase de la
procédure. En pareil cas, l’enquête
préliminaire et, par conséquent,
l’autorisation
d’ouvrir des poursuites pénales seront du ressort
du comité administratif local
concerné (celui de la sous-préfecture ou du
département selon le statut de
l’intéressé).
Les décisions desdits comités sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat ; la saisine est d’office si l’affaire est classée sans suite.
47. Le
droit pénal turc prévoit l’intervention
des plaignants dans les procédures
pénales. L’article 365 CPP contient une
disposition permettant à un plaignant
et à quiconque s’estimant
lésé du fait d’une infraction de se
constituer
« partie intervenante » dans une
action publique déjà ouverte par le
parquet et, ainsi, d’agir aux côtés de
l’accusation. Il appartient au juge,
après consultation du parquet, de se prononcer sur la
recevabilité de la
constitution de partie intervenante (article 366 CPP).
48. Si
la demande est accueillie, la partie intervenante peut, entre autres,
réclamer
– en sa qualité de victime directe –
réparation de ses préjudices résultant
de
l’infraction. Le bénéfice de cette
possibilité du droit turc – du reste,
comparable à celles qu’offrent la
« constitution de partie civile »
ou « l’action civile »
prévues dans les droits de nombreux Etats
membres du Conseil de l’Europe – dépend
néanmoins du respect de quelques règles
précises. D’après la jurisprudence de
la Cour de cassation, pour qu’il soit
statué sur des dommages-intérêts du
fait d’une infraction, la personne
lésée
doit non seulement se constituer partie intervenante, mais
également
revendiquer explicitement son droit à réparation.
En droit turc, cette demande
n’est donc pas considérée comme
étant incorporée à la constitution de
partie
intervenante. Il n’est pas obligatoire que la
réparation soit revendiquée au
moment où la personne se constitue partie
intervenante : elle pourrait l’être
ultérieurement, mais à condition
qu’aucune action en dommages-intérêts
n’ait
été introduite auparavant devant les juridictions
civiles ou administratives.
De plus, toute demande d’indemnité, au sens de
l’article 358 CPP (ou de l’article
365 § 2) doit être chiffrée et
justifiée car, dans l’appréciation de
telles
demandes, les juges répressifs sont appelés
à appliquer les règles de droit
civil en la matière, au nombre desquelles figure
l’interdiction de juger
au-delà du montant réclamé en
l’occurrence. La condamnation de
l’inculpé est
nécessaire pour statuer sur le droit à
indemnité de la partie intervenante.
B. Les voies administratives et civiles contre les agents de l’Etat
1. La justice administrative
49. S’agissant
de la responsabilité civile et administrative du fait
d’actes criminels et
délictuels,
l’article 13 de la loi no 2577
sur la procédure administrative énonce que toute
victime d’un dommage résultant
d’un acte de l’administration peut demander
réparation à cette dernière dans le
délai d’un an à compter de la date de
l’acte allégué. En cas de rejet de tout
ou partie de la demande ou si aucune réponse n’a
été obtenue dans un délai de
soixante jours, la victime peut engager une procédure
administrative.
Le statut des juges ainsi que l’organisation des tribunaux administratifs sont régis par la loi no 2576 du 6 janvier 1982 sur les compétences et la constitution des tribunaux administratifs et par la loi no 2575 sur le Conseil d’Etat.
2. La justice civile
50. En vertu du code des obligations, les personnes lésées du fait d’un acte illicite ou délictueux peuvent introduire une action en réparation pour le préjudice tant matériel (articles 41-46) que moral (article 47). En la matière, les tribunaux civils ne sont liés ni par les considérations ni par le verdict des juridictions répressives sur la culpabilité de l’intéressé (article 53).
Toutefois, en vertu de l’article 13 de la loi no 657 sur les fonctionnaires de l’Etat, les personnes ayant subi un dommage du fait de l’exercice d’une fonction relevant du droit public peuvent en principe assigner en justice uniquement l’autorité publique dont relève le fonctionnaire en cause et non directement celui-ci (articles 129 § 5 de la Constitution, et 55 et 100 du code des obligations). Cette règle n’est toutefois pas absolue. Lorsque l’acte en question est qualifié d’illicite ou de délictueux et, par conséquent, perd son caractère d’acte ou de fait « administratif », les juridictions civiles peuvent accueillir une demande de dommages-intérêts dirigée contre l’auteur lui-même, sans préjudice de la possibilité d’engager la responsabilité conjointe de l’administration en sa qualité d’employeur de l’auteur de l’acte (article 50 du code des obligations).
C. L’exécution des décisions judiciaires par l’administration
51. Aux termes de l’article 138 § 4 de la Constitution de 1982 :
« Les organes des pouvoirs exécutif et législatif ainsi que l’administration sont tenus de se conformer aux décisions judiciaires ; lesdits organes et l’administration ne peuvent en aucun cas modifier les décisions judiciaires ni en différer l’exécution. »
L’article 28 § 2 du code de procédure administrative dispose :
« Les décisions rendues relativement aux recours de pleine juridiction et concernant un montant déterminé sont exécutées (...) conformément aux dispositions du droit commun. »
D’après l’article 82 § 1 de la loi no 2004 sur les voies d’exécution et la faillite, ne peuvent faire l’objet d’une saisie les biens de l’Etat et les biens qui, selon la loi les régissant, sont insaisissables. Il ressort de l’article 19 § 7 de la loi no 1580 du 3 avril 1930 sur les municipalités que les biens de ces dernières peuvent être saisis uniquement s’ils ne sont pas affectés à l’usage public.
Selon la doctrine turque en la matière, il découle des dispositions ci‑dessus que si l’administration n’obtempère pas d’elle-même à une décision judiciaire de réparation définitive et exécutoire, l’intéressé a la possibilité d’intenter une procédure d’exécution forcée conformément au droit commun. Dans ce cas, l’autorité compétente est habilitée à imposer à l’administration les mesures prévues par la loi no 2004, la saisie demeurant toutefois exceptionnelle.
D. La réglementation des constructions non autorisées et des décharges d’ordures ménagères
1. La Constitution
52. Les dispositions pertinentes de la Constitution en matière d’environnement et de logement se lisent ainsi :
Article 56
« Toute personne a le droit de vivre dans un environnement sain et équilibré.
L’Etat et les citoyens ont le devoir d’améliorer l’environnement, d’en préserver la salubrité et d’en empêcher la pollution.
En vue de garantir à chacun des conditions de vie physiques et psychologiques saines, (...) l’Etat instaure lui-même des institutions sanitaires et réglemente leurs prestations de services.
L’Etat s’acquitte de cette tâche en utilisant les institutions sanitaires et sociales des secteurs privé et public, et en assurant le contrôle de celles-ci. (...) »
Article 57
« L’Etat prend les mesures propres à remédier aux besoins de logement, dans le cadre d’une planification tenant compte des particularités des villes et des conditions de l’environnement, et favorise en outre les programmes de logements collectifs. »
Article 65
« L’Etat s’acquitte des tâches que la Constitution lui assigne en matière sociale et économique, dans les limites de ses ressources financières et en veillant à préserver la stabilité économique. »
2. Les bidonvilles et la législation les concernant
53. D’après les informations et documents dont la Cour dispose, depuis 1960, année où commencèrent des migrations massives d’habitants des zones défavorisées vers les régions riches, la Turquie doit faire face au problème des bidonvilles, constitués le plus souvent de baraquements édifiés en dur et évoluant rapidement vers des constructions à étages. Actuellement, plus d’un tiers de la population vivrait dans des habitations de ce type. Les chercheurs, qui se sont penchés sur ce problème, affirment que la naissance de telles agglomérations ne saurait s’expliquer seulement par les défaillances de l’aménagement urbain et de la police municipale. Ils signalent l’existence de plus de dix-huit lois d’amnistie promulguées au fil du temps afin de régulariser les quartiers de taudis, dans l’optique, selon eux, de satisfaire les électeurs potentiels vivant dans ces habitations de fortune.
54. Dans le domaine de la lutte contre le développement des bidonvilles, les principales dispositions légales en droit turc sont les suivantes :
Selon l’article 15 § 2, alinéa 19, de la loi no 1580 du 3 avril 1930 sur les municipalités, ces dernières sont tenues d’empêcher et d’interdire toute installation ou construction, contraire à la loi et aux règlements, qui serait établie sans permis ou porterait atteinte à la santé, à l’ordre et à la quiétude de la ville.
La loi no 775 du 20 juillet 1966 énonce dans son article 18 qu’après son entrée en vigueur, tout bâtiment non autorisé, qu’il soit en phase de construction ou déjà habité, sera immédiatement détruit sans qu’une décision préalable soit nécessaire. La mise en œuvre de ces mesures incombe aux autorités administratives, lesquelles peuvent avoir recours aux forces de l’ordre et aux autres moyens de l’Etat. Pour ce qui est des baraquements réalisés avant l’entrée en vigueur de la loi, l’article 21 de celle-ci prévoit que, sous certaines conditions, les habitants des taudis pourront acquérir le terrain qu’ils occupent et profiter de crédits avantageux pour financer la construction de bâtiments conformes aux normes et aux plans d’urbanisme. Les agglomérations où les dispositions de l’article 21 sont applicables sont déclarées « zones de réhabilitation et d’éradication des taudis » et gérées conformément à un plan d’action.
Par une loi no 1990 du 6 mai 1976 portant modification de la loi no 775, les constructions irrégulières effectuées avant le 1er novembre 1976 furent elles aussi considérées comme couvertes par l’article 21 susmentionné. La loi no 2981 du 24 février 1984 concernant les constructions non conformes à la législation en matière de bidonvilles et d’aménagement urbain prévoyait également des mesures à prendre pour la conservation, la régularisation, la réhabilitation et la destruction des bâtiments irréguliers érigés jusqu’alors.
Concernant les biens publics, l’article 18 § 2 de la loi no 3402 du 21 juin 1987 sur le cadastre se lit ainsi :
« La prescription acquisitive ne joue pas pour les biens communs, (...) les forêts et les lieux à la disposition de l’Etat et affectés à l’usage public ni pour les biens immobiliers qui, d’après les lois les concernant, reviennent à l’Etat, que ces biens soient inscrits ou non au registre foncier. »
55. Cependant, la loi no 4706 du 29 juin 2001 portant consolidation de l’économie turque, telle que modifiée par la loi no 4916 du 3 juillet 2003, a autorisé sous certaines conditions la vente aux tiers des biens immobiliers appartenant au Trésor public. D’après l’article 4 §§ 6 et 7 de cette loi, les biens appartenant au Trésor et abritant des constructions réalisées avant le 31 décembre 2000 seront transmis à titre gratuit aux municipalités dont dépendent les terrains sur lesquels sont situées les constructions, afin d’être vendus préférentiellement aux propriétaires de ces constructions ou à leurs ayants droit. Les ventes en question s’effectuent moyennant un acompte correspondant au quart de la valeur marchande du terrain et des mensualités pouvant être étalées sur trois ans.
Les municipalités sont tenues de procéder à l’élaboration des plans d’occupation des sols ainsi que des plans d’application concernant les biens qui leur ont été aliénés au titre de la loi susmentionnée.
3. Les sites de stockage de déchets ménagers et leur réglementation
56. D’après l’article 15 § 2, alinéa 24, de la loi no 1580 susmentionnée, il incombe aux mairies d’assurer le ramassage régulier et approprié des ordures ménagères ainsi que leur destruction. Conformément aux articles 6-E, alinéa j), de la loi no 3030 sur les mairies métropolitaines et 22 du règlement d’administration publique relatif à cette loi, il incombe aux mairies métropolitaines de désigner les lieux de stockage des ordures et des déchets industriels ainsi que de réaliser ou de faire réaliser les installations concernant le traitement, le recyclage et la destruction de ces derniers.
Selon les articles 5 et 22 du règlement sur le contrôle des déchets solides, publié au Journal officiel du 14 mars 1991, les mairies sont responsables de la planification de l’utilisation des décharges ainsi que de la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires afin d’éviter que leur exploitation ne nuise à l’environnement et à la santé des hommes et des animaux ; d’après l’article 31 dudit règlement, la mairie métropolitaine est habilitée à délivrer les autorisations d’exploitation des sites de stockage de déchets sis dans les territoires des mairies locales dépendant de son autorité.
Aux termes du règlement, aucun site de décharge d’ordures ne peut être créé à une distance de moins de 1 000 m des habitations et, une fois ouverte à l’exploitation, aucune construction ne peut être autorisée à la périphérie du site (article 24), lequel doit être clôturé (article 25). Concernant le contrôle du biogaz, l’article 27 prévoit que :
« Les mélanges d’azote, d’ammoniaque, d’hydrogène sulfuré, de dioxyde de carbone et, en particulier, le méthane, issus de la décomposition microbiologique des éléments organiques présents dans la masse des déchets (...) et susceptibles de causer des explosions et intoxications seront captés à l’aide d’un système de drainage vertical et horizontal, et libérés dans l’atmosphère de façon contrôlée ou utilisés pour produire de l’énergie. »
57. Les informations générales que la Cour a pu se procurer quant au risque d’explosion de méthane dans de tels sites peuvent se résumer comme suit : le méthane (CH4) et le gaz carbonique (CO2) sont les deux produits majeurs de la méthanogénèse, l’étape finale et la plus longue du processus de fermentation anaérobie, c’est-à-dire qui se déroule en l’absence d’air. Ces substances sont notamment générées par les dégradations biologiques et chimiques des déchets. Les risques d’explosion et d’incendie sont principalement dus à la grande proportion de méthane dans le biogaz. Son seuil d’explosibilité se situe entre 5 % et 15 % de CH4 dans l’air. Au-dessus de 15 %, le méthane s’enflamme mais n’explose pas.
58. Il ressort de diverses circulaires et réglementations en vigueur dans les pays membres du Conseil de l’Europe en matière de gestion des ordures ménagères et d’exploitation des décharges de résidus urbains que l’isolement des sites de décharge, qui implique un éloignement minimum de toute habitation, la prévention des risques d’éboulements par pose de talus et de digues stables ainsi que par des mesures de compactage, et l’élimination du danger de feu ou d’explosion du biogaz figurent parmi les préoccupations majeures des autorités et des exploitants concernés.
Sur ce
dernier point, l’assainissement
préconisé
semble consister à mettre en
place, au fur
et à mesure de l’exploitation, un
système de drainage des gaz de fermentation,
visant à assurer le pompage des gaz de décharge
et le traitement
du gaz
par un biofiltre. Pareille installation de dégazage,
prévue également dans le règlement du 14 mars 1991 en
vigueur en Turquie,
comprend généralement des
puits verticaux perforés introduits par forage dans
les déchets ou des drains horizontaux enfouis dans la masse
des déchets, une
station de ventilation, un biofiltre et un réseau de
conduites d’aspiration.
III. LES TEXTES PERTINENTS DU CONSEIL DE L’EUROPE
59. Concernant les divers textes adoptés par le Conseil de l’Europe dans le domaine de l’environnement et des activités industrielles des pouvoirs publics, il y a lieu de citer, parmi les travaux de l’Assemblée parlementaire, la Résolution 587 (1975) relative aux problèmes posés par l’évacuation de déchets urbains et industriels, la Résolution 1087 (1996) relative aux conséquences de l’accident de Tchernobyl, et la Recommandation 1225 (1993) relative à la gestion, au traitement, au recyclage et à la commercialisation des déchets, ainsi que, parmi les travaux du Comité des Ministres, la Recommandation no R (96) 12 concernant la répartition des compétences et des responsabilités entre autorités centrales et collectivités locales et régionales dans le domaine de l’environnement.
En la matière, il convient également de mentionner la Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant des activités dangereuses pour l’environnement (STE no 150 – Lugano, 21 juin 1993) et la Convention sur la protection de l’environnement par le droit pénal (STE no 172 – Strasbourg, 4 novembre 1998), lesquelles sont actuellement signées par neuf et treize Etats respectivement.
60. On constate en lisant ces documents qu’en ce qui concerne le traitement des déchets urbains la responsabilité première incombe aux collectivités locales, que les gouvernements sont tenus d’assister tant financièrement que techniquement. L’exploitation d’un site de stockage de déchets par des autorités publiques passe pour une « activité dangereuse », et un « décès » résultant du dépôt de déchets sur un site de stockage permanent est considéré comme un « dommage » entraînant la responsabilité des autorités publiques (voir, notamment, la Convention de Lugano, article 2 §§ 1, c)-d) et 7, a)-b)).
61. A ce sujet, la Convention de Strasbourg invite les Parties à adopter des mesures « qui pourraient être nécessaires pour qualifier d’infractions pénales » les actes relevant du domaine « de l’élimination, du traitement, du stockage (...) de déchets dangereux qui causent ou sont susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes (...) », sachant que ces infractions peuvent aussi être commises par « négligence » (articles 2 à 4). Si cet instrument n’est pas encore entré en vigueur, il s’inscrit bien dans la tendance actuelle à réprimer plus sévèrement les atteintes à l’environnement, question indissociable de celle des atteintes à la vie humaine (voir, par exemple, la décision-cadre no 2003/80 du 27 janvier 2003 du Conseil de l’Union européenne ainsi que la proposition de directive de la Commission de l’Union européenne du 13 mars 2001, modifiée le 30 septembre 2002, relative à la protection de l’environnement par le droit pénal).
L’article 6 de ladite Convention exige en outre que des mesures appropriées soient également prises pour sanctionner pénalement ces infractions en fonction de leur degré de gravité, ce qui doit permettre, entre autres, l’emprisonnement des auteurs.
62. S’agissant de telles activités dangereuses, l’accès du public à une information claire et exhaustive est considéré comme l’un des droits fondamentaux de la personne, étant entendu qu’en vertu notamment de la Résolution 1087 (1996) précitée ce droit ne doit pas être conçu comme se limitant au domaine des risques liés à l’utilisation de l’énergie nucléaire dans le secteur civil.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
63. Le requérant se plaint de ce que la mort de ses neuf proches dans l’accident du 28 avril 1993 et les lacunes que présentaient les procédures y afférentes ont emporté violation de l’article 2 de la Convention, dont le passage pertinent se lit ainsi :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
(...) »
64. Comme devant la chambre, le Gouvernement combat ces thèses.
A. Applicabilité
1. L’arrêt de la chambre
65. Se référant aux exemples fournis notamment par les arrêts L.C.B. c. Royaume-Uni (9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑III), Guerra et autres c. Italie (19 février 1998, Recueil 1998-I), Botta c. Italie (24 février 1998, Recueil 1998-I) et Calvelli et Ciglio c. Italie ([GC], no 32967/96, CEDH 2002-I), ainsi qu’aux normes européennes dans ce domaine, la chambre a souligné que la protection du droit à la vie, telle que l’exige l’article 2 de la Convention, pouvait être invoquée en matière d’exploitation de déchetteries du fait des dangers potentiels inhérents à cette activité. Aussi la chambre a-t-elle conclu que l’obligation positive pour les Etats de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction, au sens de l’article 2, entrait en jeu en l’espèce.
2. Arguments des comparants
66. Le Gouvernement allègue que la conclusion de la chambre selon laquelle « toutes les situations de mort non intentionnelle » relèvent du champ d’application de l’article 2 a donné lieu à une extension sans précédent des obligations positives intrinsèques à cette disposition. D’après lui, le raisonnement de la chambre s’écarte de la jurisprudence récente de la Cour en la matière, telle que l’arrêt Mastromatteo c. Italie ([GC], no 37703/99, CEDH 2002-VIII), et n’est pas corroboré par les affaires auxquelles elle se réfère, notamment Osman c. Royaume-Uni (arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII) ou encore Calvelli et Ciglio (arrêt précité), qui n’ont pas abouti à un constat de violation de l’article 2.
67. A l’audience, le Gouvernement a plaidé que la responsabilité de l’Etat pour des faits non imputables directement à ses agents ne pouvait couvrir tous les cas d’accidents ou de catastrophes et qu’en pareil cas l’interprétation de la Cour quant à l’application de l’article 2 ne devait être ni téléologique ni large, mais devait plutôt demeurer restrictive. Une approche contraire pourrait donner à croire que le seul fait de se trouver à proximité d’un aéroport, d’une centrale nucléaire, d’une usine d’armement ou simplement d’être exposé à des produits chimiques serait susceptible de générer une violation potentielle de l’article 2.
68. Le requérant rétorque que les négligences en cause des autorités de l’Etat tombent assurément sous le coup de l’article 2 de la Convention, dès lors qu’elles sont à l’origine de la mort de ses proches, et que rien dans les arguments du Gouvernement ne permet d’écarter cette conclusion.
3. Appréciation de la Cour
69. Considérant l’ensemble des arguments des parties, la Cour rappelle d’emblée que, dans sa manière d’aborder l’interprétation de l’article 2, elle est guidée par l’idée que l’objet et le but de la Convention, en tant qu’instrument de protection des êtres humains, appellent à comprendre et à appliquer ses dispositions d’une manière qui rende ses exigences concrètes et effectives (voir, par exemple, Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2429, § 64).
70. En l’espèce, le grief dont la Cour est saisie est que les autorités nationales n’ont pas fait tout ce qu’on pouvait attendre d’elles pour empêcher que la vie des proches du requérant ne fût perdue lors de l’accident du 28 avril 1993 survenu dans la décharge municipale d’Ümraniye, exploitée sous leur contrôle.
71. A cet égard, la Cour réaffirme que l’article 2 ne concerne pas exclusivement les cas de mort d’homme résultant de l’usage de la force par des agents de l’Etat mais implique aussi, dans la première phrase de son premier paragraphe, l’obligation positive pour les Etats de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction (voir, par exemple, L.C.B. c. Royaume-Uni, précité, p. 1403, § 36, et Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 54, CEDH 2002-II).
Pour la Cour, cette obligation doit être interprétée comme valant dans le contexte de toute activité, publique ou non, susceptible de mettre en jeu le droit à la vie, a fortiori pour les activités à caractère industriel, dangereuses par nature, telles que l’exploitation de sites de stockage de déchets (ci-après « activités dangereuses » – pour les normes européennes en la matière, voir les paragraphes 59 et 60 ci-dessus).
72. Lorsque les organes de la Convention ont eu à se prononcer dans de tels domaines sur des allégations tirées d’une méconnaissance du droit à la protection de la vie, ils n’ont jamais énoncé que l’article 2 s’avérait inapplicable. La Cour renvoie, par exemple, aux cas relatifs à l’incidence des émissions nocives émanant d’une usine de fertilisants (Guerra et autres, précité, pp. 228-229, §§ 60 et 62) ou encore à des essais nucléaires (L.C.B. c. Royaume-Uni, précité, p. 1403, § 36).
73. A cet égard, et contrairement à ce que le Gouvernement semble suggérer, le degré de nocivité des phénomènes propres à telle ou telle activité, la contingence du risque auquel le requérant était exposé à raison des circonstances dangereuses pour la vie, le statut des personnes impliquées dans l’enchaînement de ces circonstances et le caractère délibéré ou non des actes ou omissions imputables à ces personnes ne sont que des éléments parmi d’autres à prendre en compte dans l’examen au fond d’une affaire donnée, visant à déterminer la responsabilité pouvant incomber à l’Etat en vertu de l’article 2 (ibidem, pp. 1403-1404, §§ 37-41).
La Cour reviendra ultérieurement sur ces points.
74. En somme, elle juge que le grief du requérant (paragraphe 70 ci‑dessus) relève assurément de la première phrase de l’article 2, lequel est donc applicable dans la présente affaire.
B. Observation
1. L’arrêt de la chambre
75. La chambre a relevé qu’en l’espèce les autorités compétentes non seulement avaient refusé de s’employer effectivement à pallier les risques graves d’exploitation signalés dans le rapport d’expertise du 7 mai 1991, mais de plus n’avaient pas cherché à dissuader le requérant de vivre à proximité de la déchetterie à l’origine de ces risques. La chambre a aussi relevé que les autorités gouvernementales avaient manqué à leur devoir d’informer les habitants du quartier de Kazım Karabekir des dangers que présentait pour eux le fait de continuer à résider à proximité d’une déchetterie.
Partant, elle a constaté l’existence d’un lien de causalité entre les négligences imputables aux autorités turques, d’une part, et la survenance de l’accident du 28 avril 1993, donc les pertes en vies humaines qui en ont résulté, d’autre part. Ainsi, elle est parvenue à la conclusion que dans la présente affaire les autorités turques ne pouvaient passer pour avoir fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir la matérialisation des dangers réels qui menaçaient en leur vie les habitants de certains quartiers de taudis d’Ümraniye.
76. La chambre a ensuite examiné le grief tiré des défaillances de la justice pénale et administrative turque sous l’angle des « obligations procédurales » de l’article 2, afin de déterminer si le requérant pouvait passer pour avoir obtenu le redressement de ses griefs.
Quant à la procédure pénale, la chambre a conclu que celle-ci ne pouvait en soi être considérée comme « adéquate » s’agissant des allégations d’atteinte au droit à la vie du requérant, parce qu’elle ne visait qu’à établir l’éventuelle responsabilité des autorités pour « négligence dans l’exercice de leurs fonctions », mais pas pour les décès dénoncés en l’espèce.
En ce qui concerne la voie administrative de réparation, la chambre a d’abord constaté un manquement à l’exigence de célérité, observant que le droit à réparation du requérant n’avait été reconnu que quatre ans, onze mois et dix jours après le rejet de ses demandes préalables d’indemnisation. D’ailleurs, elle a relevé que si le requérant s’était finalement vu octroyer une indemnité, celle-ci n’a jamais été versée.
Partant, la chambre a conclu que les voies de droit exercées sur le plan national, même considérées dans leur ensemble, ne pouvaient, dans les circonstances spécifiques de la cause, passer pour avoir assuré le redressement approprié des griefs du requérant au regard de l’article 2 de la Convention.
2. Arguments des comparants
a) Le Gouvernement
77. Le Gouvernement soutient avant tout que l’élément qui fut déterminant dans l’appréciation de la chambre était un rapport d’expertise établi le 7 mai 1991, qui a donné lieu à un conflit entre les mairies et n’a jamais eu la qualité de preuve au regard du droit interne. Cette appréciation, qui se caractérise par une absence de vérification des critères d’« immédiateté » et de « réalité » du danger qu’aurait présentée la décharge municipale, ne saurait suffire à motiver le constat de violation de la chambre, selon laquelle les autorités auraient dû prendre des mesures préventives ou intervenir de façon immédiate et ponctuelle.
A cet égard, le Gouvernement souligne que la gestion des difficultés et la recherche de solutions pour y remédier relèvent des politiques générales des Etats, sans que ceux-ci aient l’obligation de prendre des mesures préventives là où il n’est pas question d’un danger imminent, au sens de la jurisprudence de la Cour.
78. En ce qui concerne plus particulièrement les affaires relatives à une négligence de la part des autorités, le Gouvernement, invoquant notamment les décisions Leray et autres c. France (no 44617/98, 16 janvier 2001), et Álvarez Ramón c. Espagne (no 51192/99, 3 juillet 2001), plaide que la Cour s’est toujours contentée de rechercher s’il existait un cadre réglementaire et si celui-ci était respecté, sans pour autant procéder à un examen approfondi de l’existence d’un lien de causalité entre le ou les décès en question et tel ou tel comportement négligent. Au contraire, dans ces affaires, elle aurait repris à son compte les conclusions et l’appréciation des autorités nationales.
79. Le Gouvernement soutient qu’en tout cas on ne saurait reprocher à l’Etat d’avoir méconnu en l’espèce son obligation de protéger la vie des proches de M. Öneryıldız. Comme il l’a fait devant la chambre, il invoque les efforts déployés par la mairie d’Ümraniye sur les plans judiciaire et administratif ainsi qu’en matière d’information et ce, bien avant le rapport d’expertise du 7 mai 1991, afin d’endiguer l’habitat sauvage, d’encourager les habitants du bidonville d’Ümraniye à trouver d’autres solutions de logement et de pallier les risques sanitaires menaçant le quartier en aspergeant sans relâche des produits chimiques sur la décharge municipale. D’autre part, il rappelle le projet d’aménagement colossal que la mairie métropolitaine avait entrepris en matière de gestion des ordures ménagères sur l’ensemble du territoire de la préfecture d’Istanbul (paragraphe 16 ci-dessus).
80. Aussi le Gouvernement, invoquant l’affaire Chapman c. Royaume‑Uni ([GC], no 27238/95, CEDH 2001-I), critique-t-il l’approche de la chambre, estimant que celle-ci n’a aucunement tenu compte du fait que le requérant avait sciemment choisi, en toute illégalité, de s’installer à proximité d’une décharge malgré les risques inhérents à un tel choix, et s’est contentée de blâmer les autorités nationales de ne pas s’être appuyées sur les conclusions du rapport du 7 mai 1991 pour déloger de façon expéditive, au mépris de toute considération humanitaire, des milliers de citoyens, réaménager toute une commune et déplacer du jour au lendemain tout un site de décharge exploité depuis plus de vingt ans.
Sur ce point, le Gouvernement souligne que des tâches de cette ampleur s’inscrivent dans le cadre de politiques nécessitant des choix et des investissements considérables, qui exigent une longue phase d’étude et de décision ainsi que d’immenses travaux de conception et de mise en œuvre. Dans ces conditions, la Cour n’a pas qualité pour imposer sa propre appréciation sur ce qui aurait pu être la meilleure politique à adopter face aux difficultés sociales et conjoncturelles soulevées par le bidonville d’Ümraniye, parmi lesquelles la résistance connue des habitants envers toute mesure susceptible de menacer leur quotidien.
81. Quant à la procédure pénale menée en l’espèce, le Gouvernement rappelle les conclusions de la Cour dans l’affaire Leray et autres (décision précitée), où elle n’a pas hésité à écarter le grief des requérants selon lequel les autorités françaises avaient commis des fautes lourdes qui avaient coûté la vie à vingt-trois personnes.
82. Invoquant les arrêts Calvelli et Ciglio et Mastromatteo susmentionnés, il affirme aussi que lorsqu’une atteinte au droit à la vie n’est pas volontaire l’obligation positive découlant de l’article 2 n’exige pas nécessairement la mise en œuvre d’une procédure pénale. Or, dans la présente affaire, une telle procédure a été engagée et, dès l’ouverture de l’enquête jusqu’au terme du procès, la justice pénale turque a fait preuve d’une grande efficacité et d’une diligence qui ne prêtent pas le flanc à la critique sous l’angle de l’article 2 de la Convention. A ce sujet, le Gouvernement conteste tout argument tiré d’une impunité accordée aux maires mis en cause : l’application du seul article 230 du code pénal aux prévenus découlait de « la nature spécifique du délit défini dans cet article » qui visait uniquement les agents publics, et le fait que les juges du fond ont prononcé la peine minimale prévue s’expliquait par l’existence de coauteurs présumés n’ayant pas été mis en accusation.
83. A l’audience, le Gouvernement a particulièrement souligné que la non-participation – du reste volontaire – du requérant aux investigations préliminaires ne saurait en aucun cas être considérée comme préjudiciable à l’efficacité de la procédure pénale, eu égard notamment aux conclusions de la Cour dans l’affaire Tanrıbilir c. Turquie (no 21422/93, § 85, 16 novembre 2000). D’ailleurs, le requérant, qui n’a jamais prétendu avoir été dans l’impossibilité d’intervenir dans le procès, serait malvenu d’affirmer n’avoir pas été informé d’un procès intenté contre deux personnalités politiques, l’événement ayant fait l’objet d’une importante couverture médiatique.
84. Quant à la voie de réparation administrative exercée en l’espèce, le Gouvernement rappelle que la procédure en cause s’est soldée par une condamnation sans complaisance des maires responsables à verser au requérant une indemnité en réparation de son préjudice, tant moral que matériel, et que la somme allouée à ce titre est toujours à la disposition de l’intéressé.
b) Le requérant
85. Le requérant réitère les arguments qu’il avait développés devant la chambre et réaffirme que le Gouvernement avait toléré la formation du bidonville d’Ümraniye sans empêcher son extension jusqu’à proximité des tas d’ordures. Selon l’intéressé, le Gouvernement a même favorisé cette situation en permettant aux habitants de bénéficier de tous les services d’infrastructure et, pour parachever son dessein politique, il a promulgué plus de dix-huit lois portant régularisation des agglomérations illégales, qui sont considérées comme des viviers d’électeurs.
A l’audience, la représentante du requérant a produit certains documents officiels pour réfuter les arguments du Gouvernement fondés sur l’absence de services publics dans le bidonville d’Ümraniye, affirmant que les habitants de la rue Gerze étaient abonnés au service des eaux et assujettis à la taxe d’habitation. En outre, se référant au plan officiel des lieux versé au dossier (paragraphe 10 ci-dessus), la représentante a affirmé qu’à l’époque des faits il existait un bureau de poste dans la rue Adem Yavuz et que la zone comprenait quatre établissements scolaires publics.
86. D’après le requérant, contrairement à ce qui est allégué, les autorités n’ont pas pris la moindre initiative pour informer les habitants du bidonville d’un quelconque danger présenté par la déchetterie.
A l’audience, son avocate a plaidé que le Gouvernement ne pouvait se soustraire à ses obligations en exigeant de ses citoyens les plus démunis, voire les plus ignorants, qu’ils se renseignent sur des questions environnementales de cette envergure. Selon elle, pour éviter le drame, il aurait suffi que la municipalité responsable fasse poser des cheminées d’aération dans la décharge, au lieu de se contenter de couvrir à mauvais escient les amas d’ordures avec de la terre.
87. Quant aux procédures intentées contre les autorités, le requérant se contente de souligner que l’issue de la procédure pénale litigieuse, qui n’a laissé transparaître aucune volonté de punir les coupables, n’a fait que heurter la conscience collective.
88. Du reste, le requérant estime que le Gouvernement est malvenu de tirer argument de l’efficacité de la procédure d’indemnisation, dès lors que celle-ci a abouti à l’octroi d’une indemnité seulement pour préjudice moral, laquelle non seulement était d’un montant dérisoire mais en outre demeure à ce jour impayée.
3. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux applicables au cas d’espèce
i. Principes relatifs à la prévention des atteintes au droit à la vie du fait d’activités dangereuses : le volet substantiel de l’article 2 de la Convention
89. L’obligation positive de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la vie au sens de l’article 2 (paragraphe 71 ci-dessus) implique avant tout pour les Etats le devoir primordial de mettre en place un cadre législatif et administratif visant une prévention efficace et dissuadant de mettre en péril le droit à la vie (voir, mutatis mutandis, par exemple, Osman, précité, p. 3159, § 115, Paul et Audrey Edwards, précité, § 54, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 91, CEDH 2000-VII, Kılıç c. Turquie, no 22492/93, § 62, CEDH 2000-III, et Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, § 85, CEDH 2000-III).
90. Cette obligation s’applique sans conteste dans le domaine spécifique des activités dangereuses, où il faut, de surcroît, réserver une place singulière à une réglementation adaptée aux particularités de l’activité en jeu notamment au niveau du risque qui pourrait en résulter pour la vie humaine. Elle doit régir l’autorisation, la mise en place, l’exploitation, la sécurité et le contrôle afférents à l’activité ainsi qu’imposer à toute personne concernée par celle-ci l’adoption de mesures d’ordre pratique propres à assurer la protection effective des citoyens dont la vie risque d’être exposée aux dangers inhérents au domaine en cause.
Parmi ces mesures préventives, il convient de souligner l’importance du droit du public à l’information, tel que consacré par la jurisprudence de la Convention. En effet, avec la chambre (paragraphe 84 de l’arrêt de la chambre), la Grande Chambre convient que ce droit, qui a déjà été consacré sur le terrain de l’article 8 (Guerra et autres, précité, p. 228, § 60), peut également en principe être revendiqué aux fins de la protection du droit à la vie, d’autant plus que cette interprétation se voit confortée par l’évolution actuelle des normes européennes (paragraphe 62 ci-dessus).
Quoi qu’il en soit, les réglementations doivent par ailleurs prévoir des procédures adéquates tenant compte des aspects techniques de l’activité en question et permettant de déterminer ses défaillances ainsi que les fautes qui pourraient être commises à cet égard par les responsables à différents échelons.
ii. Principes relatifs à la réaction judiciaire exigée en cas d’atteintes alléguées au droit à la vie : le volet procédural de l’article 2 de la Convention
91. Les obligations découlant de l’article 2 ne s’arrêtent pas là. Lorsqu’il y a eu mort d’homme dans les circonstances susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat, cette disposition implique pour celui-ci le devoir d’assurer, par tous les moyens dont il dispose, une réaction adéquate – judiciaire ou autre – pour que le cadre législatif et administratif instauré aux fins de la protection de la vie soit effectivement mis en œuvre et pour que, le cas échéant, les violations du droit en jeu soient réprimées et sanctionnées (voir, mutatis mutandis, Osman, précité, p. 3159, § 115, et Paul et Audrey Edwards, précité, § 54).
92. A ce sujet, la Cour a déjà énoncé que si l’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité physique n’était pas intentionnelle, l’obligation positive de mettre en place « un système judiciaire efficace » n’exigeait pas nécessairement, dans tous les cas, des poursuites pénales, et que pareille obligation pouvait être remplie si des voies de droit civiles, administratives ou même disciplinaires étaient ouvertes aux intéressés (voir, par exemple, Vo c. France [GC], no 53924/00, § 90, CEDH 2004-VIII, Calvelli et Ciglio, précité, § 51, et Mastromatteo, précité, §§ 90, 94-95).
93. Toutefois, dans des domaines tels que celui en cause en l’espèce, les principes applicables doivent davantage être trouvés dans ceux que la Cour a déjà eu à développer notamment en matière de recours à la force meurtrière, lesquels sont tout à fait susceptibles de s’appliquer dans d’autres catégories d’affaires.
A cet égard, il convient de rappeler que si les cas d’homicide justifient que l’on dégage de l’article 2 une obligation d’enquête officielle, c’est non seulement parce que les allégations formulées à ce titre impliquent, en principe, une responsabilité pénale (Caraher c. Royaume-Uni (déc.), no 24520/94, CEDH 2000-I), mais également parce qu’en pratique il arrive que seuls des agents ou autorités de l’Etat connaissent ou peuvent connaître les vraies circonstances dans lesquelles le décès est survenu (McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, pp. 47-49, §§ 157-164, et İlhan, précité, § 91).
Pour la Cour, ces considérations valent sans conteste dans le domaine des activités dangereuses, lorsque celles-ci ont entraîné mort d’homme à la suite d’événements survenus sous la responsabilité des pouvoirs publics, lesquels sont souvent les seuls à disposer des connaissances suffisantes et nécessaires pour identifier et établir les phénomènes complexes susceptibles d’être à l’origine de tels incidents.
Dans les cas où il est établi que la faute imputable, de ce chef, aux agents ou organes de l’Etat va au-delà d’une erreur de jugement ou d’une imprudence, en ce sens qu’ils n’ont pas pris, en toute connaissance de cause et conformément aux pouvoirs qui leur étaient conférés, les mesures nécessaires et suffisantes pour pallier les risques inhérents à une activité dangereuse (voir, mutatis mutandis, Osman, précité, pp. 3159-3160, § 116), l’absence d’incrimination et de poursuites à l’encontre des personnes responsables d’atteintes à la vie peut entraîner une violation de l’article 2, abstraction faite de toute autre forme de recours que les justiciables pourraient exercer de leur propre initiative (paragraphes 48, 49 et 50 ci-dessus) : il suffit pour s’en convaincre de considérer l’évolution normative des dispositions européennes en la matière (paragraphe 61 ci-dessus).
94. En
somme, le système
judiciaire exigé par l’article 2 doit comporter un
mécanisme d’enquête
officielle, indépendant et impartial, répondant
à certains critères
d’effectivité
et de nature à assurer la répression
pénale des atteintes à la vie du fait
d’une
activité dangereuse, si et dans la mesure où les
résultats des investigations
justifient cette répression (voir, mutatis
mutandis, Hugh Jordan c. Royaume-Uni,
no 24746/94, §§ 105-109, 4 mai
2001, et Paul et Audrey Edwards,
précité, §§ 69-73). En pareil
cas, les
autorités compétentes doivent faire preuve
d’une diligence et d’une promptitude
exemplaires et procéder d’office à des
investigations propres à, d’une part,
déterminer
les circonstances dans lesquelles une telle atteinte a eu lieu ainsi
que les
défaillances dans la mise en œuvre du cadre
réglementaire et, d’autre part, identifier
les agents ou les organes de l’Etat impliqués, de
quelque façon que ce soit, dans
l’enchaînement de ces circonstances.
95. Cela étant, les exigences de l’article 2 s’étendent au-delà du stade de l’enquête officielle, lorsqu’en l’occurrence celle-ci a entraîné l’ouverture de poursuites devant les juridictions nationales : c’est l’ensemble de la procédure, y compris la phase de jugement, qui doit satisfaire aux impératifs de l’obligation positive de protéger la vie par la loi.
96. Il ne faut nullement déduire de ce qui précède que l’article 2 peut impliquer le droit pour un requérant de faire poursuivre ou condamner au pénal des tiers (voir, mutatis mutandis, Perez c. France [GC], no 47287/99, § 70, CEDH 2004-I) ou une obligation de résultat supposant que toute poursuite doit se solder par une condamnation, voire par le prononcé d’une peine déterminée (voir, mutatis mutandis, Tanlı c. Turquie, no 26129/95, § 111, CEDH 2001-III).
En revanche, les juridictions nationales ne doivent en aucun cas s’avérer disposées à laisser impunies des atteintes à la vie. Cela est indispensable pour maintenir la confiance du public et assurer son adhésion à l’Etat de droit ainsi que pour prévenir toute apparence de tolérance d’actes illégaux, ou de collusion dans leur perpétration (voir, mutatis mutandis, Hugh Jordan, précité, §§ 108, 136-140). La tâche de la Cour consiste donc à vérifier si et dans quelle mesure les juridictions, avant de parvenir à telle ou telle conclusion, peuvent passer pour avoir soumis le cas devant elles à l’examen scrupuleux que demande l’article 2 de la Convention, pour que la force de dissuasion du système judiciaire mis en place et l’importance du rôle que celui-ci se doit de jouer dans la prévention des violations du droit à la vie ne soient pas amoindries.
b) Appréciation des faits de la cause à la lumière de ces principes
i. Responsabilité de l’Etat du fait des décès survenus en l’espèce, au regard de l’article 2 de la Convention, sous son volet substantiel
97. La Cour relève d’emblée que, dans les deux domaines d’activité qui se trouvent au cœur du présent litige, à savoir l’exploitation des sites de stockage de déchets ménagers (paragraphes 56-57 ci-dessus) et la réhabilitation des bidonvilles (paragraphes 54-55 ci-dessus), il existe en Turquie des réglementations de protection.
Il convient donc de rechercher si le régime des mesures légales applicables à la situation dénoncée doit être mis en cause et si les autorités nationales ont bien respecté les réglementations en la matière.
98. A cette fin, la Cour estime devoir commencer par un élément déterminant pour l’appréciation des faits de la présente affaire : des informations concrètes étaient disponibles et indiquaient que les habitants de certains quartiers de taudis d’Ümraniye étaient menacés dans leur intégrité physique en raison des défaillances techniques de la décharge municipale.
D’après un rapport d’expertise commandé par la 3e chambre du tribunal d’instance d’Üsküdar et déposé le 7 mai 1991, la décharge en question a été ouverte à l’exploitation au début des années 70 en violation des normes techniques, et a été depuis lors utilisée au mépris des mesures de sécurité sanitaires et techniques prévues notamment par le règlement sur le contrôle des déchets solides, publié au Journal officiel du 14 mars 1991 (paragraphe 56 ci-dessus). Enumérant les différents risques que le site présentait pour les citoyens, le rapport faisait expressément état d’un danger d’explosion du fait de la méthanogénèse, car il n’existait dans l’installation « aucune mesure pour prévenir l’explosion du méthane issu de la décomposition » des ordures ménagères (paragraphe 13 ci-dessus).
99. A ce sujet, la Cour a examiné la position du Gouvernement tenant à la validité du rapport d’expertise du 7 mai 1991 et au poids à accorder selon lui aux recours en annulation exercés par les mairies de Kadıköy, d’Üsküdar et d’Istanbul afin d’invalider ce rapport (paragraphe 14 ci‑dessus). Toutefois, la Cour estime qu’il s’agissait là de démarches qui révèlent plutôt une confusion de compétences entre différentes administrations, voire des manœuvres dilatoires : quoi qu’il en soit, la procédure d’annulation évoquée, faute d’avoir été poursuivie par les avocats des mairies, n’a de fait jamais abouti et le rapport n’a jamais été invalidé. Bien au contraire, il s’est avéré déterminant pour tous les organes chargés d’enquêter sur l’accident du 28 avril 1993 et, de surcroît, il a été confirmé ultérieurement par le rapport du 18 mai 1993 du comité d’experts désigné par le procureur de la République d’Üsküdar (paragraphe 23 ci‑dessus) ainsi que par les deux avis scientifiques dont il est fait mention dans le rapport du 9 juillet 1993 de l’inspecteur en chef nommé par le ministère de l’Intérieur (paragraphe 28 ci-dessus).
100. Pour la Cour, ni la réalité du danger en cause ni son imminence ne prêtent à controverse, dès lors que le risque d’explosion dénoncé était assurément apparu bien avant sa mise en évidence dans le rapport du 7 mai 1991, et qu’en raison de l’exploitation constante, en l’état, du site, il ne pouvait qu’empirer avec le temps jusqu’à sa concrétisation le 28 avril 1993.
101. La Grande Chambre rejoint ainsi la chambre (paragraphe 79 de l’arrêt de la chambre) qui a estimé qu’il était impossible que les services administratifs et municipaux chargés du contrôle et de la gestion de la déchetterie n’aient pas été au courant des risques inhérents à la méthanogénèse ni des mesures nécessaires pour prévenir ce phénomène, d’autant qu’il existait en la matière une réglementation précise. De plus, la Cour tient également pour établi que diverses autorités avaient, elles aussi, eu connaissance de ces risques au plus tard le 27 mai 1991, date à laquelle elles avaient été avisées du rapport du 7 mai 1991 (paragraphes 13 et 15 ci-dessus).
Il s’ensuit que les autorités turques, à plusieurs niveaux, savaient ou étaient censées savoir que plusieurs individus vivant à proximité de la décharge municipale d’Ümraniye étaient menacés de manière réelle et imminente. Par conséquent, elles avaient, au regard de l’article 2 de la Convention, l’obligation positive de prendre préventivement des mesures concrètes, nécessaires et suffisantes pour les protéger (paragraphes 92-93 ci-dessus), d’autant plus qu’elles avaient elles-mêmes mis en place et autorisé l’exploitation génératrice de la menace en question.
102. Toutefois, il ressort du dossier que notamment la mairie métropolitaine a non seulement omis de prendre, aussi bien avant qu’après le 14 mars 1991, les mesures urgentes qui s’imposaient, mais a de surcroît fait obstacle – comme la chambre l’a d’ailleurs relevé – à la recommandation faite en ce sens par le Conseil de l’environnement auprès du premier ministre (paragraphe 15 ci-dessus). Celui-ci prescrivait la mise en conformité de la décharge avec les normes énoncées notamment aux articles 24 à 27 du règlement sur le contrôle des déchets solides, dont le dernier imposait explicitement l’installation d’un « système de drainage vertical et horizontal » permettant la libération contrôlée du gaz accumulé (paragraphe 56 ci-dessus).
103. La mairie métropolitaine s’est également opposée à l’ultime démarche judiciaire entreprise le 27 août 1992 par le maire d’Ümraniye afin d’obtenir l’arrêt provisoire du dépôt d’ordures ménagères. A cet égard, elle a excipé du fait que la mairie d’arrondissement demanderesse, qui n’aurait jusqu’alors rien entrepris pour l’assainissement du site, ne serait donc pas en droit d’en demander la fermeture (paragraphe 16 ci‑dessus).
Outre ce motif, le Gouvernement s’est également fondé sur les conclusions de l’arrêt Chapman précité et a reproché au requérant d’avoir sciemment choisi d’enfreindre la loi et d’habiter dans la zone de la déchetterie (paragraphes 23, 43 et 80 ci-dessus).
Toutefois ces arguments ne résistent pas à l’examen, pour les raisons qui suivent.
104. En l’espèce, la Cour s’est penchée sur les dispositions du droit interne relatives à la cession à des tiers de biens du domaine public, situés ou non dans des « zones de réhabilitation et d’éradication des taudis » ; elle a aussi étudié l’impact de diverses initiatives du législateur visant à étendre, en pratique, le champ d’application ratione temporis de la loi no 775 du 20 juillet 1966 (paragraphes 54-55 ci-dessus).
La conclusion que la Cour tire de ces éléments de droit est qu’en dépit des interdictions légales en matière d’aménagement urbain, la politique constante de l’Etat relative aux bidonvilles a favorisé l’intégration de ceux-ci dans le paysage urbain et a reconnu en conséquence l’existence de telles agglomérations ainsi que le mode de vie des citoyens qui les avaient créées au fil du temps depuis 1960, que ce soit de leur propre gré ou du fait même de cette politique. Dans la mesure où elle tendait à amnistier les infractions à la réglementation en matière d’urbanisme, y compris les occupations illégales de biens publics, cette politique a dû entraîner une incertitude quant à l’ampleur de la marge de manœuvre laissée aux autorités administratives tenues d’appliquer les mesures dictées par la loi, mesures qui, par conséquent, ne pouvaient passer pour prévisibles aux yeux des citoyens.
105. Cette interprétation se voit d’ailleurs corroborée en l’espèce par l’attitude des autorités administratives à l’égard du requérant.
En effet, la Cour observe qu’entre la construction sans permis de la maison litigieuse en 1988 et l’accident du 28 avril 1993, le requérant est resté en possession de son habitation, alors que, pendant ce laps de temps, sa situation demeurait soumise au régime de la loi no 775, notamment à son article 18 en vertu duquel les autorités municipales pouvaient procéder à tout moment à la destruction de sa maison. C’est ce que le Gouvernement a bien laissé entendre (paragraphes 77 et 80 ci-dessus), sans pour autant être en mesure de démontrer que dans la présente affaire les autorités compétentes avaient ne serait-ce qu’envisagé la prise d’une quelconque mesure de cet ordre à l’encontre de l’intéressé.
Elles ont laissé M. Öneryıldız et ses proches vivre dans leur maison en toute tranquillité dans l’environnement social et familial qu’ils avaient créé. De surcroît, compte tenu des preuves matérielles présentées à la Cour et non réfutées par le Gouvernement, rien ne permet de douter de la véracité de l’affirmation du requérant, selon laquelle l’administration avait de surcroît imposé une taxe d’habitation, à lui ainsi qu’à d’autres habitants du bidonville d’Ümraniye, et les avait admis au bénéfice des services publics payants (paragraphes 11 et 85 ci-dessus).
106. Dans ces conditions, on comprendrait mal que le Gouvernement puisse légitimement faire valoir une quelconque imprévoyance ou faute de la part des victimes de l’accident du 28 avril 1993, ou se fonder sur les conclusions de la Cour dans l’affaire Chapman précitée, où aucune passivité des autorités britanniques n’avait été relevée face à l’irrégularité commise par Mme Chapman.
Il convient par ailleurs d’examiner les autres arguments que le Gouvernement tire généralement de l’ampleur des projets de réhabilitation que la mairie métropolitaine aurait alors mis en œuvre pour pallier les problèmes liés au site de la décharge d’Ümraniye, de l’importance des investissements qui aurait influé sur le choix des autorités nationales face à la situation prévalant dans ce site et, enfin, des considérations humanitaires qui, à l’époque, auraient condamné toute mesure de destruction immédiate et massive des agglomérations de taudis.
107. La Cour estime n’avoir pas qualité pour substituer son propre point de vue à celui des autorités locales quant à la meilleure politique à adopter face aux difficultés sociales, conjoncturelles et urbaines dans cette zone d’Istanbul ; aussi admet-elle avec le Gouvernement qu’à cet égard on ne saurait imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, sans tenir compte notamment des choix opérationnels qu’elles ont à faire en termes de priorités et de ressources (Osman, précité, pp. 3159-3160, § 116) : il y va de la marge d’appréciation étendue que la jurisprudence de la Cour reconnaît aux Etats dans des domaines sociaux et techniques difficiles, tels que celui en cause en l’espèce (Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], no 36022/97, §§ 100-101, CEDH 2003-VIII).
Cependant, même considérés sous cet angle, les arguments du Gouvernement ne convainquent pas la Cour. Car, justement, les mesures préventives qui s’imposent sont celles qui rentrent dans le cadre des pouvoirs conférés aux autorités et qui peuvent raisonnablement passer pour aptes à pallier le risque porté à leur connaissance. Or, de l’avis de la Cour, la mise en place en temps utile d’un système de dégazage dans la décharge d’Ümraniye, avant que la situation ne devienne fatale, aurait pu constituer une mesure efficace, sans grever excessivement les ressources de l’Etat au mépris de l’article 65 de la Constitution turque (paragraphe 52 ci-dessus) ni entraîner des problèmes de choix politiques d’une ampleur telle que celle invoquée par le Gouvernement. Pareille mesure aurait non seulement respecté la réglementation turque et la pratique générale en la matière, mais aurait également beaucoup mieux reflété les considérations humanitaires dont le Gouvernement se prévaut maintenant devant la Cour.
108. La Cour s’est ensuite interrogée sur le poids à accorder à la question du respect du droit du public à l’information (paragraphe 90 ci‑dessus). A cet égard, elle relève que le Gouvernement n’a pas démontré qu’une quelconque mesure d’information ait été prise en l’espèce de manière à permettre aux habitants du bidonville d’Ümraniye d’évaluer les risques pouvant résulter pour eux de leurs choix. Quoi qu’il en soit, la Cour juge qu’en l’absence d’initiatives plus concrètes visant à prévenir les menaces qui pesaient sur la vie des habitants du bidonville d’Ümraniye, même le respect du droit à l’information n’aurait pas suffi pour absoudre l’Etat de ses responsabilités.
109. Au vu de ce qui précède, la Cour n’aperçoit aucun élément susceptible de remettre en cause les constats de fait dégagés par les autorités d’enquête nationales (paragraphes 23, 28 et 78 ci-dessus – voir, par exemple, Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, p. 17, §§ 29-30), et estime que les circonstances examinées ci‑dessus montrent qu’en l’espèce la responsabilité de l’Etat se trouve engagée au regard de l’article 2, et ce à plusieurs égards.
Tout
d’abord, le cadre réglementaire s’est
révélé
défaillant quant à l’ouverture et
à l’exploitation du site de décharge
municipale d’Ümraniye, au mépris des
normes techniques en vigueur dans ce
domaine, et a péché par l’absence de
système de contrôle cohérent, de nature
à
inciter les responsables à adopter des mesures propres
à garantir la protection
effective des citoyens et à assurer la coordination et la
coopération entre les
différentes autorités administratives pour
qu’elles ne laissent pas les risques
portés à leur connaissance s’aggraver
au point de menacer des vies humaines.
Cette situation, envenimée par une politique d’ensemble qui s’est avérée impuissante à régler les questions d’ordre général en matière d’urbanisme et qui a créé une incertitude quant à l’application des mesures légales, a joué un rôle certain dans l’enchaînement des événements à l’origine de l’accident tragique du 28 avril 1993, lequel a finalement coûté la vie à des habitants du bidonville d’Ümraniye, les agents et les autorités de l’Etat n’ayant pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour les protéger contre les dangers imminents et connus auxquels ils étaient exposés.
110. Pareilles circonstances entraînent une violation de l’article 2 de la Convention, sous son volet substantiel, étant entendu qu’à cet égard l’argument tiré par le Gouvernement de l’issue favorable de l’action administrative engagée en l’espèce (paragraphe 84 ci-dessus) ne prête pas à conséquence, pour les raisons exposées ci-après aux paragraphes 151 et 152.
ii. Responsabilité de l’Etat quant à la réaction judiciaire exigée face aux décès survenus, au regard de l’article 2 de la Convention, sous son volet procédural-
111. Pour
la Cour, et
contrairement à ce que le Gouvernement suggère, il ne s’impose pas non
plus d’examiner la voie administrative
d’indemnisation
susmentionnée (paragraphes 37, 39, 40, 84 et 88 ci‑dessus)
dans le cadre de l’appréciation
de la réaction judiciaire exigée dans la
présente affaire,
pareille voie
ne pouvant – quelle qu’en soit l’issue
– entrer en ligne de
compte aux fins de l’article 2, sous son volet procédural
(paragraphes 91 à 96, ci-dessus).
112. La Cour observe que les voies de droit
pénales mises en place en Turquie
s’inscrivent dans un système qui, en
théorie, paraît suffisant pour assurer la
sauvegarde
du droit à la vie dans le contexte des activités
dangereuses : à ce titre,
les articles 230 § 1 et 455 §§
1-2 du code pénal turc traitent des
négligences de la part des agents ou des
autorités de l’Etat (paragraphe 44
ci-dessus).
Reste la question de savoir si les mesures prises dans le cadre du système pénal turc à la suite de l’accident dans la décharge municipale d’Ümraniye se sont avérées satisfaisantes en pratique, compte tenu des exigences de la Convention en la matière (paragraphes 91-96 ci-dessus).
113. A
ce sujet, la Cour note qu’immédiatement
après cet accident, qui s’est produit
le 28 avril 1993 vers 11 heures, la police est arrivée sur
les lieux et a entendu
les familles des victimes. Par ailleurs, la préfecture
d’Istanbul a constitué
une cellule de crise dont les membres se sont rendus sur les lieux le
jour
même. Le lendemain, à savoir le 29 avril 1993, le
ministère de l’Intérieur a
d’office
ordonné l’ouverture d’une
enquête administrative afin de déterminer la
responsabilité des autorités dans la survenance
de l’accident. Le 30 avril
1993, le procureur de la République
d’Üsküdar a entamé, de son
côté, une
enquête pénale. Finalement, l’ensemble
des investigations officielles ont abouti
le 15 juillet 1993, date à laquelle les deux maires, MM.
Sözen et Öktem, ont
été déférés
devant les juridictions répressives.
Partant, les autorités d’enquête peuvent passer pour avoir agi avec une promptitude exemplaire (Yaşa, précité, pp. 2439-2440, §§ 102-104, Mahmut Kaya, précité, §§ 106-107, et Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 109, CEDH 1999-IV) et pour s’être employées avec diligence à établir les faits à l’origine tant de l’accident du 28 avril 1993 que des décès survenus en conséquence.
114. Par ailleurs, on peut considérer que les responsables des faits incriminés ont été identifiés. En effet, dans son ordonnance du 21 mai 1993, qui se fondait sur un rapport d’expertise dont nul n’a contesté la validité (paragraphe 24 ci-dessus), le procureur de la République concluait à la responsabilité du maire d’Istanbul, au motif qu’il n’avait « pas agi en temps utile pour prévenir les problèmes techniques qui existaient déjà à
l’installation du dépôt en 1970, et qui n’ont cessé de s’aggraver depuis lors, ni indiqué aux mairies concernées un autre site de stockage de déchets, comme la loi no 3030 l’obligeait à le faire ». D’après cette ordonnance, d’autres organes de l’Etat avaient aussi contribué à aggraver et à prolonger la situation : la mairie d’Ümraniye avait mis en œuvre un plan d’aménagement urbain contrevenant à la réglementation et n’avait pas empêché la construction des habitations de fortune dans sa région, le ministère de l’Environnement avait omis d’assurer le respect du règlement sur le contrôle des déchets solides, et le gouvernement de l’époque avait favorisé la propagation de telles habitations, en adoptant des lois d’amnistie prévoyant l’octroi de titres de propriété à leurs occupants.
Ainsi, le procureur concluait à l’applicabilité des articles 230 et 455 du code pénal aux intéressés (paragraphe 44 ci-dessus).
115. Il
est vrai que les
organes administratifs d’enquête, auxquels il
appartenait d’engager des poursuites
pénales (paragraphe 46 ci-dessus), n’ont souscrit
qu’en partie aux conclusions
du procureur, et ce pour des raisons qui échappent
à la Cour et que le
Gouvernement n’a jamais tenté
d’expliquer.
De fait, ces organes, dont l’indépendance a déjà été mise en cause dans plusieurs affaires soumises à la Cour (Güleç c. Turquie, arrêt du 27 juillet 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1732-1733, §§ 79-81, et Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, §§ 91-92, CEDH 1999-III), ont finalement abandonné les accusations portées à l’encontre du ministère de l’Environnement et des autorités gouvernementales (paragraphes 29 et 31 ci-dessus) et ont cherché à cantonner l’accusation à « la négligence » en tant que telle, et à exclure l’examen de l’affaire sous sa dimension attentatoire à la vie.
Il n’y a toutefois pas lieu de s’attarder sur ces lacunes, dès lors qu’une action publique a malgré tout été ouverte devant la 5e chambre du tribunal correctionnel d’Istanbul et qu’une fois saisie, celle-ci jouissait de la plénitude de juridiction pour apprécier librement l’affaire portée devant elle et, le cas échéant, ordonner des investigations complémentaires, étant entendu par ailleurs que son jugement était soumis au contrôle de la Cour de cassation.
Ainsi, de l’avis de la Cour, plutôt que de déterminer s’il y a eu une enquête préliminaire cadrant parfaitement avec l’ensemble des exigences procédurales en la matière (paragraphe 94 ci-dessus), il s’agit d’examiner si les instances judiciaires avaient la volonté d’aboutir à la sanction des responsables, en tant que gardiennes des lois instaurées pour protéger la vie.
116. En l’espèce, par un jugement du 4 avril 1996, le tribunal correctionnel d’Istanbul a condamné les deux maires mis en cause à des peines d’amendes de 610 000 TRL (ce qui correspondait, à l’époque, à 9,70 euros environ) assorties d’un sursis, pour négligence dans l’exercice de leurs fonctions, au sens de l’article 230 § 1 du code pénal (paragraphe 23 ci-dessus). Devant la Cour, le Gouvernement a tenté d’expliquer les raisons ayant motivé l’application de cette seule disposition aux deux maires ainsi que le choix de leur infliger la peine minimale qu’elle prévoyait (paragraphe 82 ci-dessus). Or la Cour n’a pas à répondre à de telles questions de droit interne concernant la responsabilité pénale individuelle, dont l’appréciation relève des juridictions nationales, et il n’entre pas dans ses attributions de rendre des verdicts de culpabilité ou d’innocence à cet égard.
Compte tenu de la tâche qui lui incombe, il lui suffit de relever qu’en l’espèce le procès pénal litigieux ne visait qu’à établir l’éventuelle responsabilité des autorités pour « négligence dans l’exercice de leurs fonctions », sous l’angle de l’article 230 du code pénal, lequel n’a nullement trait aux faits constitutifs d’une atteinte à la vie ni à la protection du droit à la vie, au sens de l’article 2.
En effet, il ressort du jugement du 4 avril 1996 que les juges du fond n’ont aperçu aucun motif de s’écarter du raisonnement suivi dans l’ordonnance de mise en accusation du comité administratif et ont laissé en suspens toute question se rapportant à une éventuelle responsabilité des autorités dans la mort des neuf proches du requérant. Il est vrai que le jugement du 4 avril 1996 contient des passages où il est fait référence aux décès survenus le 28 avril 1993 en tant qu’élément factuel. Toutefois, cela ne saurait permettre de déduire qu’il y a eu reconnaissance d’une quelconque responsabilité pour un manquement à la sauvegarde du droit à la vie. Le dispositif dudit jugement est muet sur ce point et ne contient, du reste, aucun élément précis démontrant que les juges du fond aient prêté l’attention voulue aux conséquences gravissimes de l’accident, dont les responsables se sont finalement vu infliger des peines d’amendes d’un montant dérisoire, assorties de surcroît d’un sursis.
117. Ainsi, on ne saurait estimer que la façon dont le système de justice pénale turc a répondu au drame a permis d’établir la pleine responsabilité des agents ou autorités de l’Etat pour leur rôle dans cette tragédie, et de garantir la mise en œuvre effective des dispositions du droit interne assurant le respect du droit à la vie, en particulier la fonction dissuasive du droit pénal.
118. En bref, il y a lieu de conclure en l’espèce à la violation de l’article 2 de la Convention, sous son volet procédural également, à raison de l’absence, face à un accident provoqué du fait d’une activité dangereuse, d’une protection adéquate « par la loi », propre à sauvegarder le droit à la vie, ainsi qu’à prévenir, à l’avenir, de tels agissements mettant la vie en danger.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
119. Le requérant affirme que l’Etat doit répondre des négligences des autorités nationales à l’origine de la perte de sa maison avec tous ses biens mobiliers et se plaint que son préjudice n’a pas été réparé. Il invoque une violation de l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
120. Le Gouvernement nie toute violation de ce chef.
A. Applicabilité : l’existence d’un « bien »
1. L’arrêt de la chambre
121. La chambre a considéré que le fait pour le requérant d’avoir occupé un terrain du Trésor public pendant cinq ans environ ne pouvait le rendre titulaire d’un droit susceptible de s’analyser en un « bien ». En revanche, elle a estimé que le requérant était bien le propriétaire du corps et des composants du taudis qu’il avait construit ainsi que de tous les biens ménagers et personnels qui pouvaient s’y trouver et ce, bien que la construction litigieuse se soit avérée contraire à la loi.
Partant, la chambre a conclu que l’habitation construite par le requérant et le fait pour lui d’y demeurer avec ses proches représentaient un intérêt économique substantiel, et que pareil intérêt, dont le maintien dans le temps avait été toléré par les autorités, constituait un « bien » au sens de la norme exprimée dans la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1.
2. Arguments des comparants
a) Le Gouvernement
122. Comme devant la chambre, le Gouvernement soutient que ni l’habitation que le requérant a bâtie sans permis ni le fait que cette construction ait illégalement occupé un terrain appartenant au Trésor public ne sauraient en soi fonder « un droit de propriété » ni constituer « un bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Un tel droit n’a jamais été reconnu en droit interne, ni explicitement ni tacitement, et le Gouvernement souligne que le requérant n’a par ailleurs pas été en mesure de fournir un quelconque document ou titre propre à appuyer ses prétentions. A ce sujet, c’est à tort que l’intéressé a invoqué les lois de régularisation des constructions illégales, celles-ci n’ayant eu en aucun cas pour effet de lui transférer la propriété d’un bien du domaine public, inaliénable et imprescriptible au regard de la loi no 3402 sur le cadastre.
Le Gouvernement se réfère à l’arrêt Chapman précité et plaide que, dans le cas d’espèce, la Cour ne devrait pas se laisser indûment guider par des considérations étrangères à la situation de droit devant elle pour conclure que les actions du requérant ont pu faire naître un intérêt substantiel protégé par l’article 1 du Protocole no 1, ce qui équivaudrait à soustraire l’intéressé à l’application du droit interne et à le récompenser pour des actes contraires à la loi.
b) Le requérant
123. Le requérant réaffirme le point de vue qu’il a exposé devant la chambre et, renvoyant à ses explications précédentes (paragraphe 85 ci‑dessus), soutient qu’en l’espèce il y avait suffisamment d’éléments renforcés par une tolérance officielle manifeste ainsi qu’une série d’initiatives administratives et législatives sans équivoque, pour que chaque habitant du bidonville d’Ümraniye s’estimât titulaire d’un droit légitime sur les biens litigieux.
A l’audience, la représentante du requérant a aussi renvoyé à la loi no 4706 (paragraphe 55 ci-dessus), alléguant que celle-ci permettait en soi de réfuter l’argument selon lequel nul ne saurait acquérir un bien appartenant à l’Etat. Par ailleurs, elle a expliqué que, si son client n’avait pas encore entamé les démarches pour bénéficier de la loi no 775, rien ne l’empêchait de le faire ultérieurement, notamment en se prévalant de la nouvelle loi no 4706.
3. Appréciation de la Cour
124. La Cour rappelle que la notion de « biens » prévue par la première partie de l’article 1 du Protocole no 1 a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété des biens corporels et qui est indépendante par rapport aux qualifications formelles du droit interne : ce qui importe c’est de rechercher si les circonstances d’une affaire donnée, considérées dans leur ensemble, peuvent passer pour avoir rendu le requérant titulaire d’un intérêt substantiel protégé par cette disposition (voir, mutatis mutandis, Zwierzyński c. Pologne, no 34049/96, § 63, CEDH 2001-VI). Ainsi, à l’instar des biens corporels, certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi être considérés comme des « droits de propriété », et donc comme des « biens » aux fins de cette disposition (arrêts Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 1999-II, et Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 100, CEDH 2000-I). La notion de « biens » ne se limite pas non plus aux « biens actuels » et peut également recouvrir des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » et raisonnable d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (voir, par exemple, Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, § 83, CEDH 2001-VIII).
125. Nul n’a contesté devant la Cour que l’habitation du requérant était érigée en violation de la réglementation turque en matière d’aménagement urbain et contrevenait aux normes techniques en la matière, ni le fait que le terrain ainsi occupé appartenait au Trésor public. Cela étant, les parties ont des vues divergentes quant à la question de savoir si le requérant disposait d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
126. En ce qui concerne d’abord le terrain sur lequel l’habitation litigieuse avait été construite et qui a été occupé jusqu’à la survenance de l’accident du 28 avril 1993, le requérant déclare que rien ne l’empêchait d’entreprendre, à tout moment, des démarches afin d’acquérir la propriété dudit terrain, selon la procédure prévue à cette fin.
Cependant, la Cour ne saurait souscrire à cette thèse quelque peu spéculative. En vérité, les parties n’ayant pas fourni de renseignements détaillés, elle n’est pas à même de savoir si le quartier de Kazım Karabekir était ou non effectivement inclus dans un plan de réhabilitation des taudis, contrairement à ce qui semble avoir été le cas pour le quartier d’Hekimbaşı (paragraphe 11 ci-dessus), ni si le requérant remplissait ou non les conditions formelles pour se prévaloir de la législation en matière d’urbanisme en vigueur à l’époque des faits, afin que la propriété du bien public qu’il occupait lui soit transférée (paragraphe 54 ci-dessus). Quoi qu’il en soit, le requérant admet n’avoir jamais effectué une quelconque démarche administrative à cette fin.
Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que l’espoir du requérant de se voir un jour céder le terrain en cause constituait une forme de créance suffisamment établie au point de pouvoir être revendiquée en justice, donc un « bien » distinct au sens de la jurisprudence de la Cour (Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, §§ 25-26, CEDH 2004-IX).
127. Cela étant, une autre considération s’impose pour ce qui est de l’habitation même du requérant.
A cet égard, il suffit à la Cour de renvoyer aux raisons exposées ci-dessus et qui l’ont conduite à constater l’existence d’une tolérance des autorités de l’Etat face aux actions du requérant (paragraphes 105 et 106 ci-dessus). Ces raisons valent à l’évidence au regard de l’article 1 du Protocole no 1 et permettent de juger que lesdites autorités ont de facto reconnu que l’intéressé et ses proches avaient un intérêt patrimonial tenant à leur habitation et à leurs biens meubles.
128. A ce sujet, la Cour ne saurait accepter qu’on puisse leur reprocher de cette manière des irrégularités (paragraphe 122 ci-dessus) dont les autorités compétentes avaient connaissance depuis presque cinq ans.
Certes, elle admet que l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire portant sur une multitude de facteurs locaux est inhérent au choix et à l’application de politiques d’aménagement urbain et rural, et de mesures qui s’imposent. Cependant, face à un problème tel que celui soulevé en l’espèce, les autorités ne peuvent légitimement invoquer leur marge d’appréciation, celle-ci ne les dispensant aucunement de leur devoir de réagir en temps utile, de façon correcte et, surtout, cohérente.
Or, dans la présente affaire, tel n’a pas été le cas puisque l’incertitude créée au sein de la société turque quant à l’application des lois réprimant les agglomérations illégales n’était pas un élément susceptible d’amener le requérant à penser que la situation concernant son habitation risquait de basculer d’un jour à l’autre.
129. De l’avis de la Cour, l’intérêt patrimonial du requérant relatif à son habitation était suffisamment important et reconnu pour constituer un intérêt substantiel, donc un « bien » au sens de la norme exprimée dans la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1, laquelle est donc applicable quant à ce volet du grief examiné.
B. Observation
1. L’arrêt de la chambre
130. La chambre, après avoir souligné l’importance cruciale du droit consacré par l’article 1 du Protocole no 1, a estimé que l’exercice réel et efficace de ce droit ne saurait dépendre uniquement du devoir de l’Etat de s’abstenir de toute ingérence et pourrait exiger des mesures positives de protection.
A cet égard, la chambre a jugé que l’attitude des autorités administratives, qui ont omis de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la matérialisation du risque d’explosion du méthane, donc la survenance du glissement de terrain qui en a résulté, allait également à l’encontre de l’exigence d’une protection « concrète et effective » du droit garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
A son avis, pareille situation s’analysait en une atteinte manifeste au droit du requérant au respect de ses « biens » et était constitutive d’une « ingérence », laquelle s’avérait manifestement injustifiée au regard de l’article 1 du Protocole no 1, étant donné que les négligences des autorités à l’origine de la privation de propriété incriminée en l’espèce contrevenaient aux dispositions tant administratives que pénales du droit turc.
2. Arguments des comparants
a) Le Gouvernement
131. Le Gouvernement attire l’attention de la Cour sur le fait que, dans son arrêt du 18 juin 2002, la chambre n’a pu citer un seul précédent concluant à l’existence d’une obligation positive à la charge de l’Etat dans une situation comparable à celle dénoncée par le requérant. D’après lui, il est regrettable que, pour parvenir à cette conclusion, la chambre ait choisi une affaire où il n’existe aucun droit de propriété reconnu.
Pour le Gouvernement, pareille conclusion équivaut à reprocher aux autorités turques de s’être refusées, pour des raisons humanitaires, à détruire la maison du requérant sans se douter qu’un tel choix allait être interprété comme la reconnaissance implicite d’un droit de propriété juridiquement nul et non avenu.
Quoi qu’il en soit, le Gouvernement estime que le requérant n’a pas qualité de victime pour se plaindre d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1, dans la mesure où il s’est vu allouer par des instances administratives une indemnité conséquente au titre de son préjudice matériel et a bénéficié d’un logement social qui lui a été attribué moyennant un prix modique.
b) Le requérant
132. Devant la Cour, le requérant axe ses arguments sur l’arrêt Chapman précité. Il considère que dans cette affaire, la Cour s’est penchée sur la situation d’une personne qui faisait sciemment la sourde oreille aux avertissements et aux sanctions infligées en vertu de la loi et inspirées par la protection des droits d’autrui en matière d’environnement. Or les circonstances sont complètement différentes en l’espèce, où le Gouvernement est justement mis en cause pour l’inaction ou les négligences de ses autorités au regard de la loi.
3. Appréciation de la Cour
133. La Cour constate qu’en raison de sa complexité, en fait comme en droit, la situation dénoncée en l’espèce ne peut être classée dans l’une des catégories relevant de la seconde phrase du premier alinéa ou dans le second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 (Beyeler, précité, § 98), étant entendu par ailleurs que le requérant se plaint non d’un acte mais de l’inaction de l’Etat.
Elle estime devoir donc examiner l’affaire à la lumière de la norme générale contenue dans la première phrase du premier alinéa, qui énonce le droit au respect de la propriété.
134. A cet égard, la Cour réaffirme le principe qui a déjà été dégagé, en substance, de l’article 1 du Protocole no 1 (Bielectric S.r.l. c. Italie (déc.), no 36811/97, 4 mai 2000). L’exercice réel et efficace du droit que cette disposition garantit ne saurait en effet dépendre uniquement du devoir de l’Etat de s’abstenir de toute ingérence et peut exiger des mesures positives de protection, notamment là où il existe un lien direct entre les mesures qu’un requérant pourrait légitimement attendre des autorités et la jouissance effective par ce dernier de ses biens.
135. Dans la présente affaire, il ne fait aucun doute que le lien de causalité constaté entre les négligences graves imputables à l’Etat et les pertes en vies humaines survenues en l’espèce se retrouve également en ce qui concerne l’ensevelissement de la maison du requérant. Pour la Cour, l’atteinte qui en résulte ne s’analyse pas en une « ingérence », mais en la méconnaissance d’une obligation positive, les agents et autorités de l’Etat n’ayant pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour sauvegarder les intérêts patrimoniaux du requérant.
Le Gouvernement semble cependant s’en tenir à la notion du « but légitime », au sens du paragraphe 2 de l’article 1 du Protocole no 1, lorsqu’il conteste que l’on puisse reprocher aux autorités turques de s’être refusées, pour des considérations humanitaires, à détruire la maison du requérant (paragraphes 80 et 131 ci-dessus).
136. La Cour ne saurait toutefois accepter cet argument et, pour des raisons qui sont essentiellement les mêmes que celles exposées au regard de l’allégation de violation de l’article 2 (paragraphes 106 à 108 ci-dessus), elle considère que l’obligation positive au titre de l’article 1 du Protocole no 1 imposait qu’en l’espèce les autorités nationales prissent les mêmes précautions pratiques déjà indiquées pour empêcher la destruction de l’habitation du requérant.
137. Cela n’ayant assurément pas été le cas, il reste à répondre à l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant ne peut se prétendre victime d’une violation de son droit au respect de ses biens, dès lors qu’il s’est vu allouer une indemnité conséquente pour son préjudice matériel et qu’il a pu acquérir un logement social dans des conditions très favorables.
La Cour ne partage pas cet avis. Les avantages contractuels accordés lors de la vente du logement en question, à supposer même qu’ils aient pu compenser dans une certaine mesure l’effet des omissions constatées en l’espèce, ne pouvaient néanmoins s’analyser en un véritable dédommagement du préjudice du requérant. Quels que soient ces avantages, ils ne pouvaient donc faire perdre à M. Öneryıldız sa qualité de « victime », d’autant moins que la lecture des documents de vente versés au dossier ne dénote nullement une reconnaissance par les autorités d’une violation du droit de l’intéressé au respect de ses biens (voir, mutatis mutandis, Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil 1996-III, p. 846, § 36, et Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI).
Pour ce qui est de l’indemnité accordée au titre du dommage matériel, il suffit d’observer que celle-ci demeure impayée, au mépris d’un jugement définitif (paragraphe 42 ci-dessus), circonstance qui ne peut que s’analyser en une ingérence dans la jouissance d’un droit de créance acquis, lui aussi protégé par l’article 1 du Protocole no 1 (Antonakopoulos et autres c. Grèce, no 37098/97, § 31, 14 décembre 1999).
Toutefois la Cour s’estime dispensée d’examiner d’office cette question, compte tenu de son appréciation consacrée à l’article 13 de la Convention.
138. Partant, il y a eu en l’espèce violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
139. Le requérant se plaint que les voies de recours internes qu’il a exercées n’ont pas répondu à son attente. Leur ineffectivité a emporté violation de l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
140. Le Gouvernement réfute cette allégation, mettant en avant l’issue des procédures nationales devant les juridictions tant pénales qu’administratives.
A. L’arrêt de la chambre
141. Eu égard à sa conclusion relative aux griefs tirés des articles 2 de la Convention et 1 du Protocole no 1, la chambre a jugé inutile de réexaminer sous l’angle de l’article 13 les allégations de l’intéressé concernant les carences des instances pénales et administratives. Dans les circonstances particulières de la cause, ni le procès de droit pénal ni l’action administrative ne se sont avérés conformes aux obligations procédurales découlant de l’article 2 ou susceptibles d’offrir un redressement approprié pour les griefs du requérant. En premier lieu, la procédure pénale s’est déroulée de telle façon que l’accent a été déplacé de l’aspect crucial de l’affaire tenant au risque pour la vie à la question de savoir si les maires pouvaient ou non être tenus pour responsables de « négligence dans l’accomplissement de leurs fonctions ». En second lieu, l’indemnité accordée au requérant par la juridiction administrative ne correspondait en rien à la perte réellement subie par l’intéressé. Enfin, non seulement la procédure s’est étendue sur une durée excessivement longue, mais en outre le montant finalement octroyé au requérant n’a en fait jamais été versé.
B. Arguments des comparants
1. Le Gouvernement
142. Le Gouvernement reproche à la chambre ses critiques concernant la procédure pénale engagée à l’encontre des deux maires. Il souligne qu’il revient aux seules autorités nationales de déterminer la nature des accusations pénales portées contre un défendeur. De même, il n’appartient pas à la haute juridiction de Strasbourg de mettre en cause le verdict auquel est parvenu un tribunal national sur la base des éléments produits devant lui, sous peine d’y substituer ce qu’elle estime être le verdict convenable. Le Gouvernement rappelle que ni la Convention ni la jurisprudence qui en est issue n’obligent les autorités nationales à garantir la condamnation d’un défendeur. La suggestion de la chambre selon laquelle le verdict prononcé à l’égard des maires revenait à leur accorder une impunité presque totale fait abstraction tant de cet argument que du pouvoir discrétionnaire des autorités nationales de qualifier les charges pénales à la lumière des circonstances d’une affaire particulière, y compris dans les situations, telles que celles de l’espèce, où le requérant n’a jamais allégué que les maires mis en cause se sont rendus coupables, par leur négligence, d’avoir infligé la mort illégalement.
143. Pour le Gouvernement, les mêmes arguments relatifs à une « quatrième instance » s’appliquent à la décision à laquelle est parvenue la juridiction administrative quant à la demande d’indemnisation du requérant. Considérant que M. Öneryıldız a été relogé dans des conditions très favorables, le montant accordé était en fait substantiel. L’intéressé a en effet thésaurisé sur son nouveau logement, d’abord en le louant pour 48,46 dollars américains (USD) par mois (alors qu’il remboursait mensuellement 17,5 USD aux autorités), puis en acceptant de le vendre pour 20 000 marks allemands, montant bien supérieur à la valeur de la maison au moment où elle lui a été attribuée (125 millions de TRL). Le Gouvernement soutient en outre que, contrairement à ce que conclut la chambre, la demande d’indemnisation a donné lieu à une décision dans un délai raisonnable, et certainement beaucoup plus rapidement que, par exemple, dans l’affaire Calvelli et Ciglio (précitée) dans laquelle la Cour a estimé que la période de six ans et trois mois qui avait été nécessaire pour trancher une action civile pour homicide par négligence ne pouvait pas passer pour soulever une question sous l’angle de l’article 2. En outre, le requérant n’a pas réclamé le montant qui lui a été octroyé.
2. Le requérant
144. Le requérant souscrit en substance aux conclusions de la chambre quant aux lacunes qu’elle a mises en évidence dans les procédures pénales et administratives. Toutefois, selon lui, il faut considérer que l’ineffectivité de ces procédures emporte également violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 2 et l’article 1 du Protocole no 1.
C. Appréciation de la Cour
1. Principes applicables au cas d’espèce
145. L’article 13 de la Convention exige que l’ordre interne offre un recours effectif habilitant l’instance nationale à connaître du contenu d’un grief « défendable » fondé sur la Convention (Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 108, CEDH 2001-V). L’objet de cette disposition est de fournir un moyen au travers duquel les justiciables puissent obtenir, au niveau national, le redressement approprié des violations de leurs droits garantis par la Convention, avant d’avoir à mettre en œuvre le mécanisme international de plainte devant la Cour (Kudła c. Pologne [GC], no 31210/96, § 152, CEDH 2000-XI).
146. Toutefois, la protection offerte par l’article 13 ne va pas jusqu’à exiger une forme particulière de recours, les Etats contractants jouissant d’une certaine marge d’appréciation pour honorer les obligations qu’elle leur impose (voir, par exemple, Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 329-330, § 106).
147. La nature du droit en jeu a des implications pour le type de recours que l’Etat se doit d’offrir au titre de l’article 13. S’agissant des allégations de violation des droits consacrés par l’article 2, une indemnisation des dommages – matériel aussi bien que moral – est en principe possible et fait partie du régime de réparation devant être mis en place à ce titre (arrêts Paul et Audrey Edwards, précité, § 97, Z et autres c. Royaume-Uni, précité, § 109, et T.P. et K.M. c. Royaume-Uni [GC], no 28945/95, § 107, CEDH 2001-V).
En revanche, comme la Cour l’a déjà souligné (paragraphe 96 ci‑dessus), ni l’article 13 ni aucune autre disposition de la Convention ne garantit à un requérant le droit de faire poursuivre et condamner des tiers ou le droit à la « vengeance privée » (Perez, précité, § 70).
148. Il est vrai que la Cour a parfois constaté une violation de l’article 13 dans des affaires portant sur des allégations d’homicide illégal perpétré par des agents des forces de l’ordre ou avec leur connivence (voir, par exemple, la jurisprudence citée au paragraphe 73 de l’arrêt Kılıç susmentionné), au motif que les autorités n’avaient pas mené d’enquête approfondie et effective propre à conduire à l’identification et à la punition des responsables (Kaya, précité, pp. 330-331, § 107). Il y a toutefois lieu de noter que ces affaires, qui avaient pour origine le conflit qui sévissait dans le Sud-Est de la Turquie dans les années 90, étaient marquées par l’absence de telles enquêtes sur les griefs des requérants relatifs à l’homicide illégal d’un proche par des agents des forces de l’ordre ou à son décès dans des circonstances suspectes.
C’est précisément cet élément qui a amené la Cour à conclure que dans ces affaires les requérants avaient été privés d’un recours effectif, en ce sens qu’ils n’ont pas eu la possibilité de voir établir les responsabilités pour les faits dénoncés et, en conséquence, de pouvoir réclamer une réparation appropriée, que ce soit en se constituant partie intervenante dans une procédure pénale ou en saisissant les juridictions civiles ou administratives. Autrement dit, il existait un rapport procédural concret et étroit entre l’enquête pénale et les recours dont disposaient ces requérants dans l’ordre juridique dans son ensemble (voir, par exemple, Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 109, CEDH 2000-VII).
Toutefois, pour la Cour, si l’on se place sous la perspective des intérêts de la famille du défunt et de son droit à un recours effectif, il ne découle pas forcément de la jurisprudence susmentionnée que l’article 13 sera enfreint si l’enquête pénale ou le procès qui s’ensuit dans une affaire donnée ne satisfait pas à l’obligation procédurale imposée par l’article 2, telle qu’elle est résumée par exemple dans l’arrêt Hugh Jordan précité (paragraphe 94 ci-dessus).
Ce qui importe, ce sont les conséquences qu’a le manquement de l’Etat à l’obligation procédurale qui pèse sur lui en vertu de l’article 2 pour l’accès de la famille du défunt à d’autres recours disponibles et effectifs permettant d’établir la responsabilité d’agents ou d’organes de l’Etat à raison d’actes ou d’omissions entraînant la violation des droits des intéressés au titre de l’article 2 et, le cas échéant, d’obtenir réparation.
149. La Cour a déclaré que pour les accidents mortels provoqués par des activités dangereuses relevant de la responsabilité de l’Etat, l’article 2 requiert que les autorités mènent de leur propre initiative sur la cause du décès une enquête répondant à certaines conditions minimales (paragraphes 90, 93-94 ci-dessus). Elle observe en outre qu’à défaut d’une telle enquête la personne concernée peut se trouver dans l’impossibilité d’exercer un recours qui s’offre à elle pour obtenir réparation, car les agents ou les autorités de l’Etat sont souvent les seuls à disposer des informations nécessaires pour élucider les faits, tels que ceux en cause dans la présente affaire.
Eu égard à ce qui précède, il incombe en l’espèce à la Cour sur le terrain de l’article 13 de rechercher si le requérant s’est vu entraver dans l’exercice d’un recours effectif de par la façon dont les autorités se sont acquittées de l’obligation procédurale que l’article 2 fait peser sur elles (voir, mutatis mutandis, les arrêts Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2286, § 95, Aydın c. Turquie, 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 1895-1896, § 103, et Kaya, précité, pp. 329-330, § 106).
2. Application de ces principes au cas d’espèce
a) Quant au grief tiré de l’article 2 de la Convention
150. La Cour s’est déjà prononcée sur les procédures mises en place en Turquie et a conclu que, dans la présente affaire, les poursuites entamées par les autorités publiques en vertu du droit pénal se sont avérées insuffisantes pour protéger le droit à la vie, en dépit des résultats obtenus lors des investigations officielles, qui avaient permis d’établir les faits et d’identifier les responsables de l’accident du 28 avril 1993 (paragraphes 113-114 ci-dessus).
Cependant, vu l’adéquation et les résultats de ces investigations, la Cour estime que le requérant était en mesure d’exercer les voies de recours dont il disposait en droit turc afin d’obtenir réparation.
151. Le 3 septembre 1993, soit quelques mois après la clôture des investigations (paragraphe 29 ci-dessus), le requérant, alors représenté par un conseil, a choisi d’intenter contre quatre autorités de l’Etat une action de pleine juridiction devant les tribunaux administratifs, en faisant valoir son préjudice matériel et moral à raison de la mort de ses neuf proches ainsi que de la perte de sa maison et de ses biens ménagers. L’effectivité de ce recours ne dépendait pas de l’issue du procès pénal en cours d’instance et son accès n’avait pas été entravé par des actes ou omissions des autorités (Kaya, précité, pp. 329-330, § 106).
Les juridictions administratives appelées à statuer sur cette affaire avaient assurément le pouvoir d’apprécier les faits jusqu’alors établis, de déterminer les responsabilités pour les faits dénoncés et de rendre une décision exécutoire. La voie administrative empruntée par le requérant était a priori suffisante pour qu’il puisse faire valoir la substance de son grief tiré de la mort de ses proches et était susceptible de lui fournir le redressement approprié de la violation déjà constatée de l’article 2 (paragraphe 118 ci-dessus – voir, également, Paul et Audrey Edwards, précité, § 97, et Hugh Jordan, précité, §§ 162-163).
Reste cependant à savoir si ce recours était également effectif en pratique, eu égard aux circonstances de la présente cause.
152. A l’instar de la chambre, la Grande Chambre n’est pas convaincue que tel était le cas. Elle souscrit à diverses critiques de la chambre quant à l’ineffectivité de l’action en réparation (paragraphe 76 ci-dessus) et, comme celle-ci, elle juge déterminant que les dommages-intérêts accordés au requérant – uniquement au titre de son préjudice moral du fait de la perte de ses proches – ne lui ont en réalité jamais été versés.
Selon la jurisprudence pertinente de la Cour en la matière, le droit à un tribunal, tel que garanti par l’article 6, protège également l’exécution des décisions judiciaires définitives et contraignantes, lesquelles, dans les Etats où règne la prééminence du droit, ne sauraient demeurer inopérantes au détriment de l’une des parties (voir, par exemple, Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil 1997-II, pp. 510-511, § 40, Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 66, CEDH 1999-V). Pour la Cour, il n’a pas été expliqué de manière satisfaisante pourquoi le montant accordé n’a pas été payé. Elle estime qu’on ne saurait reprocher au requérant de ne pas avoir entrepris de démarches personnelles pour obtenir cette indemnité, eu égard au temps mis par le tribunal administratif pour statuer sur sa demande d’indemnisation et au fait que le montant accordé au titre du dommage moral n’était même pas assorti d’intérêts moratoires. Le versement à temps d’un montant définitif accordé à titre de réparation pour les tourments endurés doit être considéré comme un élément essentiel d’un recours sous l’angle de l’article 13 pour un conjoint et un parent en deuil (voir, mutatis mutandis, Paul et Audrey Edwards, précité, § 101).
Bien que le Gouvernement ait contesté la conclusion de la chambre selon laquelle la procédure aurait dû parvenir à son terme plus tôt, la Grande Chambre estime également qu’une période de quatre ans, onze mois et dix jours pour rendre une décision indique un manque de diligence de la part de la juridiction nationale, compte tenu spécialement de la situation désespérée du requérant. Tout bien pesé, il ressort clairement de la décision du 30 novembre 1995 que le tribunal interne s’est fondé entièrement sur l’expertise demandée par le procureur. Toutefois, cette expertise était disponible dès mai 1993 (paragraphe 23 ci-dessus).
153. Pour la Cour, ces raisons suffisent à conclure que la procédure administrative n’a pas offert au requérant un recours effectif lui permettant de faire valoir que l’Etat avait failli à protéger la vie de ses proches.
154. Cela étant, le Gouvernement reproche au requérant de n’avoir jamais tenté de participer effectivement au procès pénal susmentionné pour présenter ses griefs et redresser son tort (paragraphe 83 ci-dessus). Après avoir examiné les dispositions du droit turc, relatives à la constitution de partie intervenante (paragraphes 47-48 ci-dessus), la Cour admet que cette possibilité, intégrée au procès pénal, devrait en principe entrer en ligne de compte aux fins de l’article 13.
Or la Cour
considère qu’en l’espèce le
requérant,
qui a choisi d’exercer la voie de réparation
administrative, laquelle s’avérait
apparemment effective et de nature à remédier
directement à la situation
litigieuse, ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir
opté pour la voie de
réparation pénale (voir, mutatis
mutandis,
Manoussakis et autres c. Grèce,
arrêt
du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV,
pp. 1359-1360, § 33, Aquilina
c. Malte
[GC], no 25642/94, § 39, CEDH
1999-III), qui du reste ne pouvait
être utilisée parallèlement
à une action en réparation
déjà pendante
(paragraphe 48 ci-dessus).
155. Bref, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention quant au grief tiré de l’article 2.
b) Quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1
156. La Cour relève que le requérant a également obtenu une indemnité lors de la même procédure administrative examinée ci-dessus pour compenser la destruction de ses biens mobiliers, sauf en ce qui concerne les appareils électroménagers pour lesquels il a été conclu qu’il n’en était pas propriétaire (paragraphe 40 ci-dessus). Elle estime qu’elle n’a pas à se prononcer sur le caractère adéquat de la somme octroyée par la juridiction interne ou sur les modalités de son appréciation. Comme elle l’a déjà noté, le fait est que la décision sur l’indemnisation a été longue à venir et que le montant octroyé n’a jamais été versé. Par conséquent, le requérant s’est vu dénier un recours effectif qui lui aurait permis d’alléguer la violation de son droit au regard de l’article 1 du Protocole no 1.
S’il est vrai que le Gouvernement a invité la Cour à prendre en considération les avantages qui ont été accordés au requérant sous la forme d’un logement de substitution, elle estime qu’il s’agit là d’une question à examiner au regard de l’article 41 de la Convention. En tout état de cause, si ces avantages se sont avérés impuissants à priver le requérant de la qualité de victime d’une violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1 (paragraphe 137 ci-dessus), ils ne peuvent à plus forte raison le priver de son droit à disposer d’un recours effectif pour obtenir réparation de ladite violation.
157. Pour les raisons ci-dessus, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention également quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1.
IV. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 ET 8 DE LA CONVENTION
158. Le requérant dénonce la durée excessive de la procédure devant le tribunal administratif, laquelle ne saurait par ailleurs passer pour équitable, considérant le jugement partial auquel elle a abouti. A cet égard, il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont le passage pertinent se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le requérant se plaint enfin de ce que les circonstances de la cause ont en outre emporté violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que consacré par l’article 8 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
159. Le Gouvernement excipe du caractère manifestement mal fondé de ces griefs et attire l’attention sur le fait qu’aucun manque de diligence ni aucune ingérence ne sont imputables aux autorités turques, au sens des articles invoqués.
160. Eu égard aux circonstances particulières de la présente affaire ainsi qu’au raisonnement qui l’a conduite à constater une violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 (paragraphe 156 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner en outre l’affaire sous l’angle de l’article 6 § 1 (voir, mutatis mutandis, Immobiliare Saffi, précité, § 75).
Il en va de même en ce qui concerne le grief tiré de l’article 8 de la Convention, lequel porte sur les mêmes faits que ceux qu’elle a considérés au regard de l’article 2 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1. Compte tenu de ses constats de violation quant à ces dispositions, la Cour juge également inutile d’examiner ledit grief séparément.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
161. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
1. Arguments des parties
a) Le requérant
162. Devant la Cour, le requérant réitère les prétentions qu’il a formulées devant la chambre. Ainsi, il réclame :
– 2 000 dollars américains (USD) pour les dépenses funéraires encourues du fait du décès de ses neuf proches ;
– 100 000 USD pour la perte du soutien financier qu’il a encourue du fait du décès de ses deux compagnes, qui travaillaient à la journée comme femmes de ménage ;
– 150 000 USD pour la perte du soutien financier que ses sept enfants auraient pu lui apporter s’ils n’étaient pas décédés ;
– 50 000 USD pour la perte du soutien financier subie par ses trois enfants survivants du fait du décès de leur mère ;
– 98 000 USD pour la destruction de son habitation et de ses biens mobiliers.
Le requérant demande également, en son propre nom et au nom de ses trois enfants survivants, la somme de 800 000 USD pour préjudice moral.
b) Le Gouvernement
163. Le Gouvernement soutient à titre principal qu’aucune réparation ne s’impose dans cette affaire. A titre subsidiaire, il invite la Cour à rejeter les demandes présentées par le requérant, lesquelles seraient exorbitantes et fondées sur des estimations fictives.
En ce qui concerne le préjudice matériel, il fait valoir qu’une coupure de journal ne saurait servir à justifier des prétentions quant aux dépenses funéraires. Concernant la perte alléguée du soutien financier, il se borne à dire que la demande est purement et simplement spéculative.
Pour ce qui est de l’habitation et des biens mobiliers, le Gouvernement souligne l’absence d’un quelconque document justifiant la somme réclamée. Soutenant que le requérant n’avait jamais acquis la qualité de propriétaire du taudis en cause, le Gouvernement rappelle qu’un appartement beaucoup plus confortable lui avait été offert dans le district d’Alibeyköy, pour une somme qui, à l’époque, équivalait à 9 237 USD (9 966 euros (EUR)), dont seul le quart avait été versé comme acompte. A cet égard, il soumet des exemples d’annonces, dont il ressort que, dans cet arrondissement, des appartements similaires se vendent à des prix compris, en moyenne, entre 11 milliards et 19 milliards de livres turques (TRL) (environ 7 900 et 13 700 EUR respectivement). Pour ce qui est des biens mobiliers, le Gouvernement soumet des catalogues présentant de tels articles et attire l’attention sur la nécessité de tenir compte de l’indemnité octroyée par le tribunal administratif à ce titre.
Quant au préjudice moral, le Gouvernement estime que la demande est exorbitante et tend à un enrichissement sans cause, contraire à l’esprit de l’article 41 de la Convention. A cet égard, il reproche au requérant d’avoir à dessein choisi de ne pas réclamer le versement de l’indemnité allouée à ce titre par le tribunal administratif, dans l’espoir d’augmenter ainsi les chances de se voir octroyer par la Cour une somme plus importante.
2. L’arrêt de la chambre
164. Statuant en équité, la chambre a alloué au requérant 21 000 EUR au titre du préjudice matériel et 133 000 EUR au titre du préjudice moral, eu égard au sentiment de détresse que le requérant avait dû ressentir face à la réaction insatisfaisante de la justice turque quant aux décès dénoncés ainsi qu’aux souffrances endurées, en conséquence, par ses trois enfants encore en vie.
3. Appréciation de la Cour
165. La Cour a conclu à la violation du droit à la protection de la vie consacré par l’article 2 de la Convention ainsi que du droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1. Elle a également constaté une violation du droit à un recours interne effectif prévu par l’article 13 de la Convention quant à chacune de ces deux doléances.
a) Dommage matériel
166. La Grande Chambre observe, à l’instar de la chambre, que les violations en question ont certes lésé le requérant et qu’un lien de causalité manifeste existe entre celles-ci et les préjudices matériels allégués, lesquels peuvent inclure une indemnité au titre de la perte de sources de revenus (Salman, précité, § 137, et Z et autres c. Royaume-Uni, précité, § 119). Cependant, aucune des prétentions du requérant à ce titre ne sont dûment documentées ; les préjudices invoqués comportent des éléments qui ne se prêtent à aucun calcul exact ou qui sont si limités que toute évaluation ne peut qu’être en partie spéculative (voir, entre autres, les arrêts Sporrong et Lönnroth c. Suède (article 50), 18 décembre 1984, série A no 88, pp. 14-15, § 32, et Akdivar et autres c. Turquie (article 50), 1er avril 1998, Recueil 1998-II, p. 718, § 19).
La Cour appréciera donc en équité les prétentions du requérant au titre du dommage matériel, eu égard à l’ensemble des éléments en sa possession, comme le veut l’article 41.
167. S’agissant d’abord du remboursement des dépenses funéraires, le requérant produit un article paru dans le quotidien Sabah le 9 avril 2001, selon lequel une autre victime de l’accident du 28 avril 1993, M. C. Öztürk, aurait dû débourser 550 millions de TRL pour l’enterrement de son épouse et de ses quatre enfants. Le Gouvernement conteste la valeur probante de cette information, mais ne fournit pas pour autant d’autres éléments susceptibles d’éclairer la question.
La Cour juge que la somme réclamée n’est pas déraisonnable puisqu’en l’espèce le requérant a dû procéder à l’inhumation de ses neuf proches. Elle accorde donc en entier la somme réclamée à ce titre, à savoir 2 000 USD.
168. Quant à la perte alléguée de soutien financier, cette prétention n’est ni ventilée ni documentée. Cependant, à l’instar de la chambre, la Grande Chambre admet qu’en l’espèce chaque membre du foyer devait, d’une manière ou d’une autre, apporter sa contribution, ne serait-ce qu’accessoire, à la subsistance de tous, bien que l’éventualité d’un tel soutien de la part des sept enfants mineurs décédés lors de l’accident paraisse trop lointaine.
Tout bien considéré, la Cour estime qu’il convient d’octroyer à ce titre une somme globale de 10 000 EUR.
169. Quant à la perte alléguée liée à la destruction de l’habitation du requérant, la Cour considère d’emblée qu’en l’absence du moindre justificatif la somme réclamée paraît excessive. A ce sujet, elle estime que l’intérêt économique qu’a pu présenter le logement social acquis par l’intéressé doit entrer en ligne de compte dans l’appréciation du préjudice (paragraphe 156 ci-dessus), bien que cette tâche s’avère difficile non seulement du fait de la fluctuation constante des taux de change et d’inflation en Turquie, mais aussi en raison des transactions effectuées par le requérant sur son logement (paragraphe 30 ci-dessus).
La chambre a apprécié la question en présumant que la valeur de l’habitation détruite du requérant s’élevait à 50 % du prix d’un logement décent que la mairie métropolitaine proposait à l’époque dans le quartier de Çobançeşme. A ce sujet, la Grande Chambre note que, d’après une liste établie le 20 mars 2001 par la mairie métropolitaine d’Istanbul, dans le quartier de Çobançeşme, cette dernière proposait des logements en contrepartie d’environ 10,4 milliards de TRL, ce qui – à cette date – équivalait à 11 800 EUR.
Hormis cet élément, et toujours à partir de ses propres calculs – inévitablement approximatifs –, la Cour observe aussi que le 13 novembre 1993, date de la conclusion du contrat de vente du logement au requérant, la somme convenue de 125 millions de TRL équivalait à environ 8 500 EUR, dont le quart (2 125 EUR) était versé à titre d’acompte. Le restant, à savoir les 6 375 EUR, allait être payé en cent vingt mensualités, chacune de 732 844 TRL. Le 13 novembre 1993, ce montant équivalait à environ 53 EUR. Or, le 24 mars 1998, date où le requérant a promis de vendre son logement à E.B., le montant de la mensualité ne correspondait qu’à 3 EUR. D’après les calculs effectués sur la base des taux de change afférents à la période 13 novembre 1993-24 mars 1998, il ressort que la valeur moyenne des mensualités revenait à 15 EUR. Rien ne permettant de croire que le requérant ait continué de verser les mensualités après le 24 mars 1998, force est de présumer qu’à cette date, pour acquérir le logement, le requérant devait avoir payé, en sus de l’acompte, une somme équivalant environ à 780 EUR au titre des mensualités, soit un total d’environ 3 000 EUR, ce qui est largement inférieur à la valeur initiale du logement.
De plus, il faut savoir qu’au plus tard à partir de février 1995, sinon bien avant, le logement en question se trouvait loué à un certain H.Ö., moyennant un loyer de 2 millions de TRL, soit environ 41 EUR. Pendant cette période de location de trente-sept mois, qui a pris fin avec la promesse de vente du 24 mars 1998, le requérant a donc dû recevoir environ 1 500 EUR de loyers au minimum, alors que pour la même période il n’a dû verser que 550 EUR de mensualités.
De surcroît, à l’issue dudit contrat de promesse de vente, le requérant a reçu de E.B. 20 000 marks allemands : ce montant qui, à l’époque, correspondait à 10 226 EUR est largement supérieur à toute somme que le requérant aurait finalement dû débourser pour acquérir son logement.
Au vu de ce qui précède, à supposer que la valeur vénale du taudis du requérant puisse être estimée selon le critère adopté par la chambre et que l’intéressé ait dû dépenser une certaine somme pour se loger pendant la période où son appartement se trouvait en location, rien ne permet toutefois à la Cour de conclure que ces circonstances aient généré un préjudice excédant le bénéfice que le requérant semble avoir tiré des transactions qu’il a effectuées.
Il n’y a donc pas lieu d’octroyer au requérant une réparation du fait de la destruction de son habitation, le constat de violation représentant en soi une satisfaction équitable suffisante.
170. Quant à la valeur des biens mobiliers perdus lors de l’accident du 28 avril 1993, la Cour rappelle que le 30 novembre 1995, le tribunal administratif d’Istanbul a alloué au requérant à ce titre une indemnité de 10 millions de TRL (équivalant à l’époque à environ 208 EUR). Ce faisant, le tribunal a toutefois refusé de tenir compte de tout appareil électroménager dont le requérant aurait disposé, au motif que son habitation n’était pas alimentée en électricité (paragraphe 40 ci-dessus) ; de surcroît, la somme en question n’a jamais été versée au requérant. La Cour renvoie à ses conclusions relatives à ces points précis (paragraphes 152, 153 et 156 ci-dessus) et estime que le résultat auquel la procédure administrative a abouti ne saurait entrer en ligne de compte aux fins de l’article 41 de la Convention.
Ainsi et malgré l’absence en l’espèce d’une quelconque indication de la part du requérant quant à la nature et la quantité des biens mobiliers qu’il pouvait posséder, la Cour a examiné de près les prix des articles ménagers figurant dans les catalogues versés au dossier, compte tenu des méthodes de calcul déjà adoptées dans des affaires comparables (Akdivar et autres (article 50), précité, et Menteş et autres c. Turquie (article 50), arrêt du 24 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1693, § 12).
Partant, eu égard aux conditions de vie d’un ménage modeste, la Grande Chambre juge à l’instar de la chambre que des considérations d’équité justifient l’octroi d’une somme globale de 1 500 EUR de ce chef.
b) Dommage moral
171. Quant au dommage moral, la Grande Chambre ne voit aucune raison de se départir de la position de la chambre. Elle reconnaît que le requérant a sans nul doute souffert des suites des violations constatées des articles 2 et 13 de la Convention. Comme le Gouvernement, la Cour juge toutefois excessives les sommes réclamées à ce titre. Appelée à statuer en équité, elle doit tenir compte des circonstances particulières de la cause, y compris les souffrances qu’ont dû également endurer les trois enfants en vie du requérant, à savoir Hüsamettin, Aydın et Halef Öneryıldız, nés respectivement le 10 octobre 1980, le 10 octobre 1981 et le 10 juillet 1982.
Tout comme les constats de violation par la Cour, les décisions des juridictions turques postérieures à l’arrêt au principal réparent certes dans une certaine mesure le dommage moral du requérant, même si celles-ci n’ont pu effacer complètement le préjudice subi en l’occurrence. La Cour estime toutefois que l’indemnité de 100 millions de TRL (équivalant à l’époque à environ 2 077 EUR) allouée au requérant par les juridictions administratives au titre du préjudice moral, ne saurait être matériellement prise en compte au regard de l’article 41, dès lors que l’administration ne s’est jamais acquittée de cette somme et que, dans les circonstances très particulières de l’affaire, le choix du requérant de ne pas engager une procédure d’exécution forcée afin de l’obtenir ne peut s’analyser en une renonciation à ce droit (voir, mutatis mutandis, Neumeister c. Autriche (article 50), arrêt du 7 mai 1974, série A no 17, p. 16, § 36).
Tout bien pesé et s’inspirant de sa jurisprudence pertinente quant à l’application de l’article 41 concernant les enfants ou les proches mineurs des victimes de violations de l’article 2 (Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, §§ 8 et 130, CEDH 1999-IV), la Cour décide d’accorder en réparation du dommage moral 33 750 EUR à M. Maşallah Öneryıldız et à chacun de ses trois fils majeurs survivants, Hüsamettin, Aydın et Halef Öneryıldız, soit une somme de 135 000 EUR au total.
B. Frais et dépens
1. Arguments des parties
172. Le requérant réclame 50 000 USD au titre des honoraires, dont 20 000 USD pour le travail fourni par sa représentante aux fins de la procédure orale et écrite devant la Grande Chambre. Il affirme que la présentation de sa cause devant les juridictions nationales et devant les organes de Strasbourg a nécessité un travail de plus de 330 heures, à raison de 150 USD l’heure, selon ce qui ressort du tableau des honoraires minimum du barreau d’Istanbul.
173. Le
Gouvernement estime
que les prétentions du requérant pour les frais
et dépens sont, elles aussi,
excessives et non justifiées.
2. L’arrêt de la chambre
174. Au cours de la procédure devant la chambre, le requérant avait réclamé une indemnité de 30 000 USD au titre des honoraires et 790 USD pour dépenses diverses. Or, en l’absence de reçu ou d’autre justificatif, la chambre a déclaré n’être pas convaincue que le requérant ait déboursé ces sommes et lui a octroyé 10 000 EUR, moins les 2 286,50 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
3. Appréciation de la Cour
175. Le requérant a continué de bénéficier de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure prévue à l’article 43 de la Convention. Ainsi, en sus des 2 286,50 EUR qu’il avait déjà perçus du Conseil de l’Europe, il a également obtenu 1 707,34 EUR aux fins de la procédure de renvoi devant la Grande Chambre.
La Cour a toujours jugé que l’allocation de tels frais au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII). En l’espèce, le requérant n’a pas appuyé ses prétentions sur des documents pertinents ni fourni d’explications détaillées quant au travail effectué par sa représentante sur les questions relatives aux articles 2 et 13 de la Convention et 1 du Protocole no 1, dont la violation a été constatée.
Conformément à l’article 60 § 2 de son règlement, la Cour ne saurait donc accueillir la demande de l’intéressé telle quelle. Toutefois, celui-ci a nécessairement encouru des frais pour le travail fourni par son avocate aux fins de sa représentation dans la procédure tant écrite qu’orale devant les deux instances de la Convention (voir, mutatis mutandis, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 210, CEDH 2000-IV). La Cour est disposée à admettre que, dans la présente affaire, dont la complexité ne prête à aucune controverse, cette tâche ait nécessité le nombre d’heures invoqué. Cela étant, elle rappelle que s’agissant des honoraires, elle n’est liée ni par les barèmes ni par les pratiques internes, même si elle peut s’en inspirer (voir, par exemple, Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 316-B, p. 83, § 77).
Statuant en équité, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 16 000 EUR, moins les 3 993,84 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire pour l’ensemble de la procédure devant les organes de la Convention.
C. Intérêts moratoires
176. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention, sous son volet substantiel à raison de l’absence de mesures propres à empêcher la mort accidentelle des neuf proches du requérant ;
2. Dit, par seize voix contre une, qu’il y a également eu violation de l’article 2 de la Convention, sous son volet procédural, à raison de l’absence d’une protection adéquate par la loi, propre à sauvegarder le droit à la vie ;
3. Dit, par quinze voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit, par quinze voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention quant au grief tiré du volet substantiel de l’article 2 ;
5. Dit, par quinze voix contre deux, qu’il y a également eu violation de l’article 13 de la Convention quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 ;
6. Dit, à l’unanimité, qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain des articles 6 § 1 ou 8 de la Convention ;
7. Dit, à l’unanimité,
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois, les montants suivants, exempts de toute taxe et charge fiscale, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. au requérant, M. Maşallah Öneryıldız :
– 2 000 USD (deux mille dollars américains) et 45 250 EUR (quarante-cinq mille deux cent cinquante euros), pour le dommage matériel et le préjudice moral,
– 16 000 EUR (seize mille euros) pour frais et dépens, moins les 3 993,84 EUR (trois mille neuf cent quatre-vingt-treize euros quatre-vingt-quatre centimes) déjà perçus du Conseil de l’Europe,
ii. à chacun de ses fils majeurs, Hüsamettin, Aydın et Halef Öneryıldız, 33 750 EUR (trente-trois mille sept cent cinquante euros) pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
8. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 30 novembre 2004.
Luzius
Wildhaber
Président
Paul Mahoney
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :
– opinion en partie dissidente de M. Türmen ;
– opinion en partie dissidente de Mme Mularoni.
L.W.
P.J.M.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE TÜRMEN
(Traduction)
J’estime, à l’instar de la majorité, qu’il y a eu violation de l’article 2 sous son volet substantiel en raison du fait que les autorités n’ont pas pris les mesures appropriées pour préserver la vie de personnes relevant de leur juridiction.
Toutefois, je regrette de ne pouvoir souscrire à l’avis de la majorité selon lequel il y a eu en outre violation de l’article 2 sous son volet procédural ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 13.
1. Article 2 (volet procédural)
D’après l’arrêt, aucun problème ne se pose relativement à l’enquête (paragraphe 113), qui a permis d’identifier les responsables de l’incident et de les traduire en justice. Les deux maires ont été condamnés au titre de l’article 230 du code pénal turc.
Toutefois, la majorité conclut à la violation de l’article 2 sous son volet procédural au motif que les juridictions du fond n’ont pas établi la pleine responsabilité des agents de l’Etat ni garanti la mise en œuvre effective de dispositions du droit interne – c’est-à-dire au motif que les tribunaux nationaux ont appliqué l’article 230 du code pénal (négligence dans l’exercice de fonctions publiques) et non l’article 455 (homicide par imprudence ou négligence).
Je ne souscris pas à cette conclusion pour les raisons suivantes.
Premièrement, la majorité estime qu’il y a eu violation de l’article 2 sous son volet procédural, non pas en raison de l’absence d’enquête effective mais du fait de la procédure judiciaire ou, plus précisément, de l’application de la législation nationale. Il s’agit là d’une démarche entièrement nouvelle, qui ne se fonde sur aucun précédent dans la jurisprudence de la Cour. Si la majorité est d’avis que le recours qui existe en droit interne n’est pas effectif, alors le problème se pose sous l’angle de l’article 13, et non de l’article 2.
Deuxièmement, il paraît contradictoire de déclarer, d’une part, que l’enquête est effective et, d’autre part, que la décision de la juridiction nationale enfreint la Convention.
Pareil raisonnement ne tient pas compte de ce que cette décision se fonde sur les éléments qui ont été établis par l’enquête. Comment la Cour peut-elle alors critiquer la décision du juge national tout en admettant le caractère effectif de l’enquête ? Dans des circonstances où l’enquête est effective, un constat de violation de l’article 2 sous son aspect procédural
exigerait de sa part un examen des faits, donc l’amènerait à s’ériger en juridiction de quatrième instance. Or, conformément à sa jurisprudence constante, c’est aux autorités nationales qu’il incombe d’établir les faits et d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, parmi d’autres, Kemmache c. France (no 3), arrêt du 24 novembre 1994, série A no 296-C, pp. 86-87, § 37, et Kaymaz c. Turquie (déc.), no 37053/97, 16 mars 2000).
Troisièmement, la majorité n’attache aucune importance à la circonstance que le requérant, par son propre comportement, a contribué à générer un risque pour la vie humaine et a causé la mort de neuf membres de sa propre famille. Il n’est pas contesté que l’intéressé a construit un logement illégal a) sur un terrain qui ne lui appartenait pas, et b) à proximité du dépôt d’ordures.
La négligence des autorités et celle du requérant constituent des éléments essentiels de la causalité. Toutes deux sont des conditions sine qua non de la réalisation du dommage. Aucune des deux n’aurait suffi à elle seule à occasionner le préjudice. La mort de neuf personnes a résulté de la négligence des autorités et de celle du requérant.
Par ailleurs, une infraction indépendante a été commise par les maires, à savoir une faute dans l’exercice de leurs fonctions. La 5e chambre du tribunal correctionnel d’Istanbul, dans sa décision du 4 avril 1996, a pris tous ces éléments en compte et a décidé d’appliquer l’article 230 du code pénal (négligence dans l’exercice de fonctions publiques) et non l’article 455 (homicide par négligence). En fait, les deux maires ont été condamnés au titre de l’article 230. La Cour de cassation a confirmé le jugement, lequel établit la responsabilité des deux maires et du requérant quant au décès de neuf personnes. Les juges du tribunal correctionnel d’Istanbul ont également pris en considération le rapport d’expertise, qui répartit les responsabilités pour l’accident comme suit : 2/8 à la charge de la mairie d’Istanbul, 2/8 à la charge de la mairie d’Ümraniye, et 2/8 à la charge des habitants du bidonville « pour avoir mis en danger les membres de leurs familles en s’installant à proximité d’une montagne d’ordures » (paragraphe 23 de l’arrêt). Dès lors, contrairement à ce qui est dit au paragraphe 116 de l’arrêt, il n’est pas vrai que les tribunaux nationaux ont failli à reconnaître « une quelconque responsabilité pour un manquement à la sauvegarde du droit à la vie ». La juridiction nationale a pesé les responsabilités du requérant et des maires et est parvenue à une conclusion dans le cadre de sa marge d’appréciation, ce qui est du reste admis par la majorité, qui déclare au paragraphe 116 que « la Cour n’a pas à répondre à de telles questions de droit interne concernant la responsabilité pénale individuelle, dont l’appréciation relève des juridictions nationales, et il n’entre pas dans ses attributions de rendre des verdicts de culpabilité ou d’innocence à cet égard ».
Toutefois, pareille confirmation expresse des limites entre la compétence des juridictions nationales et celle de la Cour de Strasbourg, qui se situe dans le droit fil de la jurisprudence de cette dernière, fait que l’on saisit encore moins la raison à l’origine du constat de violation de l’article 2 sous son volet procédural. Pour la majorité, les questions de droit interne concernant la responsabilité pénale individuelle relèvent de l’appréciation des juridictions nationales, mais si pareille juridiction décide pour de bonnes raisons d’appliquer une disposition du code pénal plutôt qu’une autre, cela peut s’analyser en une absence de protection par la loi propre à sauvegarder le droit à la vie.
Quatrièmement, la majorité ne dit pas clairement dans l’arrêt pourquoi elle a décidé de modifier les principes établis par la jurisprudence de la Cour concernant l’absence d’un recours de droit pénal dans les affaires relatives à des pertes accidentelles en vies humaines. Dans les arrêts Calvelli et Ciglio c. Italie ([GC], no 32967/96, CEDH 2002-I), Mastromatteo c. Italie ([GC], no 37703/97, CEDH 2002-VIII) et Vo c. France ([GC], no 53924/00, CEDH 2004-VIII), la Cour a déclaré que « si l’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité physique n’est pas volontaire, l’obligation positive découlant de l’article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale ». En l’espèce, la majorité s’est écartée de cette jurisprudence. Au paragraphe 93 de l’arrêt elle formule l’avis que « dans des domaines tels que celui en cause en l’espèce [on peut supposer qu’il s’agit de celui des dommages causés à l’environnement], les principes applicables doivent davantage être trouvés dans ceux [développés] notamment en matière de recours à la force meurtrière (...) ».
Que ce soit dans l’affaire Calvelli et Ciglio ou en l’espèce, ce qui est en cause du point de vue du droit pénal, c’est l’homicide par négligence. En ce qui concerne le degré de négligence, il est difficile d’opérer une distinction entre la négligence d’un gynécologue qui savait que la naissance d’un enfant présentait des risques élevés, compte tenu de ce que la mère était atteinte d’un diabète de niveau A et que le fœtus était trop gros pour une naissance naturelle, et qui pourtant non seulement n’a pas pris de mesures préventives mais qui de plus s’est absenté lors de l’accouchement (Calvelli et Ciglio), et celle de deux maires qui auraient dû savoir à partir du rapport d’expertise que la décharge impliquait des risques élevés et qui n’ont cependant pris aucune mesure pour prévenir un tel accident.
2. Article 1 du Protocole no 1
En ce qui concerne l’article 1 du Protocole no 1, je souscris pleinement aux thèses exprimées par Mme la juge Mularoni au paragraphe 2 de son opinion en partie dissidente.
Il est remarquable que la Cour, immédiatement après l’arrêt Kopecký c. Slovaquie ([GC], no 44912/98, CEDH 2004-IX), dans lequel elle confirme sa jurisprudence concernant la signification du terme « bien » au regard de la Convention, introduit à présent un nouveau critère quant à la détermination d’un bien – la tolérance des autorités nationales. Ce nouveau concept, je le crains, pourrait avoir des conséquences indésirables, par exemple une extension de la protection de la Convention à des immeubles construits en violation de la loi, et pourrait encourager des situations illégales.
3. Article 13
Après s’être penchée sur l’effectivité du recours en matière pénale sous l’angle de l’article 2, la majorité limite la portée de son examen du grief tiré de l’article 13 à l’effectivité du recours de droit administratif.
Dans un arrêt du 30 novembre 1995, le tribunal administratif d’Istanbul a ordonné aux autorités nationales de verser au requérant et à ses enfants 100 millions de livres turques (TRL) pour préjudice moral et 10 millions de TRL pour dommage matériel. La décision a été signifiée au requérant.
Comme l’arrêt de la chambre l’énonce clairement, « (...) l’intéressé n’a jamais demandé le versement de l’indemnité allouée, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas » (paragraphe 117 de l’arrêt de la chambre ; cet élément a disparu dans l’arrêt de Grande Chambre).
Le requérant ne s’est pas plaint du non-paiement de l’indemnité parce qu’il ne souhaitait pas la recevoir. Il l’aurait perçue s’il avait pris contact avec la mairie et donné son numéro de compte bancaire. Comment les autorités pourraient-elles procéder au versement sans connaître l’adresse ou les coordonnées bancaires de l’intéressé ?
Il n’est donc pas légitime de tenir le Gouvernement pour responsable du non-versement de cette indemnité.
Quant à la durée de l’instance devant le tribunal administratif, la majorité déclare que cette procédure s’était étendue sur quatre ans, onze mois et dix jours, ce qui enlèverait toute effectivité au recours devant cette juridiction.
Je ne suis pas d’accord avec ce point de vue.
La procédure a duré quatre ans et onze mois pour quatre degrés de juridiction. Les faits de l’affaire révèlent qu’il n’y a pas eu de période d’inactivité importante imputable aux juridictions nationales.
La majorité dit qu’il y a eu « manque de diligence de la part de la juridiction nationale », sans toutefois motiver cette conclusion. Elle y parvient sans avoir examiné la procédure et sans avoir appliqué les critères bien établis de la Cour concernant la durée de procédures, à savoir la complexité de l’affaire, la conduite du requérant et celle des autorités judiciaires.
En conclusion, il n’y a pas eu violation de l’article 13.
4. Article 41
Je suis d’accord avec le montant de la satisfaction équitable à verser au requérant. Toutefois, je n’adhère pas au raisonnement sous-jacent au calcul de cette indemnité. Il semble que dans le cadre de ce calcul on ait accordé la même importance aux neuf personnes appartenant au foyer du requérant, qui sont décrites comme des « proches » de celui-ci (paragraphe 167 de l’arrêt). Toutefois, il ressort clairement du paragraphe 3 de l’arrêt que l’une de ces « proches », Sıdıka Zorlu, était la « concubine » de l’intéressé. C’est peut-être la première fois que la Cour, pour décider du montant à verser au titre de la satisfaction équitable, prend en compte la concubine d’un requérant et lui donne la même importance qu’à son épouse et ses enfants. Pareille approche pourrait avoir des conséquences indésirables sur la jurisprudence de la Cour à l’avenir.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE Mme LA JUGE MULARONI
1. Je souscris entièrement au raisonnement et aux conclusions de la majorité concernant l’article 2 de la Convention, aussi bien sous son volet substantiel que sous son aspect procédural.
2. Par contre, j’estime que l’article 1 du Protocole no 1 est inapplicable. Cet article garantit le respect du droit de propriété. Dans sa jurisprudence, la Cour a précisé la notion de bien : elle peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété. Toutefois, l’espoir de voir reconnaître un droit de propriété que l’on est dans l’impossibilité d’exercer effectivement ne peut être considéré comme un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, entre autres, Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, série A no 31, p. 23, § 50, Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, § 83, CEDH 2001-VIII, et Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, CEDH 2004-IX).
Nul n’a contesté devant la Cour que l’habitation du requérant était érigée en violation de la réglementation turque en matière d’aménagement urbain et contrevenait aux normes techniques en la matière, ni le fait que le terrain ainsi occupé appartenait au Trésor public (paragraphe 125 de l’arrêt). Le requérant n’a pas prouvé qu’il avait un droit de propriété sur le terrain ni qu’il pouvait légitimement demander que lui soit transférée la propriété du bien en vertu de l’article 21 de la loi no 775 du 20 juillet 1966 ou en vertu des modifications successives de cette loi.
La majorité reconnaît que « la Cour ne saurait conclure que l’espoir du requérant de se voir un jour céder le terrain en cause constituait une forme de créance suffisamment établie au point de pouvoir être revendiquée en justice, donc un « bien » distinct au sens de la jurisprudence de la Cour » (paragraphe 126 de l’arrêt in fine). Mais au lieu de tirer les conséquences de ce raisonnement et de conclure à l’inapplicabilité de l’article 1 du Protocole no 1, elle adopte un nouveau critère d’applicabilité de cet article : l’existence d’une tolérance des autorités compétentes pendant presque cinq ans face aux actions du requérant, qui permettrait de juger que lesdites autorités ont de facto reconnu que le requérant et ses proches avaient un intérêt patrimonial tenant à leur habitation et à leurs biens meubles (paragraphe 127 de l’arrêt), intérêt suffisamment important et reconnu pour constituer un intérêt substantiel, donc un « bien » au sens de la norme exprimée dans la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1 (paragraphe 129 de l’arrêt).
Je ne saurais souscrire à ce raisonnement.
J’estime que ni une tolérance implicite ni d’autres considérations d’ordre humanitaire ne peuvent suffire à légitimer l’action du requérant sous l’angle
de l’article 1 du Protocole no 1. Ces facteurs ne devraient pas non plus, à mon avis, être pris en compte par la Cour pour fonder une conclusion qui équivaudrait à soustraire les requérants (aujourd’hui M. Öneryıldız mais aussi à l’avenir tout autre requérant ayant érigé un bâtiment de façon illégitime) du champ d’application de la législation nationale en matière d’urbanisme et de construction et, d’une certaine manière, à cautionner indirectement la propagation des quartiers de baraquements.
Il me semble que la conclusion de la majorité quant à l’applicabilité de l’article 1 du Protocole no 1 risque d’entraîner des résultats paradoxaux. Je pense par exemple aux magnifiques villas et hôtels bâtis illégalement au bord de la mer ou dans d’autres lieux pour lesquels, aux termes de la législation nationale, la prescription acquisitive ne joue pas ; est-ce que le simple fait que les autorités compétentes ont toléré ces bâtiments pendant cinq ans suffira dorénavant pour soutenir que ceux qui ont construit en toute illégalité ont un grief défendable sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 ? Cette conclusion rendrait beaucoup plus difficile toute action des autorités (soit au niveau national, soit au niveau local) tendant à faire respecter la loi et la réglementation en matière d’aménagement urbain face, par exemple, à une situation d’illégalité dont elles auraient hérité après une période de gestion par des administrations moins scrupuleuses.
Enfin, j’ai du mal à admettre que dans le cas de bâtiments érigés en violation de la réglementation en matière d’aménagement urbain les Etats aient désormais l’obligation positive de sauvegarder un droit de propriété qui n’a jamais été reconnu par le droit interne, et qui ne saurait l’être puisqu’il pourrait dans de nombreuses situations s’exercer au détriment des droits d’autrui et de l’intérêt général.
Je conclus donc que l’article 1 du Protocole no 1 n’est pas applicable et, par conséquent, qu’il n’a pas été violé.
J’ajoute que même si j’avais conclu à l’applicabilité de l’article 1 du Protocole no 1 – ce qui, je le répète, n’est pas le cas – j’aurais considéré, contrairement à la majorité (paragraphe 137 de l’arrêt), que le requérant ne pouvait plus se prétendre victime. J’estime que l’attribution d’un logement social dans des conditions très favorables peut être considérée comme une reconnaissance en substance d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1, pareille mesure étant probablement la meilleure forme de réparation envisageable en l’espèce.
3. Eu égard aux circonstances de la présente affaire ainsi qu’au raisonnement qui a amené la Cour à constater une violation de l’article 2 de la Convention, sous son volet procédural, j’estime qu’il n’était pas nécessaire d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 13 quant au grief tiré du volet substantiel de l’article 2.
4. Compte tenu des conclusions auxquelles je suis parvenue sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, je considère qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1.