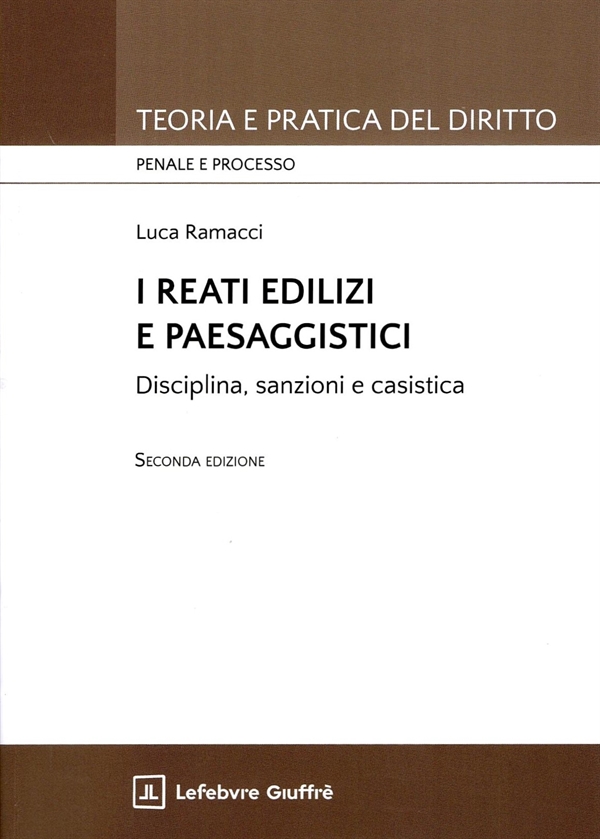CEDU DEUXIÈME SECTION sentenza 24 febbraio 2009
AFFAIRE L’ERABLIERE A.S.B.L. c. BELGIQUE (Requête no 49230/07)
Ambiente in genere. Accesso a un tribunale da parte di un’associazione ambientalista
Ambiente e accesso a un tribunale da parte di un’associazione ambientalista: la CEDU condanna il Belgio per non aver accolto un ricorso presentato per l’annullamento di uno strumento urbanistico (nota di Antonella MASCIA)
AFFAIRE L’ERABLIERE A.S.B.L. c. BELGIQUE (Requête no 49230/07)
Ambiente in genere. Accesso a un tribunale da parte di un’associazione ambientalista
Ambiente e accesso a un tribunale da parte di un’associazione ambientalista: la CEDU condanna il Belgio per non aver accolto un ricorso presentato per l’annullamento di uno strumento urbanistico (nota di Antonella MASCIA)
Strasburgo, 13 febbraio 2010 – Con sentenza del 24 febbraio 2009, nel caso L’Erablière A.S.B.L. c. Belgio (ricorso n. 49230/07), la CEDU ha ritenuto applicabile l’art. 6 § 1 della Convenzione.
In questa vicenda un’associazione ambientalista locale aveva presentato un ricorso in annullamento contro un permesso di urbanizzazione, successivamente dichiarato inammissibile dal giudice nazionale perché l’esposizione dei fatti non era stata ritenuta idonea ad identificare l’oggetto del contendere.
La CEDU ha ritenuto applicabile l’art. 6, riconoscendo la violazione di tale disposizione per mancato accesso a un tribunale, tenuto conto della natura dell’atto impugnato, delle caratteristiche dell’associazione, dello scopo e della sua attività, circoscritta ad un territorio locale.
A mio avviso il caso è interessante perchè spesso, anche in Italia, i giudici amministrativi, pur riconoscendo una legittimazione delle associazioni ad impugnare provvedimenti amministrativi, poi ritengono i loro ricorsi inammissibili qualora siano stati presentati contro strumenti urbanistici.
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE L’ERABLIERE A.S.B.L. c. BELGIQUE
(Requête no 49230/07)
ARRÊT
STRASBOURG
24 février 2009
DÉFINITIF
24/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire L’Erablière A.S.B.L. c. Belgique,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Ireneu Cabral Barreto, président,
Françoise Tulkens,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 février 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 49230/07) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont une association sans but lucratif ayant son siège social à Bande, L’Erablière A.S.B.L. (« la requérante »), a saisi la Cour le 5 novembre 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me A. Lebrun, avocat à Grivegnée. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Daniel Flore, Directeur général au Service public fédéral de la Justice.
3. La requérante alléguait une violation du droit d’accès à un tribunal (article 6 § 1 de la Convention).
4. Le 16 mai 2008, le vice-président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La requérante est une association sans but lucratif qui a pour objet, selon ses statuts « de défendre l’environnement de la région de Marche Nassogne. Elle recouvre essentiellement les communes de Nassogne, La Roche-en-Ardenne, Marche-en-Famenne, Rendeux, et Tenneville. L’environnement s’entend des qualités et des diversités des écosystèmes et des espaces naturels ou semi-naturels, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, de la valeur paysagère, de l’eau, de l’air et autres éléments vitaux pour les êtres humains, ainsi que de la quiétude des lieux. Elle peut poser tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son but (...) ».
6. Sont membres de l’association ses fondateurs ainsi que toute personne admise par une assemblée générale à la majorité simple ou par le conseil d’administration à la majorité des deux tiers. Il ressort de la publication des liste des fondateurs et administrateurs de la requérante que ceux-ci sont tous domiciliés dans les communes susmentionnées.
7. Le 26 septembre 2002, la société coopérative Idelux introduisit une demande de permis d’urbanisme tendant à l’extension du centre d’enfouissement technique de classe 2 et 3, au lieu-dit « Al Pisserotte » auprès du fonctionnaire délégué de la province du Luxembourg. Il était prévu une augmentation de la capacité de la décheterie de plus du cinquième de sa capacité initiale. Dans son préambule, le permis d’urbanisme reprenait l’ensemble des circonstances ayant conduit à son adoption.
8. Le 5 janvier 2004, la commune de Tenneville adressa une lettre à la requérante l’informant que le permis d’urbanisme avait été octroyé à la société Idelux le 23 décembre 2003 et qu’il était possible pour la requérante d’intenter un recours en annulation devant le Conseil d’Etat.
9. Le 5 mars 2004, la requérante introduisit une requête tendant à annuler la décision du fonctionnaire délégué ainsi qu’à suspendre l’exécution de celle-ci. Les moyens soulevés étaient pris notamment des textes tels que la directive 85/337 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la directive 1999/31 concernant la mise en décharge des déchets, le décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la région wallonne et la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
10. Dans cette requête, longue de dix-sept pages, sous le titre « exposé des faits », la requérante indiquait ce qui suit :
« L’exposé des faits est repris à suffisance dans les considérants de l’acte attaqué. Cet acte attaqué a été notifié à la requérante par courrier du 5 janvier 2004, reçu par elle le 7 janvier. »
11. L’acte attaqué était joint en pièce no 1 à la requête en annulation.
12. Se fondant sur l’article 2 § 1, 2o de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, la partie adverse soutenait que la requête en annulation devait être déclarée irrecevable du fait qu’elle ne comportait pas d’exposé des faits.
13. Par un arrêt du 8 septembre 2004, le Conseil d’Etat rejeta la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Il souligna que l’exposé des faits devait être suffisamment complet et précis pour permettre, à sa seule lecture, de comprendre les circonstances de fait du litige. Il conclut que les pièces jointes à la demande de suspension ne pouvaient être considérées comme l’équivalent d’un exposé des faits.
14. Dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, la requérante fit valoir que l’exposé des faits ne constituait pas, dans le cadre d’un recours en annulation, une condition de recevabilité, au contraire de l’exposé des faits dans la demande de suspension. Elle ajouta que l’exposé des faits très succinct ne compromettait pas le déroulement du procès, alors même que la partie adverse connaissait parfaitement les faits, ne s’était pas méprise sur la portée des moyens et était au courant des faits qui en constituaient la base.
15. Par un arrêt du 26 avril 2007, le Conseil d’Etat déclara irrecevable le recours en annulation de la requérante. Il considéra que la requête, faute de contenir un exposé des faits, renvoyait uniquement à l’acte attaqué et apportait une précision quant à la date de sa notification. L’exposé des faits était plutôt inexistant qu’incomplet, ainsi que le soutenait la requérante. Le fait que la partie adverse aurait parfaitement été au courant des antécédents de la cause était sans pertinence pour apprécier si la requête en annulation, destinée à éclairer le Conseil d’Etat et l’auditeur chargé de l’instruction du dossier, comportait un exposé des faits satisfaisant aux exigences réglementaires. Enfin, le Conseil d’Etat releva qu’aucune requête nouvelle ou complémentaire et aucun acte de procédure, déposés par la suite dans les délais légaux, ne tentaient de corriger les lacunes de la requête en annulation.
16. Le Conseil d’Etat avait traité d’une première demande de permis d’urbanisme relatif au même objet dans un arrêt de référé du 1er juin 2001 et dans un arrêt au fond du 18 janvier 2005, rendu par une formation identique à celle qui a statué dans l’arrêt du 26 avril 2007. L’auditeur dans ces trois affaires était le même.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
17. Aux termes de l’article 17 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et de l’article 8 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, la demande de suspension de l’exécution d’une décision doit contenir notamment :
– un exposé des faits et des moyens de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué ;
– un exposé des faits de nature à établir que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable ;
– le cas échéant, un exposé des faits justifiant l’extrême urgence.
18. Par un arrêt du 25 janvier 2000, le Conseil d’Etat jugea ainsi :
« Considérant que s’il est exact que l’article 2 § 1, 2o de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, exige que la requête en annulation comporte, entre autres, un exposé des faits, il convient de constater que l’appréciation de cette exigence diffère de celle imposée par l’article 8, alinéa 2, 5o de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 relatif à la demande de suspension ; qu’en effet, dans ce cas, la demande de suspension doit contenir, outre un exposé des faits de nature à justifier l’annulation, un exposé des faits de nature à établir le risque de préjudice grave allégué, (...) ; que par contre, en ce qui concerne le recours en annulation, l’absence d’exposé des faits ne conduit à l’irrecevabilité de la requête que lorsque celle-ci est de manière tellement nébuleuse que l’objet ne puisse pas être discerné ; qu’en l’espèce, la requête en annulation comporte un exposé des faits, même s’il est sommaire, de même qu’un exposé des moyens ; que la requête en annulation est donc recevable d’autant que les faits ont été valablement exposés dans les documents qui l’accompagnent. »
19. L’article 2 § 1, 2o de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat dispose :
« La requête est datée et contient :
1o l’intitulé « requête en annulation » dans les cas prévus à l’article 14 §§ 1 et 3 des lois coordonnées, si celle-ci ne contient pas en outre une demande de suspension ;
2o les nom, qualité et domicile ou siège de la partie requérante ainsi que le domicile élu visé à l’article 84 § 2, alinéa 1er ;
3o l’objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens ;
4o les nom et adresse de la partie adverse. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20. La requérante se plaint du rejet comme irrecevable par le Conseil d’Etat de son recours en annulation d’un permis d’urbanisme au motif que la requête ne comportait pas un exposé des faits de la cause. Elle allègue une violation de son droit d’accès à un tribunal, garantie par l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur l’applicabilité de l’article 6 § 1
21. Le Gouvernement excipe d’emblée de l’incompatibilité ratione materiae de ce grief avec l’article 6 de la Convention. Il soutient que la requérante reste en défaut de démontrer la « patrimonialité » de l’enjeu du contentieux porté par elle devant le Conseil d’Etat, si bien qu’il n’est pas possible de qualifier le litige de « civil » au regard de l’article 6 de la Convention. La requérante n’a pas invoqué, à l’appui de sa requête en annulation, la moindre atteinte à son patrimoine. L’intérêt de celle-ci à agir devant le Conseil d’Etat n’a été justifié que par la défense de son objet social. La requérante ne se présente pas comme une association des riverains tendant à la défense des droits et intérêts de ses membres. Au vu de son objet statutaire, elle est en réalité une association de protection de l’environnement qui s’est donnée pour mission de défendre, dans un cadre géographique précis, l’intérêt « général » face à toute menace susceptible de porter atteinte à l’environnement.
22. Le Gouvernement établit un parallèle entre la présente affaire et l’affaire Association des Amis de Saint-Raphaël et de Fréjus c. France (déc.), no 45053/98, 29 février 2000) dans laquelle la Cour avait considéré que l’action de l’association requérante devant les juridictions administratives portant sur la légalité d’un permis d’urbanisme délivré à des tiers, s’inscrivait directement dans le cadre de son objet statutaire – la protection de l’environnement, de la qualité de vie et du caractère esthétique des communes de Saint-Raphaël et de Fréjus – et visait ainsi à la défense de l’intérêt général et non à celle de « droits de caractère civil » dont cette association serait susceptible de se prétendre titulaire en son propre nom.
23. La requérante rétorque qu’en droit belge, le recours au Conseil d’Etat ne permet pas l’action populaire, ni la défense d’un intérêt général. Son intérêt collectif a été reconnu à plusieurs reprises par le Conseil d’Etat qui le considère, géographiquement et matériellement, suffisamment spécifique. Dans sa requête en annulation, elle soulignait qu’elle avait déjà été reconnue par deux arrêts de référé et un arrêt au fond comme disposant de l’intérêt requis qui résultait de son objet social, à savoir la défense de l’environnement de la région de Marche-Nassogne.
24. La Cour rappelle que, pour que l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer en son volet civil, il faut qu’il y ait « contestation » sur un « droit » de « nature civile » que la requérante pourrait prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s’agir d’une « contestation » réelle et sérieuse qui peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. L’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question : un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisent pas à faire entrer en jeu l’article 6 § 1 (voir, par exemple, Balmer-Schafroth c. Suisse, 26 août 1997, § 32, Recueil des arrêts et décisions 1997 IV ; Athanassoglou et autres c. Suisse [GC], no 27644/95, § 43, CEDH 2000-IV ; Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, no 62543/00, § 43, CEDH 2004 III).
25. La Cour rappelle en outre que le mécanisme de contrôle de la Convention ne saurait admettre l’actio popularis (Perez c. France [GC], no 47287/99, § 70, CEDH 2004 I). Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, la Cour a ainsi déjà eu l’occasion de préciser qu’une contestation se rapportant à la défense de l’intérêt général ne portait pas sur un droit de caractère civil (Gorraiz Lizarraga et autres, précité, § 46). Toutefois, dans cette dernière affaire, la Cour a conclu à l’applicabilité de l’article 6 § 1 à une procédure intentée par une association des propriétaires pour combattre la construction d’un barrage, et à laquelle seule l’association était partie, au motif qu’en sus de l’intérêt général, cette dernière défendait également l’intérêt particulier de ses membres, dont les droits patrimoniaux notamment étaient en cause.
26. Une nouvelle étape a été franchie par la Cour dans l’affaire Collectif national d’information et d’opposition à l’usine Melox – Collectif stop Melox et Mox c. France ((déc.), no 75218/01, 28 mars 2006), dans laquelle elle a affirmé que l’article 6 § 1 était applicable à une procédure engagée par une association de protection de l’environnement ne se présentant pas comme une association de riverains visant spécifiquement à la défense des droits et intérêts de ses membres. La Cour a conclu que, si l’objet de la procédure litigieuse était essentiellement la défense de l’intérêt général, la « contestation » soulevée par l’association requérante avait en sus un lien suffisant avec un « droit » dont elle pouvait se dire titulaire en tant que personne morale pour que l’article 6 § 1 de la Convention ne soit pas d’office jugé inapplicable. En fait, au cœur des revendications de l’intéressée se trouvait la question du droit du public à l’information et à la participation au processus décisionnel lorsqu’il s’agissait d’autoriser une activité présentant un danger pour la santé ou l’environnement.
27. Il convient sans doute de distinguer la présente affaire de l’affaire du Collectif stop Melox et Mox. En l’espèce, le recours de la requérante devant le Conseil d’Etat avait pour but l’annulation d’un permis d’urbanisme accordé à une société, tendant à l’extension du centre d’enfouissement des déchets. Les moyens soulevés étaient pris notamment des textes tels que la directive 85/337 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la directive 1999/31 concernant la mise en décharge des déchets, le décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la région wallonne et la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. Aucun rapprochement ne peut être fait à cet égard avec les moyens développés devant le Conseil d’Etat français par le Collectif stop Melox et Mox.
28. Toutefois, la Cour relève qu’il ressort des statuts de la requérante que celle-ci a un but géographiquement et matériellement limité, à savoir la défense de l’environnement de la région de Marche-Nassogne. Cette région recouvre essentiellement cinq communes de petite taille dans un périmètre limité. De plus, tous les fondateurs et administrateurs de la requérante sont domiciliés dans ces communes, de sorte qu’ils peuvent être considérés comme des riverains directement affectés par le projet d’extension de la décheterie. Or, l’augmentation de la capacité de la décheterie de plus du cinquième de sa capacité initiale, risquait d’avoir des incidences non négligeables sur la vie privée de ceux-ci, par les nuisances qu’elle provoquerait sur la qualité de leur vie quotidienne, et par voie de conséquence sur la valeur marchande de leurs priopriétés situées dans ces communes qui risquait de subir de ce fait une dépréciation.
29. Si la Convention ne permet pas l’actio popularis c’est pour éviter la saisine de la Cour par des individus se plaignant de la simple existence d’une loi applicable à tout citoyen d’un pays ou d’une décision de justice auxquels ils ne sont pas parties (Ada Rossi et sept autres requêtes c. Italie, no 55185/08, 16 décembre 2008). La Cour considère cependant que l’intérêt “général” défendu en l’espèce par le recours de la requérante ne peut pas être assimilé à une actio popularis, compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment la nature de l’acte attaqué, la qualité de la requérante et de ses fondateurs ainsi que le but matériellement et géographiquement limité poursuivi par celle-ci.
30. La Cour en déduit que la “contestation” soulevée par la requérante avait un lien suffisant avec un “droit” dont elle pouvait se dire titulaire en tant que personne morale pour que l’article 6 s’applique.
B. Sur l’observation de l’article 6 § 1
1. Arguments des parties
31. La requérante soutient que le Conseil d’Etat a déclaré le recours en annulation irrecevable par pure transposition de la solution adoptée dans le cadre du référé administratif ; le Conseil d’Etat avait auparavant rejeté pour les mêmes motifs une autre demande de la requérante tendant à la suspension d’exécution du permis attaqué. Le Conseil d’Etat aurait opéré là un revirement profond de jurisprudence. Or la jurisprudence du Conseil d’Etat établissait justement une distinction entre la procédure de référé (demande de suspension) et la requête en annulation au niveau des exigences concernant l’exposé des faits dans les requêtes.
32. Le Gouvernement soutient qu’au moment de l’introduction du recours de la requérante devant le Conseil d’Etat, l’état de la jurisprudence de ce dernier n’était pas celui décrit par la requérante, qui se base en réalité sur une jurisprudence dépassée. Si revirement de jurisprudence il y a eu, ce dernier s’est produit bien avant l’introduction du recours en annulation. Le caractère prévisible de la norme interne procédurale et de la jurisprudence y afférente était donc entièrement assuré à la date de l’introduction de ce recours.
33. Le Gouvernement souligne, en outre, que la requérante n’avait pas même pris le soin de joindre à son recours en annulation une copie de l’acte attaqué, auquel elle entendait se référer au titre de l’exposé des faits. Celui-ci se trouvait en un seul exemplaire dans le dossier de la requérante. Ceci a eu pour conséquence que le recours en annulation, qui a été notifié par le greffe du Conseil d’Etat à la partie adverse, ne comportait évidemment pas l’acte administratif attaqué. Cette dernière s’est, dès lors, à juste titre, limitée à soulever une exception d’irrecevabilité tirée de l’absence d’un exposé des faits. Présupposer que le Conseil d’Etat aurait dû avoir une connaissance des faits en raison de ce qu’il avait déjà statué en référé dans la même affaire, est du reste inexact puisque la composition de la chambre chargée de traiter les recours en suspension et en annulation dans une même affaire n’est jamais identique. Ainsi, l’irrecevabilité du recours de la requérante ne résulte pas d’une erreur ou d’une maladresse procédurale, mais bien de sa propre négligence.
34. La requérante rétorque, citant un arrêt du Conseil d’Etat postérieur à l’arrêt litigieux, qu’il n’y a pas eu revirement de jurisprudence si ce n’est pour l’affaire en cause. Il y a eu en réalité une décision de circonstance s’écartant d’une jurisprudence constante pour des raisons inconnues, incompréhensibles et préjudiciables à la requérante.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
35. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d’autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, § 34, Recueil 1998–I, p. 290). En effet, le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente.
36. La Cour rappelle en outre que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les Etats contractants à créer des cours d’appel ou de cassation (voir, notamment, Delcourt c. Belgique, arrêt du 17 janvier 1970, §§ 25-26, série A no 11). Cependant, si de telles juridictions existent, les garanties de l’article 6 doivent être respectées, notamment en ce qu’il assure aux plaideurs un droit effectif d’accès aux tribunaux pour faire statuer sur les contestations relatives à leurs « droits et obligations de caractère civil » (voir, parmi d’autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, § 37, Recueil 1997-VIII). En outre, la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d’accès à un tribunal reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention dépend des particularités de la procédure en cause et il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la Cour suprême, les conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (Khalfaoui c. France, no 34791/97, CEDH 1999-IX).
37. La Cour rappelle enfin que la réglementation relative aux formalités pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Toutefois, les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que les règles soient appliquées (Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000-I).
38. Cela étant, la Cour a conclu à plusieurs reprises que l’application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d’accès à un tribunal. Il en est ainsi quand l’interprétation par trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche, de fait, l’examen au fond du recours exercé par l’intéressé (Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 69, CEDH 2002-IX ; Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 55, CEDH 2002 IX).
b) Application en l’espèce des principes susmentionnés
39. Dans le cas d’espèce, la tâche de la Cour consiste à examiner si la raison pour laquelle le Conseil d’Etat rejeta le recours en annulation de la requérante priva, de fait, l’intéressée de son droit à voir son affaire jugée au fond. Pour ce faire, la Cour se penchera sur la proportionnalité de la limitation imposée par rapport aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice.
40. Tout d’abord, la Cour constate que parmi les exigences de forme de la requête en annulation devant le Conseil d’Etat, énoncées par l’article 2 § 1, 2o de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, figure la mention d’un exposé des faits de la cause. Toutefois, il ne lui appartient pas de prendre position sur l’état de la jurisprudence du Conseil d’Etat lorsqu’un recours en annulation ne comporte pas d’exposé des faits, question qui est controversée par les parties en l’espèce.
41. Il suffit à la Cour de constater qu’en l’occurrence, on ne saurait soutenir que l’acte du recours de la requérante mettait le Conseil d’Etat, et encore moins la partie adverse, dans l’impossibilité de prendre connaissance des faits de la cause.
42. A cet égard, la Cour note que la requérante avait joint à son recours l’acte administratif attaqué qui contenait un exposé détaillé des faits ayant conduit à son adoption. Par conséquent, un nouvel exposé des faits établi par les requérants et intégré dans le texte même du recours en annulation ne serait pas plus complet que celui figurant dans l’acte attaqué même. En outre, le Conseil d’Etat avait traité d’une première demande de permis d’urbanisme relatif au même objet dans un arrêt de référé du 1er juin 2001 et dans un arrêt au fond du 18 janvier 2005, rendu par une formation identique à celle qui a statué dans l’arrêt litigieux. De plus, l’auditeur dans ces trois affaires était le même. Enfin, la Cour ne saurait souscrire à l’argument du Gouvernement selon lequel la partie adverse de la requérante ne pouvait pas prendre connaissance de l’acte attaqué, envoyé en un seul exemplaire, celle-ci étant l’auteur de cet acte.
43. A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime qu’en l’espèce la limitation au droit d’accès à un tribunal imposée à la requérante n’était pas proportionnée au but visant à garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.
44. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention relativement au droit d’accès à un tribunal de la requérante.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
46. La requérante réclame, à titre de dommage matériel et moral confondu, la somme de 10 000 euros (EUR). Elle estime avoir subi une perte de chance de voir le Conseil d’Etat statuer sur le recours en annulation et obtenir l’arrêt définitif de l’exploitation de cette décharge qui cause à l’air environnant, dans un rayon de plusieurs kilomètres, des odeurs insalubres et qui cause au ruisseau de la Pisserotte une pollution grave de l’eau.
47. Le Gouvernement considère que la requérante reste en défaut de prouver tant le quantum du dommage allégué que le lien de causalité entre la décision litigieuse et ledit dommage.
48. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour estime qu’elle ne saurait spéculer sur la décision du Conseil d’Etat si celui-ci avait examiné le bien-fondé des griefs de la requérante. Il n’y a donc pas lieu d’accorder à la requérante une indemnité à ce titre.
49. En revanche, la Cour estime vraisemblable que la requérante ait subi une frustration en raison de la violation constatée. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui octroie 3 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
50. La requérante demande une somme de 5 350 EUR pour les honoraires d’avocat et frais exposés dans la procédure interne ainsi que la somme de 2 500 EUR pour la procédure à Strasbourg.
51. Le Gouvernement souligne le caractère peu lisible des documents produits relativement au recours interne et considère que les justificatifs fournis ne sont pas suffisants à démontrer la réalité du montant pour les frais afférents à la procédure devant la Cour.
52. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
53. S’agissant des frais et dépens encourus en Belgique, la Cour note que les frais réclamés n’ont pas été engendrés pour tenter de faire corriger la violation dans l’ordre juridique interne, mais sont des frais normalement encourus dans le cadre de la procédure litigieuse. Il y a donc lieu de rejeter cette partie des prétentions de la requérante. En ce qui concerne la procédure devant elle, eu égard aux justificatifs produits et aux critères mentionnés ci-dessus, la Cour estime raisonnable d’allouer à la requérante l’intégralité de la somme demandée, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
C. Intérêts moratoires
54. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, et 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 février 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Ireneu Cabral Barreto
Greffière Président
In questa vicenda un’associazione ambientalista locale aveva presentato un ricorso in annullamento contro un permesso di urbanizzazione, successivamente dichiarato inammissibile dal giudice nazionale perché l’esposizione dei fatti non era stata ritenuta idonea ad identificare l’oggetto del contendere.
La CEDU ha ritenuto applicabile l’art. 6, riconoscendo la violazione di tale disposizione per mancato accesso a un tribunale, tenuto conto della natura dell’atto impugnato, delle caratteristiche dell’associazione, dello scopo e della sua attività, circoscritta ad un territorio locale.
A mio avviso il caso è interessante perchè spesso, anche in Italia, i giudici amministrativi, pur riconoscendo una legittimazione delle associazioni ad impugnare provvedimenti amministrativi, poi ritengono i loro ricorsi inammissibili qualora siano stati presentati contro strumenti urbanistici.
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE L’ERABLIERE A.S.B.L. c. BELGIQUE
(Requête no 49230/07)
ARRÊT
STRASBOURG
24 février 2009
DÉFINITIF
24/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire L’Erablière A.S.B.L. c. Belgique,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Ireneu Cabral Barreto, président,
Françoise Tulkens,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 février 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 49230/07) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont une association sans but lucratif ayant son siège social à Bande, L’Erablière A.S.B.L. (« la requérante »), a saisi la Cour le 5 novembre 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me A. Lebrun, avocat à Grivegnée. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Daniel Flore, Directeur général au Service public fédéral de la Justice.
3. La requérante alléguait une violation du droit d’accès à un tribunal (article 6 § 1 de la Convention).
4. Le 16 mai 2008, le vice-président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La requérante est une association sans but lucratif qui a pour objet, selon ses statuts « de défendre l’environnement de la région de Marche Nassogne. Elle recouvre essentiellement les communes de Nassogne, La Roche-en-Ardenne, Marche-en-Famenne, Rendeux, et Tenneville. L’environnement s’entend des qualités et des diversités des écosystèmes et des espaces naturels ou semi-naturels, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, de la valeur paysagère, de l’eau, de l’air et autres éléments vitaux pour les êtres humains, ainsi que de la quiétude des lieux. Elle peut poser tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son but (...) ».
6. Sont membres de l’association ses fondateurs ainsi que toute personne admise par une assemblée générale à la majorité simple ou par le conseil d’administration à la majorité des deux tiers. Il ressort de la publication des liste des fondateurs et administrateurs de la requérante que ceux-ci sont tous domiciliés dans les communes susmentionnées.
7. Le 26 septembre 2002, la société coopérative Idelux introduisit une demande de permis d’urbanisme tendant à l’extension du centre d’enfouissement technique de classe 2 et 3, au lieu-dit « Al Pisserotte » auprès du fonctionnaire délégué de la province du Luxembourg. Il était prévu une augmentation de la capacité de la décheterie de plus du cinquième de sa capacité initiale. Dans son préambule, le permis d’urbanisme reprenait l’ensemble des circonstances ayant conduit à son adoption.
8. Le 5 janvier 2004, la commune de Tenneville adressa une lettre à la requérante l’informant que le permis d’urbanisme avait été octroyé à la société Idelux le 23 décembre 2003 et qu’il était possible pour la requérante d’intenter un recours en annulation devant le Conseil d’Etat.
9. Le 5 mars 2004, la requérante introduisit une requête tendant à annuler la décision du fonctionnaire délégué ainsi qu’à suspendre l’exécution de celle-ci. Les moyens soulevés étaient pris notamment des textes tels que la directive 85/337 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la directive 1999/31 concernant la mise en décharge des déchets, le décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la région wallonne et la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
10. Dans cette requête, longue de dix-sept pages, sous le titre « exposé des faits », la requérante indiquait ce qui suit :
« L’exposé des faits est repris à suffisance dans les considérants de l’acte attaqué. Cet acte attaqué a été notifié à la requérante par courrier du 5 janvier 2004, reçu par elle le 7 janvier. »
11. L’acte attaqué était joint en pièce no 1 à la requête en annulation.
12. Se fondant sur l’article 2 § 1, 2o de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, la partie adverse soutenait que la requête en annulation devait être déclarée irrecevable du fait qu’elle ne comportait pas d’exposé des faits.
13. Par un arrêt du 8 septembre 2004, le Conseil d’Etat rejeta la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Il souligna que l’exposé des faits devait être suffisamment complet et précis pour permettre, à sa seule lecture, de comprendre les circonstances de fait du litige. Il conclut que les pièces jointes à la demande de suspension ne pouvaient être considérées comme l’équivalent d’un exposé des faits.
14. Dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, la requérante fit valoir que l’exposé des faits ne constituait pas, dans le cadre d’un recours en annulation, une condition de recevabilité, au contraire de l’exposé des faits dans la demande de suspension. Elle ajouta que l’exposé des faits très succinct ne compromettait pas le déroulement du procès, alors même que la partie adverse connaissait parfaitement les faits, ne s’était pas méprise sur la portée des moyens et était au courant des faits qui en constituaient la base.
15. Par un arrêt du 26 avril 2007, le Conseil d’Etat déclara irrecevable le recours en annulation de la requérante. Il considéra que la requête, faute de contenir un exposé des faits, renvoyait uniquement à l’acte attaqué et apportait une précision quant à la date de sa notification. L’exposé des faits était plutôt inexistant qu’incomplet, ainsi que le soutenait la requérante. Le fait que la partie adverse aurait parfaitement été au courant des antécédents de la cause était sans pertinence pour apprécier si la requête en annulation, destinée à éclairer le Conseil d’Etat et l’auditeur chargé de l’instruction du dossier, comportait un exposé des faits satisfaisant aux exigences réglementaires. Enfin, le Conseil d’Etat releva qu’aucune requête nouvelle ou complémentaire et aucun acte de procédure, déposés par la suite dans les délais légaux, ne tentaient de corriger les lacunes de la requête en annulation.
16. Le Conseil d’Etat avait traité d’une première demande de permis d’urbanisme relatif au même objet dans un arrêt de référé du 1er juin 2001 et dans un arrêt au fond du 18 janvier 2005, rendu par une formation identique à celle qui a statué dans l’arrêt du 26 avril 2007. L’auditeur dans ces trois affaires était le même.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
17. Aux termes de l’article 17 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et de l’article 8 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, la demande de suspension de l’exécution d’une décision doit contenir notamment :
– un exposé des faits et des moyens de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué ;
– un exposé des faits de nature à établir que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable ;
– le cas échéant, un exposé des faits justifiant l’extrême urgence.
18. Par un arrêt du 25 janvier 2000, le Conseil d’Etat jugea ainsi :
« Considérant que s’il est exact que l’article 2 § 1, 2o de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, exige que la requête en annulation comporte, entre autres, un exposé des faits, il convient de constater que l’appréciation de cette exigence diffère de celle imposée par l’article 8, alinéa 2, 5o de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 relatif à la demande de suspension ; qu’en effet, dans ce cas, la demande de suspension doit contenir, outre un exposé des faits de nature à justifier l’annulation, un exposé des faits de nature à établir le risque de préjudice grave allégué, (...) ; que par contre, en ce qui concerne le recours en annulation, l’absence d’exposé des faits ne conduit à l’irrecevabilité de la requête que lorsque celle-ci est de manière tellement nébuleuse que l’objet ne puisse pas être discerné ; qu’en l’espèce, la requête en annulation comporte un exposé des faits, même s’il est sommaire, de même qu’un exposé des moyens ; que la requête en annulation est donc recevable d’autant que les faits ont été valablement exposés dans les documents qui l’accompagnent. »
19. L’article 2 § 1, 2o de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat dispose :
« La requête est datée et contient :
1o l’intitulé « requête en annulation » dans les cas prévus à l’article 14 §§ 1 et 3 des lois coordonnées, si celle-ci ne contient pas en outre une demande de suspension ;
2o les nom, qualité et domicile ou siège de la partie requérante ainsi que le domicile élu visé à l’article 84 § 2, alinéa 1er ;
3o l’objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens ;
4o les nom et adresse de la partie adverse. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20. La requérante se plaint du rejet comme irrecevable par le Conseil d’Etat de son recours en annulation d’un permis d’urbanisme au motif que la requête ne comportait pas un exposé des faits de la cause. Elle allègue une violation de son droit d’accès à un tribunal, garantie par l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur l’applicabilité de l’article 6 § 1
21. Le Gouvernement excipe d’emblée de l’incompatibilité ratione materiae de ce grief avec l’article 6 de la Convention. Il soutient que la requérante reste en défaut de démontrer la « patrimonialité » de l’enjeu du contentieux porté par elle devant le Conseil d’Etat, si bien qu’il n’est pas possible de qualifier le litige de « civil » au regard de l’article 6 de la Convention. La requérante n’a pas invoqué, à l’appui de sa requête en annulation, la moindre atteinte à son patrimoine. L’intérêt de celle-ci à agir devant le Conseil d’Etat n’a été justifié que par la défense de son objet social. La requérante ne se présente pas comme une association des riverains tendant à la défense des droits et intérêts de ses membres. Au vu de son objet statutaire, elle est en réalité une association de protection de l’environnement qui s’est donnée pour mission de défendre, dans un cadre géographique précis, l’intérêt « général » face à toute menace susceptible de porter atteinte à l’environnement.
22. Le Gouvernement établit un parallèle entre la présente affaire et l’affaire Association des Amis de Saint-Raphaël et de Fréjus c. France (déc.), no 45053/98, 29 février 2000) dans laquelle la Cour avait considéré que l’action de l’association requérante devant les juridictions administratives portant sur la légalité d’un permis d’urbanisme délivré à des tiers, s’inscrivait directement dans le cadre de son objet statutaire – la protection de l’environnement, de la qualité de vie et du caractère esthétique des communes de Saint-Raphaël et de Fréjus – et visait ainsi à la défense de l’intérêt général et non à celle de « droits de caractère civil » dont cette association serait susceptible de se prétendre titulaire en son propre nom.
23. La requérante rétorque qu’en droit belge, le recours au Conseil d’Etat ne permet pas l’action populaire, ni la défense d’un intérêt général. Son intérêt collectif a été reconnu à plusieurs reprises par le Conseil d’Etat qui le considère, géographiquement et matériellement, suffisamment spécifique. Dans sa requête en annulation, elle soulignait qu’elle avait déjà été reconnue par deux arrêts de référé et un arrêt au fond comme disposant de l’intérêt requis qui résultait de son objet social, à savoir la défense de l’environnement de la région de Marche-Nassogne.
24. La Cour rappelle que, pour que l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer en son volet civil, il faut qu’il y ait « contestation » sur un « droit » de « nature civile » que la requérante pourrait prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s’agir d’une « contestation » réelle et sérieuse qui peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. L’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question : un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisent pas à faire entrer en jeu l’article 6 § 1 (voir, par exemple, Balmer-Schafroth c. Suisse, 26 août 1997, § 32, Recueil des arrêts et décisions 1997 IV ; Athanassoglou et autres c. Suisse [GC], no 27644/95, § 43, CEDH 2000-IV ; Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, no 62543/00, § 43, CEDH 2004 III).
25. La Cour rappelle en outre que le mécanisme de contrôle de la Convention ne saurait admettre l’actio popularis (Perez c. France [GC], no 47287/99, § 70, CEDH 2004 I). Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, la Cour a ainsi déjà eu l’occasion de préciser qu’une contestation se rapportant à la défense de l’intérêt général ne portait pas sur un droit de caractère civil (Gorraiz Lizarraga et autres, précité, § 46). Toutefois, dans cette dernière affaire, la Cour a conclu à l’applicabilité de l’article 6 § 1 à une procédure intentée par une association des propriétaires pour combattre la construction d’un barrage, et à laquelle seule l’association était partie, au motif qu’en sus de l’intérêt général, cette dernière défendait également l’intérêt particulier de ses membres, dont les droits patrimoniaux notamment étaient en cause.
26. Une nouvelle étape a été franchie par la Cour dans l’affaire Collectif national d’information et d’opposition à l’usine Melox – Collectif stop Melox et Mox c. France ((déc.), no 75218/01, 28 mars 2006), dans laquelle elle a affirmé que l’article 6 § 1 était applicable à une procédure engagée par une association de protection de l’environnement ne se présentant pas comme une association de riverains visant spécifiquement à la défense des droits et intérêts de ses membres. La Cour a conclu que, si l’objet de la procédure litigieuse était essentiellement la défense de l’intérêt général, la « contestation » soulevée par l’association requérante avait en sus un lien suffisant avec un « droit » dont elle pouvait se dire titulaire en tant que personne morale pour que l’article 6 § 1 de la Convention ne soit pas d’office jugé inapplicable. En fait, au cœur des revendications de l’intéressée se trouvait la question du droit du public à l’information et à la participation au processus décisionnel lorsqu’il s’agissait d’autoriser une activité présentant un danger pour la santé ou l’environnement.
27. Il convient sans doute de distinguer la présente affaire de l’affaire du Collectif stop Melox et Mox. En l’espèce, le recours de la requérante devant le Conseil d’Etat avait pour but l’annulation d’un permis d’urbanisme accordé à une société, tendant à l’extension du centre d’enfouissement des déchets. Les moyens soulevés étaient pris notamment des textes tels que la directive 85/337 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la directive 1999/31 concernant la mise en décharge des déchets, le décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la région wallonne et la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. Aucun rapprochement ne peut être fait à cet égard avec les moyens développés devant le Conseil d’Etat français par le Collectif stop Melox et Mox.
28. Toutefois, la Cour relève qu’il ressort des statuts de la requérante que celle-ci a un but géographiquement et matériellement limité, à savoir la défense de l’environnement de la région de Marche-Nassogne. Cette région recouvre essentiellement cinq communes de petite taille dans un périmètre limité. De plus, tous les fondateurs et administrateurs de la requérante sont domiciliés dans ces communes, de sorte qu’ils peuvent être considérés comme des riverains directement affectés par le projet d’extension de la décheterie. Or, l’augmentation de la capacité de la décheterie de plus du cinquième de sa capacité initiale, risquait d’avoir des incidences non négligeables sur la vie privée de ceux-ci, par les nuisances qu’elle provoquerait sur la qualité de leur vie quotidienne, et par voie de conséquence sur la valeur marchande de leurs priopriétés situées dans ces communes qui risquait de subir de ce fait une dépréciation.
29. Si la Convention ne permet pas l’actio popularis c’est pour éviter la saisine de la Cour par des individus se plaignant de la simple existence d’une loi applicable à tout citoyen d’un pays ou d’une décision de justice auxquels ils ne sont pas parties (Ada Rossi et sept autres requêtes c. Italie, no 55185/08, 16 décembre 2008). La Cour considère cependant que l’intérêt “général” défendu en l’espèce par le recours de la requérante ne peut pas être assimilé à une actio popularis, compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment la nature de l’acte attaqué, la qualité de la requérante et de ses fondateurs ainsi que le but matériellement et géographiquement limité poursuivi par celle-ci.
30. La Cour en déduit que la “contestation” soulevée par la requérante avait un lien suffisant avec un “droit” dont elle pouvait se dire titulaire en tant que personne morale pour que l’article 6 s’applique.
B. Sur l’observation de l’article 6 § 1
1. Arguments des parties
31. La requérante soutient que le Conseil d’Etat a déclaré le recours en annulation irrecevable par pure transposition de la solution adoptée dans le cadre du référé administratif ; le Conseil d’Etat avait auparavant rejeté pour les mêmes motifs une autre demande de la requérante tendant à la suspension d’exécution du permis attaqué. Le Conseil d’Etat aurait opéré là un revirement profond de jurisprudence. Or la jurisprudence du Conseil d’Etat établissait justement une distinction entre la procédure de référé (demande de suspension) et la requête en annulation au niveau des exigences concernant l’exposé des faits dans les requêtes.
32. Le Gouvernement soutient qu’au moment de l’introduction du recours de la requérante devant le Conseil d’Etat, l’état de la jurisprudence de ce dernier n’était pas celui décrit par la requérante, qui se base en réalité sur une jurisprudence dépassée. Si revirement de jurisprudence il y a eu, ce dernier s’est produit bien avant l’introduction du recours en annulation. Le caractère prévisible de la norme interne procédurale et de la jurisprudence y afférente était donc entièrement assuré à la date de l’introduction de ce recours.
33. Le Gouvernement souligne, en outre, que la requérante n’avait pas même pris le soin de joindre à son recours en annulation une copie de l’acte attaqué, auquel elle entendait se référer au titre de l’exposé des faits. Celui-ci se trouvait en un seul exemplaire dans le dossier de la requérante. Ceci a eu pour conséquence que le recours en annulation, qui a été notifié par le greffe du Conseil d’Etat à la partie adverse, ne comportait évidemment pas l’acte administratif attaqué. Cette dernière s’est, dès lors, à juste titre, limitée à soulever une exception d’irrecevabilité tirée de l’absence d’un exposé des faits. Présupposer que le Conseil d’Etat aurait dû avoir une connaissance des faits en raison de ce qu’il avait déjà statué en référé dans la même affaire, est du reste inexact puisque la composition de la chambre chargée de traiter les recours en suspension et en annulation dans une même affaire n’est jamais identique. Ainsi, l’irrecevabilité du recours de la requérante ne résulte pas d’une erreur ou d’une maladresse procédurale, mais bien de sa propre négligence.
34. La requérante rétorque, citant un arrêt du Conseil d’Etat postérieur à l’arrêt litigieux, qu’il n’y a pas eu revirement de jurisprudence si ce n’est pour l’affaire en cause. Il y a eu en réalité une décision de circonstance s’écartant d’une jurisprudence constante pour des raisons inconnues, incompréhensibles et préjudiciables à la requérante.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
35. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d’autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, § 34, Recueil 1998–I, p. 290). En effet, le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente.
36. La Cour rappelle en outre que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les Etats contractants à créer des cours d’appel ou de cassation (voir, notamment, Delcourt c. Belgique, arrêt du 17 janvier 1970, §§ 25-26, série A no 11). Cependant, si de telles juridictions existent, les garanties de l’article 6 doivent être respectées, notamment en ce qu’il assure aux plaideurs un droit effectif d’accès aux tribunaux pour faire statuer sur les contestations relatives à leurs « droits et obligations de caractère civil » (voir, parmi d’autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, § 37, Recueil 1997-VIII). En outre, la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d’accès à un tribunal reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention dépend des particularités de la procédure en cause et il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la Cour suprême, les conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (Khalfaoui c. France, no 34791/97, CEDH 1999-IX).
37. La Cour rappelle enfin que la réglementation relative aux formalités pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Toutefois, les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que les règles soient appliquées (Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000-I).
38. Cela étant, la Cour a conclu à plusieurs reprises que l’application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d’accès à un tribunal. Il en est ainsi quand l’interprétation par trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche, de fait, l’examen au fond du recours exercé par l’intéressé (Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 69, CEDH 2002-IX ; Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 55, CEDH 2002 IX).
b) Application en l’espèce des principes susmentionnés
39. Dans le cas d’espèce, la tâche de la Cour consiste à examiner si la raison pour laquelle le Conseil d’Etat rejeta le recours en annulation de la requérante priva, de fait, l’intéressée de son droit à voir son affaire jugée au fond. Pour ce faire, la Cour se penchera sur la proportionnalité de la limitation imposée par rapport aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice.
40. Tout d’abord, la Cour constate que parmi les exigences de forme de la requête en annulation devant le Conseil d’Etat, énoncées par l’article 2 § 1, 2o de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, figure la mention d’un exposé des faits de la cause. Toutefois, il ne lui appartient pas de prendre position sur l’état de la jurisprudence du Conseil d’Etat lorsqu’un recours en annulation ne comporte pas d’exposé des faits, question qui est controversée par les parties en l’espèce.
41. Il suffit à la Cour de constater qu’en l’occurrence, on ne saurait soutenir que l’acte du recours de la requérante mettait le Conseil d’Etat, et encore moins la partie adverse, dans l’impossibilité de prendre connaissance des faits de la cause.
42. A cet égard, la Cour note que la requérante avait joint à son recours l’acte administratif attaqué qui contenait un exposé détaillé des faits ayant conduit à son adoption. Par conséquent, un nouvel exposé des faits établi par les requérants et intégré dans le texte même du recours en annulation ne serait pas plus complet que celui figurant dans l’acte attaqué même. En outre, le Conseil d’Etat avait traité d’une première demande de permis d’urbanisme relatif au même objet dans un arrêt de référé du 1er juin 2001 et dans un arrêt au fond du 18 janvier 2005, rendu par une formation identique à celle qui a statué dans l’arrêt litigieux. De plus, l’auditeur dans ces trois affaires était le même. Enfin, la Cour ne saurait souscrire à l’argument du Gouvernement selon lequel la partie adverse de la requérante ne pouvait pas prendre connaissance de l’acte attaqué, envoyé en un seul exemplaire, celle-ci étant l’auteur de cet acte.
43. A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime qu’en l’espèce la limitation au droit d’accès à un tribunal imposée à la requérante n’était pas proportionnée au but visant à garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.
44. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention relativement au droit d’accès à un tribunal de la requérante.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
46. La requérante réclame, à titre de dommage matériel et moral confondu, la somme de 10 000 euros (EUR). Elle estime avoir subi une perte de chance de voir le Conseil d’Etat statuer sur le recours en annulation et obtenir l’arrêt définitif de l’exploitation de cette décharge qui cause à l’air environnant, dans un rayon de plusieurs kilomètres, des odeurs insalubres et qui cause au ruisseau de la Pisserotte une pollution grave de l’eau.
47. Le Gouvernement considère que la requérante reste en défaut de prouver tant le quantum du dommage allégué que le lien de causalité entre la décision litigieuse et ledit dommage.
48. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour estime qu’elle ne saurait spéculer sur la décision du Conseil d’Etat si celui-ci avait examiné le bien-fondé des griefs de la requérante. Il n’y a donc pas lieu d’accorder à la requérante une indemnité à ce titre.
49. En revanche, la Cour estime vraisemblable que la requérante ait subi une frustration en raison de la violation constatée. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui octroie 3 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
50. La requérante demande une somme de 5 350 EUR pour les honoraires d’avocat et frais exposés dans la procédure interne ainsi que la somme de 2 500 EUR pour la procédure à Strasbourg.
51. Le Gouvernement souligne le caractère peu lisible des documents produits relativement au recours interne et considère que les justificatifs fournis ne sont pas suffisants à démontrer la réalité du montant pour les frais afférents à la procédure devant la Cour.
52. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
53. S’agissant des frais et dépens encourus en Belgique, la Cour note que les frais réclamés n’ont pas été engendrés pour tenter de faire corriger la violation dans l’ordre juridique interne, mais sont des frais normalement encourus dans le cadre de la procédure litigieuse. Il y a donc lieu de rejeter cette partie des prétentions de la requérante. En ce qui concerne la procédure devant elle, eu égard aux justificatifs produits et aux critères mentionnés ci-dessus, la Cour estime raisonnable d’allouer à la requérante l’intégralité de la somme demandée, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
C. Intérêts moratoires
54. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, et 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 février 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Ireneu Cabral Barreto
Greffière Président