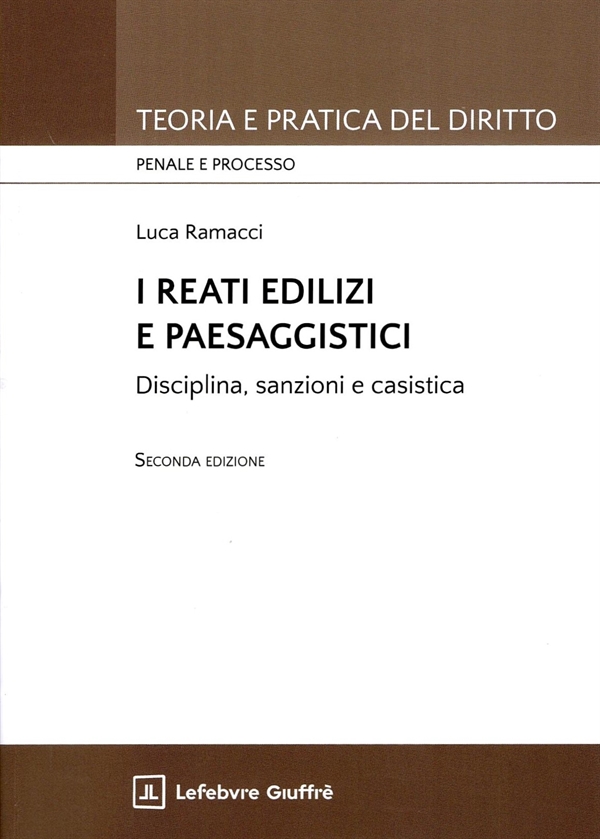Corte EDU sent.12 novembre 2019
Corte EDU sent.12 novembre 2019
S.A. Bio d’Ardennes c. Belgique,
Art 1 P 1 • Réglementation de l’usage des biens • Refus d’indemnisation pour abattage de bovins malades du fait du non-respect d’obligations sanitaires • Absence de charge spéciale ou exorbitante pour le propriétaire
(in lingua francese)
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE S.A. BIO D’ARDENNES c. BELGIQUE
(Requête no 44457/11)
ARRÊT
Art 1 P 1 • Réglementation de l’usage des biens • Refus d’indemnisation pour abattage de bovins malades du fait du non-respect d’obligations sanitaires • Absence de charge spéciale ou exorbitante pour le propriétaire
STRASBOURG
12 novembre 2019
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire S.A. Bio d’Ardennes c. Belgique,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une Chambre composée de :
Georgios A. Serghides, président,
Paul Lemmens,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Alena Poláčková,
María Elósegui,
Gilberto Felici,
Erik Wennerström, juges,
et de Stephen Phillips, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 octobre 2019,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 44457/11) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont une société anonyme (S.A.) de droit belge, Bio d’Ardennes (« la requérante »), a saisi la Cour le 14 juillet 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante a été représentée par Me J. Gollier et Me L. Cornelis, avocats exerçant à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice.
3. La requérante allègue que le refus de lui octroyer une indemnisation suite à l’ordre d’abattage de 253 bovins a constitué une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
4. Le 28 mai 2018, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La requérante est une société anonyme de droit belge dont le siège est établi à Bastogne.
Le contexte de l’abattage des bovins
6. La requérante est un producteur de viande bovine. Elle exploite deux centres d’engraissement de bovins, un à Marchovelette, l’autre à Rillaar.
7. En juillet et en août 1998, la requérante acheta d’un marchand belge respectivement 27 et 62 bovins d’origine portugaise qu’elle introduisit dans son exploitation de Marchovelette.
8. Entre les mois d’octobre 1998 et juillet 1999, plusieurs veaux avortés de l’exploitation de Marchovelette durent être enlevés par l’équarrisseur. Ceux-ci ne firent pas l’objet d’une analyse ou d’une déclaration à l’inspection vétérinaire, contrairement aux obligations prévues par l’arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine, une maladie infectieuse bovine.
9. Le 22 janvier 2000, 56 bovins furent transférés de l’exploitation de Marchovelette à celle de Rillaar.
10. Par lettre du 10 mars 2000, l’inspecteur vétérinaire notifia à la société requérante l’existence d’un foyer de brucellose au sein du troupeau de Marchovelette et un ordre d’abattage des 116 bovins présents dans l’exploitation fut délivré.
11. Le 22 mars 2000, un ordre complémentaire d’abattage fut délivré pour deux bovins nouveau-nés et les 118 bovins furent abattus.
12. Le même jour, un autre foyer de brucellose fut détecté au sein du troupeau de Rillaar et un ordre d’abattage des 59 bovins présents dans l’exploitation fut délivré. Ces bovins furent effectivement abattus.
13. Par lettre du 7 avril 2000, l’inspecteur vétérinaire confirma à la société requérante que les pâtures attenantes à l’exploitation de Marchovelette ne pourraient accueillir des bovins qu’après la libération officielle des mesures restrictives imposées, à savoir le nettoyage, la désinfection, le stockage séparé du fumier jusqu’au 1er juin 2000 et son évacuation, une nouvelle désinfection et la constatation par l’inspection vétérinaire de la bonne exécution de ces mesures.
14. Dans la nuit du 27 au 28 avril 2000, la société requérante procéda à l’introduction de 76 nouveaux bovins sur les pâtures de l’exploitation de Marchovelette.
15. Le 28 avril 2000, un procès-verbal constatant ces faits fut dressé par l’inspecteur vétérinaire, les 76 bovins furent saisis conformément à l’article 21 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et ils firent l’objet d’un ordre d’abattage. Ces bovins furent effectivement abattus.
16. Par lettre du 20 juin 2000, la levée des mesures fut notifiée au responsable sanitaire de la société requérante.
17. Le 26 juillet 2000, les services vétérinaires de l’administration de la santé animale et de la qualité des produits animaux du ministère des classes moyennes et de l’agriculture (auxquels succéda en 2003 l’agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, « l’AFSCA ») refusèrent le paiement des indemnités d’abattage des 253 bovins sur le fondement de l’article 23 § 3 de l’arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine. Ils constatèrent que la requérante avait commis de nombreuses infractions, notamment aux articles 3, 4, 7 et 9 de l’arrêté royal du 6 décembre 1978 (paragraphe 29 ci-dessous). Les services vétérinaires notèrent que les infractions commises avaient eu ou auraient pu avoir pour conséquence l’extension de la contamination à l’ensemble du cheptel de Marchovelette ou à des bovins introduits illicitement dans le foyer avant l’autorisation de repeuplement ou à d’autres troupeaux et aux exploitations voisines, ainsi qu’un risque de transmission de la brucellose au personnel employé par la requérante du fait de la manipulation de bovins ayant avorté pour cause de brucellose.
La procédure en indemnisation
18. Le 8 décembre 2001, la requérante fit signifier à l’État belge une citation à comparaître devant le tribunal de première instance de Neufchâteau afin d’obtenir une indemnisation des pertes résultant des abattages ordonnés concernant les 253 bovins. Elle évalua son préjudice à 275 037,85 euros (EUR). Elle fit notamment valoir que l’État belge avait commis un certain nombre de manquements sans lesquels elle n’aurait pas acheté les bovins d’origine portugaise (paragraphe 7 ci-dessus) et sans lesquels elle n’aurait donc pas subi le dommage lié à leur abattage. Elle allégua également que la politique d’abattage systématique adoptée par l’État sans la moindre indemnisation constituait une atteinte disproportionnée au droit de propriété et aux intérêts économiques de la requérante tels que garantis par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
19. En novembre 2003, l’AFSCA succéda à l’État belge à l’instance.
20. Par exploit du 23 février 2006, la requérante cita l’association agréée pour la lutte contre les maladies des animaux Dierengezondheidszorg Vlaanderen (« DGZ ») en intervention forcée pour obtenir la réparation de son dommage. Elle fit valoir que cette association, qui était chargée de la mise en œuvre de certaines parties de la réglementation applicable, avait commis un certain nombre de manquements, notamment à son devoir d’information, sans lesquels la requérante n’aurait pas acheté les bovins d’origine portugaise.
21. Le 23 février 2007, le tribunal de première instance de Neufchâteau rejeta toutes les prétentions de la requérante. Il estima que l’AFSCA n’avait commis aucune faute dans la gestion de la brucellose, qu’elle avait respecté les dispositions légales et que les refus d’indemnisation étaient justifiés au vu des nombreuses infractions commises par la requérante. Le tribunal retint une faute à charge de la DGZ mais estima que cette faute n’était pas en lien causal avec le dommage allégué par la requérante. En ce qui concernait l’article 1 du Protocole no 1, le tribunal de première instance estima qu’il n’était pas question de privation de propriété dès lors que les bovins restaient la propriété de la requérante qui pouvait les vendre au prix de boucherie et qu’il n’y avait donc pas de violation de la disposition invoquée. Même en admettant qu’il s’agissait d’une privation de propriété, les conditions permettant une telle privation étaient remplies : les décisions de l’AFSCA respectaient la loi, elles avaient un but d’utilité publique et le refus d’indemnisation était lié au comportement de la requérante et était proportionné aux obligations de l’exploitant eu égard à la gravité des problèmes liés à la brucellose.
22. Le 18 décembre 2008, la cour d’appel de Liège confirma le jugement de première instance. Elle jugea que le comportement adopté par l’AFSCA et son refus d’indemnisation étaient des ingérences conformes aux exigences de légalité, de but légitime et du juste équilibre.
23. Par un arrêt du 20 janvier 2011, la Cour de cassation cassa l’arrêt en tant qu’il statuait sur la responsabilité de la DGZ, rejeta le pourvoi pour le surplus et renvoya la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons. En ce que le pourvoi était dirigé contre l’AFSCA, la Cour de cassation estima que l’arrêt de la cour d’appel avait légalement justifié sa décision selon laquelle la requérante pouvait être privée du droit à obtenir des indemnités.
La procédure postérieure à l’introduction de la requête
24. Par un arrêt du 26 octobre 2012, la cour d’appel de Mons jugea que sans les fautes de la DGZ la requérante n’aurait pas subi le dommage résultant de la perte des 27 bovins ayant fait partie du premier lot livré en juillet 1998 (paragraphe 7 ci-dessus) puis abattus sans indemnisation. La cour d’appel estima que pour le reste la requérante n’avait pas démontré que sans les fautes de la DGZ le dommage résultant de la perte des 226 autres bovins ne se serait pas réalisé.
25. Par un arrêt du 22 février 2013, la cour d’appel de Mons condamna la DGZ à payer un montant de 29 058,48 EUR, correspondant à la valeur des 27 bovins abattus.
26. Tant la requérante que la DGZ se pourvurent en cassation.
27. Par un arrêt du 22 septembre 2016, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par la DGZ. Elle accueillit un des moyens invoqués par la requérante à l’appui de son pourvoi et cassa l’arrêt de la cour d’appel de Mons du 26 octobre 2012 en tant qu’il statuait sur la demande de la requérante en réparation du préjudice résultant de la perte de 62 bovins ayant fait partie du deuxième lot livré en août 1998 (paragraphe 7 ci-dessus). L’affaire, ainsi limitée, fut renvoyée devant la cour d’appel de Bruxelles.
28. Afin de limiter les frais liés à la poursuite de la procédure, la requérante et la DGZ trouvèrent un accord amiable aux termes duquel la DGZ versa une indemnité forfaitaire de 55 000 EUR à la requérante pour la perte des 62 bovins concernés, la requérante renonçant, sans aucune reconnaissance préjudiciable, à cette partie de sa demande.
LE DROIT INTERNE PERTINENT
Les obligations incombant aux éleveurs dans le cadre de la lutte contre la brucellose bovine
29. Afin d’éviter la propagation de la brucellose bovine, l’arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine prévoit un certain nombre d’obligations incombant aux éleveurs. Ainsi, le responsable de l’exploitation est notamment tenu d’informer sans délai l’inspecteur vétérinaire s’il suspecte l’existence de la brucellose chez un bovin (article 3 § 1). Dès qu’il constate un avortement ou des symptômes avant-coureurs d’un avortement ou consécutifs à celui-ci sur un de ses bovins, il est tenu de l’isoler et de le faire examiner dans les 48 heures par un médecin vétérinaire agréé (article 4). En outre, en vertu de l’article 7 § 1 de l’arrêté royal, dès que le responsable des bovins a connaissance ou dès qu’il est officiellement informé par l’inspecteur vétérinaire ou le médecin vétérinaire de la suspicion de brucellose, l’exploitation concernée est soumise à un certain nombre de mesures dans l’attente des résultats des examens : le troupeau est placé sous la surveillance de l’inspecteur vétérinaire ; les bovins suspectés de brucellose sont isolés ; tout mouvement de bovins vers l’exploitation ou à partir de celle-ci est interdit, sauf le transfert direct de bovins destinés à l’abattoir pour y être abattus sans délai ; le responsable est tenu de procéder régulièrement au nettoyage et à la désinfection des locaux et des endroits occupés par les bovins suspectés d’être atteints de brucellose. Dès qu’il résulte des examens effectués que l’existence de la brucellose est confirmée, l’exploitation est considérée comme foyer et tout mouvement de bovins vers le foyer ou à partir de celui-ci est interdit (article 9, 3o).
Le droit à l’indemnisation dans le cadre de la lutte contre la brucellose bovine
30. Dans sa version applicable au moment des faits, l’article 23 § 1 de l’arrêté royal du 6 décembre 1978 prévoyait qu’une indemnité était allouée au responsable de l’exploitation lorsqu’un bovin était abattu conformément aux dispositions dudit arrêté royal, dans les limites des crédits budgétaires. Le paragraphe 3 du même article prévoyait que l’ayant droit perdait tout bénéfice de l’indemnité s’il enfreignait les dispositions de l’arrêté ou s’il enfreignait les instructions données par l’inspecteur vétérinaire en exécution de l’arrêté.
L’action en responsabilité pour faute contre l’État
31. Une action indemnitaire contre l’État pour faute de l’un de ses organes peut être mise en mouvement sur le fondement des dispositions suivantes du code civil, qui constituent le droit commun de la responsabilité civile :
Article 1382
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par lequel il est arrivé, à le réparer. »
Article 1383
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Le recours en indemnité pour dommage exceptionnel devant le Conseil d’État
32. Au moment des faits, l’article 11 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, prévoyait que dans le cas où il n’existe pas d’autre juridiction compétente, la section d’administration du Conseil d’État se prononce en équité, en tenant compte de toutes les circonstances d’intérêt public et privé, sur les demandes d’indemnité relatives à la réparation d’un dommage exceptionnel, moral ou matériel, causé par une autorité administrative. Ladite disposition précise que la demande d’indemnité n’est recevable qu’après que l’autorité administrative en cause a rejeté totalement ou partiellement une requête en indemnité, ou négligé pendant soixante jours de statuer à son égard.
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 du PROTOCOLE no 1 À LA CONVENTION
33. La requérante allègue que le refus de lui octroyer une indemnisation pour l’abattage des bovins a constitué une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Sur la recevabilité
L’exception soulevée par le Gouvernement
34. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, faute pour la requérante d’avoir introduit une demande d’indemnité devant le Conseil d’État en vertu de l’article 11 des lois sur le Conseil d’État (paragraphe 32 ci-dessus). Le Gouvernement fait valoir que le fait que la requérante ait choisi la voie du contentieux judiciaire n’impliquait pas qu’elle perdait le droit de se présenter devant le Conseil d’État, ce d’autant plus que les juridictions internes avaient établi qu’il n’y avait pas de faute dans le chef de l’AFSCA. Il fournit un exemple d’un arrêt rendu par le Conseil d’État dans une affaire qu’il estime similaire à la présente afin de démontrer le caractère effectif du recours.
35. La requérante soutient que cette procédure est résiduaire par rapport à la compétence des cours et tribunaux de réparer les atteintes illégales et fautives que causent les autorités administratives aux tiers. Le Conseil d’État n’est compétent que pour autant que l’action de l’autorité concernée soit légale et exempte de toute faute, ce qui n’était selon elle pas le cas en l’espèce. De surcroît, dans ce contentieux le Conseil d’État statue en équité ce qui exclut tout contrôle de légalité et de conventionalité. En saisissant les tribunaux judiciaires d’une demande en vertu des articles 1382 et 1383 du code civil (paragraphe 31 ci-dessus), la requérante a permis que soit effectué un contrôle de la compatibilité des normes de droit belge au regard de la Convention, l’arrêt de la Cour de cassation étant la décision interne définitive sur ce point.
Appréciation de la Cour
36. La Cour constate que la requérante a introduit un recours indemnitaire en vertu des articles 1382 et 1383 du code civil qu’elle a mené à bien devant les juridictions internes jusque devant la Cour de cassation en invoquant une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Le recours avait pour but d’obtenir une indemnisation pour l’abattage de 253 bovins en démontrant que l’AFSCA et la DGZ avaient commis des fautes sans lesquelles la requérante n’aurait pas subi de dommage. La requérante a ainsi donné la possibilité aux juridictions internes de remédier à la violation alléguée. Il ne saurait lui être reproché, comme le fait le Gouvernement, de ne pas avoir également fait usage du recours prévu à l’article 11 des lois sur le Conseil d’État. En effet, à supposer même que ce recours aurait permis à la requérante d’obtenir une réparation pour le dommage subi, lorsqu’une voie de recours a été utilisée, l’usage d’une autre voie dont le but est pratiquement le même n’est pas exigé (voir, parmi d’autres, Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, § 58, CEDH 2009, et Uzan et autres c. Turquie, no 19620/05 et 3 autres, § 174, 5 mars 2019).
37. Par ailleurs, constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
Sur le fond
Thèses des parties
a) La requérante
38. La requérante estime que l’abattage de ses bovins a constitué une privation de propriété au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 dès lors qu’elle a conduit, de facto, à la destruction totale, obligatoire et irrémédiable des biens concernés. Aussi, elle soutient que les bovins constituent son « outil de travail » et qu’ils devaient bénéficier à ce titre d’une protection plus large. Elle déduit de ces éléments que, sauf circonstances exceptionnelles, l’absence d’indemnisation en rapport avec la valeur des biens constitue une atteinte excessive au droit de propriété. Or la notion de « circonstances exceptionnelles » telle qu’interprétée par la Cour ne viserait que des situations très rares touchant à l’ensemble du régime politique ou économique d’un pays, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Partant, la requérante estime que l’atteinte à ses droits a été particulièrement importante et aurait requis qu’une indemnité, au moins partielle, lui soit accordée. Elle renvoie à cet égard à d’autres législations à l’objet similaire et qui sanctionnent le non-respect des obligations sanitaires qu’elles édictent par une sanction plus mesurée, réduisant le droit à l’indemnisation, sans le réduire à néant.
39. La requérante ne conteste pas avoir commis un certain nombre de manquements à la réglementation en vigueur. Elle estime toutefois que le non-respect de certaines dispositions internes doit être considéré à la lumière des circonstances particulières l’expliquant et qui rendent le refus d’indemnisation excessif et contraire à l’article 1 du Protocole no 1 en l’espèce. Elle soutient en effet qu’elle avait des raisons légitimes, suite à un dépistage subi par les bovins, de penser que les animaux étaient en pleine santé et que les avortements ayant eu lieu entre 1998 et 2000 pouvaient s’expliquer par d’autres facteurs que la brucellose. La requérante fait valoir qu’en 1998 la brucellose n’était pas une maladie courante mais qu’au contraire elle avait presque disparu en Belgique. Elle en veut pour preuve qu’elle a été considérée comme le dernier cas de brucellose diagnostiqué en Belgique avant l’obtention du statut « officiellement indemne ». À cela s’ajoute que la brucellose est une maladie particulièrement difficile à diagnostiquer du fait de la longueur de la période d’incubation.
40. Enfin, comme devant les juridictions internes, la requérante fait valoir que les autorités belges ne l’ont pas informée en temps utile qu’un cas de brucellose avait été détecté dans l’exploitation du marchand qui avait livré les bovins à la requérante. Dès lors, l’application sans nuance et de manière automatique de l’article 23 § 3 de l’arrêté royal du 6 décembre 1978 a constitué une atteinte disproportionnée et injustifiée au droit du respect de ses biens.
b) Le Gouvernement
41. Le Gouvernement soutient en premier lieu que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, l’ingérence litigieuse constitue un contrôle de l’usage des biens et relève à ce titre du second alinéa de la disposition invoquée. En effet, les bovins sont restés la propriété de la société requérante, qui pouvait les vendre et en percevoir la valeur bouchère - non négligeable - dès lors que la viande provenant de bêtes touchées par la brucellose est propre à la consommation humaine. Le Gouvernement rappelle ensuite que la présente affaire s’inscrit dans le contexte général de lutte contre la brucellose bovine, la Belgique ayant été fortement contaminée jusqu’à la fin des années 1980, de sorte que la requérante ne pouvait pas ignorer les obligations qui lui incombaient en vertu de l’arrêté royal du 6 décembre 1978 (paragraphe 29 ci-dessus). Or le refus d’indemniser la requérante pour l’abattage des bovins était clairement motivé par les nombreuses infractions aux dispositions réglementaires constatées. Ce refus d’indemnisation était prévisible puisqu’explicitement prévu à l’article 23 § 3 de l’arrêté royal du 6 décembre 1978 (paragraphe 30 ci-dessus).
42. Le Gouvernement rappelle l’importance de la lutte contre la brucellose bovine qui peut avoir des conséquences sanitaires et économiques désastreuses et qui explique les mesures drastiques prises par l’État belge afin d’endiguer les foyers détectés et de conserver le statut « officiellement indemne » de la Belgique. Cette maladie présente des difficultés de dépistage du fait de la période d’incubation longue et de l’évolution lente des symptômes, d’où l’importance de la collaboration sérieuse des exploitants de réaliser les tests nécessaires et d’attirer l’attention de l’ASFCA au moindre soupçon. Le comportement de la société requérante, les multiples infractions commises en dépit du contexte général de lutte contre la brucellose et la gravité des risques encourus constituent des circonstances exceptionnelles justifiant qu’aucune indemnisation n’ait été octroyée à la requérante. Si elle avait respecté l’arrêté royal du 6 décembre 1978, la requérante aurait pu obtenir une compensation financière permettant d’atteindre, après revente au prix de boucherie, 85 % de la valeur de remplacement estimée des bovins.
43. En ce qui concerne la « perte de l’outil de travail », le Gouvernement soutient que les bovins ne constituaient pas un outil de travail au sens de la jurisprudence de la Cour et qu’en tout cas l’abattage des bovins n’a pas été de nature à aboutir à l’impossibilité pour la requérante de poursuivre son activité puisqu’elle a pu accueillir de nouveaux bovins dès la levée des mesures sanitaires.
Appréciation de la Cour
a) Principes généraux applicables
44. La Cour rappelle que non seulement une ingérence dans le droit de propriété doit viser, dans les faits comme en principe, un « but légitime » conforme à « l’intérêt général », mais il doit aussi exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure appliquée par l’État, y compris les mesures destinées à réglementer l’usage des biens d’un individu. C’est ce qu’exprime la notion du « juste équilibre » qui doit être ménagé entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 69, série A no 52, et Hutten-Czapska c. Pologne [GC], no 35014/97, § 167, CEDH 2006‑VIII). En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l’État une marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause (voir, notamment, Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94 et 2 autres, § 75, CEDH 1999‑III, et G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie [GC], nos 1828/06 et 2 autres, § 293, 28 juin 2018).
b) Application au cas d’espèce
45. La Cour relève d’emblée que la requérante a obtenu une indemnisation sous forme de dommages et intérêts pour les fautes commises par la DGZ pour 27 bovins abattus et qu’elle a en outre conclu un règlement amiable avec cette association pour 62 bovins supplémentaires (paragraphes 24 et 28 ci-dessus). Lors de la mise à jour du dossier en février 2018, la requérante a néanmoins précisé qu’elle souhaitait maintenir l’ensemble de sa requête dans la mesure où elle considère que les griefs invoqués à l’encontre de l’État belge n’ont pas été affectés par les indemnités partielles qu’elle a reçues, l’essentiel de son préjudice n’ayant pas été indemnisé.
46. La Cour prend note du souhait de la requérante de maintenir l’ensemble de sa requête et constate que le Gouvernement n’a soulevé aucune exception à cet égard. Cela étant, rien n’empêche la Cour de prendre, le cas échéant, ces éléments en compte dans l’examen de la proportionnalité des mesures contestées (voir, par exemple, Pinnacle Meat Processors Company et 8 autres c. Royaume-Uni, no 33298/96, décision de la Commission du 21 octobre 1998, non publiée).
Sur la nature de l’atteinte
47. Aucune contestation ne s’élève quant au fait que les mesures d’abattage litigieuses constituent une atteinte à la propriété de la requérante au regard de l’article 1 du Protocole no 1.
48. La Cour a déjà considéré qu’une mesure d’abattage préventif d’ovins afin de prévenir le déclenchement d’une épizootie de fièvre aphteuse sur le territoire national s’analysait en une réglementation de l’usage des biens (Chagnon et Fournier c. France, nos 44174/06 et 44190/06, § 36, 15 juillet 2010). Il n’y a pas lieu de décider autrement en l’espèce dès lors que, comme l’a relevé le Gouvernement, les bovins abattus sont restés la propriété de la requérante, qui pouvait les vendre et en percevoir la valeur bouchère. L’ingérence relève donc du second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1.
49. Ceci étant dit, cette règle doit en tout cas s’interpréter à la lumière du principe général du respect de la propriété énoncé dans le premier paragraphe du premier alinéa de l’article précité (G.I.E.M. S.R.L. et autres, précité, § 289, et Lekić c. Slovénie [GC], no 36480/07, § 92, 11 décembre 2018).
Sur la justification de l’atteinte
50. La requérante ne conteste pas la légalité des mesures d’abattage et du refus d’indemnisation qui étaient prévus par l’arrêté royal du 6 décembre 1978, ni le but légitime d’intérêt public qu’ils poursuivaient. Les parties sont toutefois en désaccord sur la question de savoir si ces mesures étaient proportionnées au but poursuivi.
51. La requérante soutient qu’en application de la jurisprudence de la Cour, seules des circonstances exceptionnelles peuvent justifier un défaut total d’indemnisation (Jahn et autres c. Allemagne [GC], nos 46720/99 et 2 autres, § 94, CEDH 2005‑VI, et Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 95, CEDH 2006‑V). La jurisprudence sur laquelle se fonde la requérante a trait à une privation de propriété relevant de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1. Or ce critère n’est pas applicable lorsqu’est en cause une mesure de réglementation de l’usage des biens. Dans ce cas-là, l’absence d’indemnisation est l’un des facteurs à prendre en compte pour établir si un juste équilibre a été respecté mais elle ne saurait, à elle seule, être constitutive d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1 (Depalle c. France [GC], no 34044/02, § 91, CEDH 2010, et Malfatto et Mieille c. France, no 40886/06 et 51946/07, § 64, 6 octobre 2016). La Cour va dès lors s’attacher à vérifier si l’abattage des bovins sans indemnisation a, dans les circonstances de l’espèce, ménagé un juste équilibre entre l’intérêt général et les droits fondamentaux de la requérante, ou si celui-ci a fait peser sur elle une charge spéciale ou exorbitante.
52. La Cour note que l’arrêté royal du 6 décembre 1978 prévoit en principe une indemnisation partielle pour l’abattage de bovins atteints de la brucellose. La requérante s’est vu refuser l’octroi de cette indemnité en raison des multiples manquements qu’elle a commis aux obligations lui incombant. Le refus d’indemnisation dans ce cas est expressément prévu par l’article 23 § 3 dudit arrêté royal, et la requérante n’a pas fait valoir qu’elle ignorait ses obligations réglementaires ni qu’elle n’avait pas commis les manquements qui lui ont été reprochés.
53. Elle a tenté, en vain, de démontrer devant les juridictions internes que les autorités avaient commis un certain nombre de fautes qui étaient à l’origine du dommage qu’elle a subi. Sa demande a été dûment examinée par les juridictions nationales lesquelles ont estimé, après avoir entendu contradictoirement les arguments des parties et examiné tous les éléments du dossier, que sa demande à l’égard de l’AFSCA n’était pas fondée. Ce faisant, les juridictions internes ont vérifié que les conditions justifiant une atteinte au droit de propriété tel qu’interprété par la Cour étaient remplies dans les circonstances de l’espèce, en particulier que les mesures d’abattage étaient prévues par la loi, qu’elles poursuivaient un but légitime et qu’elles étaient proportionnées au but poursuivi (paragraphes 21 et 22 ci-dessus). La Cour ne décèle dans le raisonnement des juridictions nationales aucun élément permettant de conclure que leurs décisions étaient arbitraires ou manifestement déraisonnables.
54. Par ailleurs, la Cour note et tient compte, dans l’examen de la proportionnalité des mesures litigieuses, du fait que la requérante a obtenu une compensation financière pour 89 des bovins abattus pour des fautes commises par la DGZ (paragraphes 25 et 28 ci-dessus).
55. Le fait que d’autres législations similaires sanctionnent le non-respect d’obligations sanitaires qu’elles édictent en réduisant le droit à l’indemnisation plutôt qu’en l’excluant n’est pas en l’espèce de nature à rompre le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général. Les autorités nationales disposent d’une certaine marge d’appréciation lorsqu’il s’agit de protéger la santé publique et la sécurité alimentaire sur leur territoire (Chagnon et Fournier, précité, § 57) pour déterminer les sanctions du non-respect des obligations sanitaires, selon les risques engendrés par ce non-respect et les caractéristiques des maladies animales que ces obligations visent à éradiquer.
56. De l’avis de la Cour, déterminer si les bovins constituaient « l’outil de travail » de la requérante tel qu’interprété par la Cour (voir, à cet égard, Lallement c. France, no 46044/99, 11 avril 2002) ne modifie pas en l’espèce la conclusion à laquelle elle aboutit. Comme l’a fait remarquer le Gouvernement, la requérante pouvait poursuivre son activité en accueillant de nouveaux bovins dès la levée des mesures sanitaires le 20 juin 2000 (paragraphe 16 ci-dessus). La requérante n’a pas fait valoir que cela lui avait été impossible ou exagérément difficile.
57. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que, eu égard à l’importance pour les États de lutter contre les maladies animales et compte tenu de la marge d’appréciation dont bénéficient les États en la matière, la requérante n’a pas eu à subir une charge spéciale ou exorbitante du fait du refus d’indemnisation pour l’abattage de ses bovins.
58. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Déclare la requête recevable ;
Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 novembre 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.



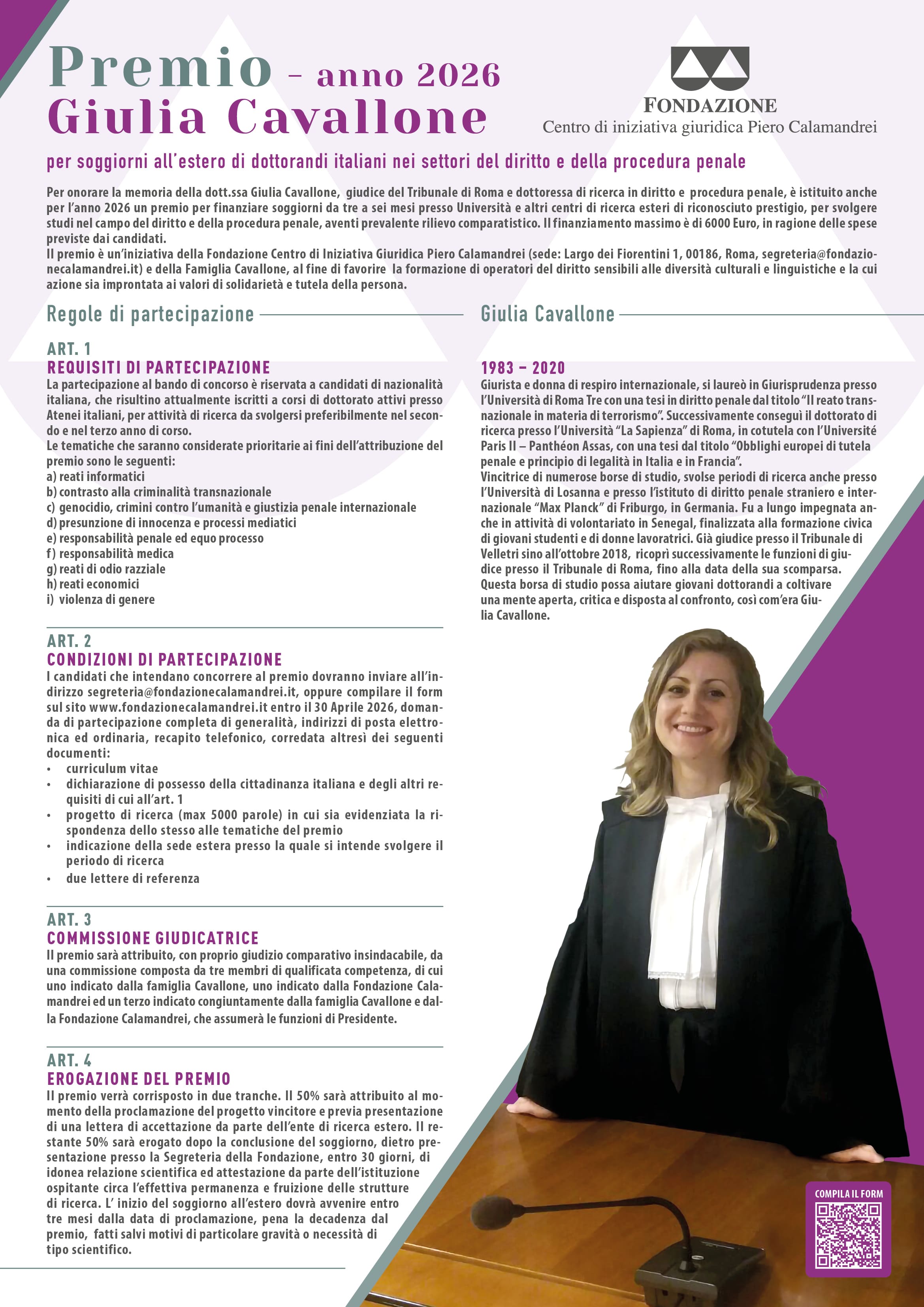 Scarica la locandina
Scarica la locandina